Pourquoi procrastine-t-on ? Les raisons scientifiques et quelques conseils
25 mars 2021
7min

MS
Créatrice de contenus @ Point Virgule
Vous êtes le genre de personne qui laisse traîner ses factures impayées sur la table de l’entrée jusqu’à ce que l’échéance soit imminente ? Vous vous entêtez à ne pas prêter attention à cette to do list accrochée sur le coin de votre bureau de maison depuis des mois ? Et cela fait 5 ans que vous repoussez sans cesse votre rendez-vous annuel chez le dentiste ? Le diagnostic est sans appel : vous êtes un procrastinateur. Peut-être êtes-vous d’ailleurs en train de procrastiner en lisant cet article ! D’ailleurs, le télétravail qui nous est imposé a amplifié ce phénomène sous l’influence de toutes ces distractions quotidiennes qui nous tendent les bras, mais aussi en raison du chamboulement émotionnel que nous traversons tous.
Pas de panique, nous sommes tous atteints de procrastination plus ou moins aiguë. Pour rappel, la procrastination, c’est cette force qui nous pousse, inlassablement, à retarder la réalisation d’une tâche. Elle se manifeste souvent par le fameux : « je le ferai demain ». Alors, la doit-on à une flemme carabinée ? Ou à un manque cruel d’organisation ?
Et bien ni l’un ni l’autre, en tout cas pas toujours. Psychologiques, neurologiques, environnementales… Les raisons scientifiques de procrastiner sont multiples. On vous dit tout, aujourd’hui (et pas demain !)
Nous sommes programmés à procrastiner
Selon le neuropsychologue et neuroscientifique Julien Vion, « Même quand on est quelqu’un de rigoureux et qu’on pense ne pas être de nature procrastinatrice, il peut nous arriver de procrastiner, inconsciemment. » Pourquoi ? D’abord parce que l’Homme est en quelque sorte “programmé” pour ça depuis qu’il se tient sur ses deux jambes. Julien Vion explique : « Notre cerveau est branché sur le circuit du plaisir depuis l’aube de l’Homo sapiens. C’est un système très puissant qui nous pousse à aller chercher le plaisir immédiat, plutôt que de faire face à la tâche difficile, même si elle amène un plaisir plus important lorsqu’elle est terminée. »
« Le circuit du plaisir […] nous pousse à aller chercher le plaisir immédiat, plutôt que de faire face à la tâche difficile. » Julien Vion
Reste que certains individus sont mieux armés que d’autres pour faire face à cette tentation. On fait d’ailleurs la distinction entre la procrastination occasionnelle et la procrastination chronique, qui elle fait référence à une répétition trop régulière du comportement, souvent dommageable pour nous et notre entourage. Ce dernier cas toucherait environ 20% de la population, soit un français sur cinq, et 50% de jeunes.
La procrastination, ou l’incapacité à gérer nos émotions
Pour mieux comprendre les mécanismes qui nous poussent à un tel comportement, penchons-nous sur la définition scientifique de la procrastination. Timothy Pychyl, professeur de psychologie à l’Université Carleton au Canada, spécialiste de la question, définit la procrastination comme étant « un retard volontaire d’une action prévue en dépit de la connaissance que ce retard est préjudiciable tant aux performances qu’à la manière dont la personne se sent vis-à-vis de la tâche ou d’elle-même. » Le paradoxe est là : le procrastinateur choisit délibérément de reporter une tâche qu’il a pourtant décidé de réaliser, et même s’il sait qu’il devra souffrir des conséquences malheureuses de ce report.
Ce n’est pas une maladie
La procrastination n’est toutefois pas une maladie, mais bien un comportement qui découle de notre incapacité à gérer nos émotions. Les experts parlent “d’échec d’autorégulation”. En fait, la procrastination découle de l’incapacité à gérer les émotions provoquées par le choix à faire entre une tâche contraignante à faible récompense et une tâche peu contraignante à récompense plus importante et immédiate. Pour Timothy Pychyl : « Les procrastinateurs savent ce qu’ils doivent faire mais sont incapables de s’y mettre : ils sont dans le fossé entre l’action et l’intention. » Julien Vion détaille : « L’intention et l’envie sont présentes, mais il n’y a pas assez de contrôle de soi pour déclencher l’action. » Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, procrastiner ne signifie pas non plus être paresseux ni mal organisé. Certains procrastinateurs sont même très actifs, tant que l’occupation à l’instant T est plus agréable que la tâche aversive à accomplir.
« Les procrastinateurs sont dans le fossé entre l’action et l’intention. » Timothy Pychyl
Des raisons psychologiques
Notre (in)capacité à contrôler nos émotions influe donc directement sur notre tendance à procrastiner. C’est la raison pour laquelle certaines personnes sont plus touchées par la procrastination, car leurs caractéristiques émotionnelles favorisent ce comportement. Les personnes sujettes à la dépression ou aux troubles bipolaires auront par exemple une grande tendance à procrastiner. Ainsi, l’une des sources de la procrastination est à chercher du côté de ces pathologies ou des traits qui s’y rapportent.
Le télétravail, les confinements et l’isolement qui en découle ont pu dans ce sens, être des facteurs supplémentaires de tendance à la procrastination. Des émotions comme la peur, mais aussi l’augmentation de la frustration, de l’anxiété et de la dépression chez les salariés, pèsent forcément dans l’équation.
Parmi les causes d’ordre psychologique, on retrouve fréquemment la peur de l’échec et la faible estime de soi, le perfectionnisme, la peur de la frustration ou de l’ennui. Ces émotions peuvent être un frein au passage à l’acte. Or, souligne Charles Pépin, professeur de philosophie, « Ce qui donne confiance, c’est de passer à l’acte. » Concernant les perfectionnistes, il explique : « Il y a une relation problématique entre procrastination et perfectionnisme. On se ment à soi-même, on se persuade qu’on le fera quand on sera parfaitement prêt. Mais au fond, on n’est jamais parfaitement prêt. La confiance, l’audace, la liberté, c’est d’y aller alors qu’on n’est pas parfaitement prêt », ajoute-t-il. Il faudrait, selon le philosophe, « passer d’une logique de perfectionnisme à celle d’un perfectionnement permanent. »
« Il faudrait passer d’une logique de perfectionnise à celle d’un perfectionnement permanent. » Charles Pépin
L’amygdale au coeur du mécanisme émotionnel
Là encore, c’est dans le cerveau que cela se joue. En particulier au niveau de l’amygdale cérébrale, ce petit amas de matière grise en forme d’amande situé dans le lobe temporal qui tient un rôle majeur dans l’appréciation des émotions et la prise de décision. Une étude parue dans la revue Pyschological Science tend d’ailleurs à montrer que la taille de l’amygdale diffère selon qu’on est procrastinateur ou pas. D’après les 264 sujets qui ont été étudiés, il apparaît que les procrastinateurs ont une amygdale cérébrale plus grande que les autres, car ils seraient plus soucieux des émotions négatives provoquées par la vision d’une action aversive, qu’ils auront donc tendance à remettre à plus tard. Par ailleurs, cette même étude semble montrer que chez les procrastinateurs, la connexion entre l’amygdale cérébrale et le cortex cingulaire antérieur dorsal est moins importante que chez les autres. Or, c’est cette dernière partie qui utilise les informations recueillies par l’amygdale pour choisir les actions à mettre en oeuvre, ou pas.
La procrastination est aussi liée à l’âge
Le neuroscientifique Julien Vion relève cette particularité : « On trouve plus de procrastinateurs chez les jeunes, car avant 25 ans, le cerveau n’est pas complètement formé, notamment le lobe préfrontal, qui contrôle et donne des objectifs. Le cerveau n’a pas toute sa puissance pour faire face aux circuits du plaisir et des émotions. » Mais, alors qu’on pourrait penser qu’avec l’âge, cette mauvaise habitude de remettre tout au lendemain s’estomperait, il n’en est rien pour les procrastinateurs réguliers !
Au contraire, pour Julien Vion : plus on a pris l’habitude de procrastiner, plus il est difficile de se défaire de ce comportement. Il explique cela par les biais cognitifs qui accompagnent la procrastination, c’est-à-dire des distorsions de la réalité qui nous permettent de nous protéger derrière de fausses excuses. C’est ce qui nous pousse, par exemple, à penser : « je bouclerai ce dossier au dernier moment, je travaille mieux dans l’urgence… », « j’aurai largement le temps de ranger plus tard… » ou encore « ce n’est pas le bon moment pour me lancer dans cette tâche… »
Et la génétique, dans tout ça ?
Un facteur et non une cause
Toujours selon Julien Vion, la génétique peut elle aussi favoriser la procrastination, mais elle n’en est pas la cause principale. « Lorsque le cerveau se forme, nous dit-il, il se crée des fragilités qui peuvent favoriser un comportement procrastinateur, mais qui ne le déclenchent pas. »
Quant au facteur héréditaire, il l’exclut totalement : « Ce n’est pas parce que vous avez des parents procrastinateurs que vous allez l’être aussi génétiquement, en revanche si vos parents vous donnent des habitudes dans ce sens dans leur éducation, c’est possible de le devenir. »
Des raisons principalement environnementales
Si notre patrimoine génétique agit sur notre tendance à procrastiner, pour le neuropsychologue c’est surtout notre environnement qui fait de nous des procrastinateurs. Ce que l’on nous a répété dans l’enfance : « tu n’y arriveras pas », ou bien à l’école et pendant nos études « on a le temps, la dissert’ c’est pour la semaine prochaine » ou « viens, on sort d’abord… » peut rester ancré en nous. À force, ces pensées et biais cognitifs se muent en croyances… Et il devient difficile de s’en défaire.
La procrastination, un mal de notre époque
Internet et réseaux sociaux, jeux vidéo, société de consommation… Autant de distractions que de bonnes raisons de procrastiner et la plupart se retrouvent compilées là, sous notre toit : la tentation peut alors être forte de se détourner de ses objectifs de travail Selon Diane Ballonad Rolland, coach, formatrice et auteure du livre J’arrête de procrastiner, la procrastination aurait augmenté de 300% en 40 ans. Son constat rejoint celui des experts comme Julien Vion ou du psychothérapeute Bruno Koeltz : notre époque accentue la tendance à la procrastination. Pour Julien Vion : « Après guerre, il était difficile d’avoir accès aux distractions, donc notre circuit du plaisir devait faire face à beaucoup d’obstacles pour être satisfait. Aujourd’hui, l’accès à des plaisirs nombreux est plus simple. Nous avons donc moins d’efforts à faire pour les atteindre. » En d’autres termes, on procrastinerait plus facilement aujourd’hui, par l’augmentation des plaisirs instantanés auxquels nous avons accès. Difficile donc de télétravailler dans ces conditions !
Procrastiner, ce n’est pas une fatalité !
Nous sommes d’une part, programmés pour préférer procrastiner, mais aussi plus ou moins capables de résister aux tentations de le faire. Cela se joue en partie dans notre cerveau, mais cela vient également beaucoup de notre vécu. Sur ces deux plans, il est possible d’agir pour sortir d’une procrastination chronique. Voici quelques conseils à suivre :
- Faire le tri de ses tâches, en les listant une à une sur un papier et en les organisant par ordre d’importance (ou d’urgence). Puis, se fixer un à deux objectifs par jour.
- Découper la tâche aversive à réaliser, qui semble être une montagne à gravir, en petites tâches plus faciles et plus rapides à accomplir. Si une mission vous rebute, par exemple, fractionnez-la pour l’aborder en plusieurs étapes. L’objectif : décupler le sentiment de satisfaction !
- Mettre en place un rituel pour se mettre dans de bonnes dispositions avant de passer à l’action : faire une minute d’exercices de respiration, se servir un thé bien chaud, ranger son bureau…
- Noter les émotions positives associées au passage à l’acte : « je me sentirai libéré », « j’aurai la conscience tranquille », « je garderai mon argent pour mes loisirs ».
N’oubliez pas que vous pouvez également vous faire accompagner. Par exemple, par un thérapeute, qui peut vous aider à mieux gérer vos émotions, ou par un coach. En attendant, notre dernier conseil est de déculpabiliser en regardant la drôle intervention de Tim Urban, procrastinateur invétéré et auteur du blog Wait but Why, lors d’une conférence TED.
Suivez Welcome to the Jungle sur Facebook pour recevoir chaque jour nos meilleurs articles dans votre timeline !
Photo d’illustration by WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : C'est la rentrée mais c'est ok
Le guide ultime d'une rentrée heureuse.

Managers : comment éviter à vos collaborateurs une rentrée sur les chapeaux de roue ?
Comment préserver ses équipes (et soi-même) de la reprise de septembre ? Voici notre mini-guide pour une rentrée moins stressante !
30 août 2023

TEST : Angoissé·e, bon·ne élève... Quel·le salarié·e êtes-vous à la rentrée ?
Plutôt bon·ne élève, angoissé·e ou dans le déni total ?
31 août 2022

À la rentrée, tous déprimés ? Nos conseils pour éviter le coup de blues
10 conseils pour chasser le moral de vos chaussettes !
31 août 2022

Rentrée : 7 conseils pour combattre l’angoisse du retour au boulot
On a rangé les vacances dans des valises en carton et c'est triste quand on pense à la saison de la grisaille et des patrons...
30 août 2022

Absence d’évolution : comment se motiver en cette rentrée si spéciale ?
Comment (re)trouver la motivation en cette rentrée ?
10 janv. 2022
La newsletter qui fait le taf
Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.
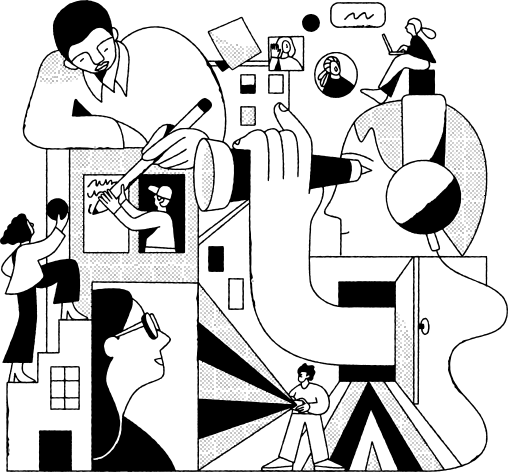
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?
Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.
Explorer les jobs