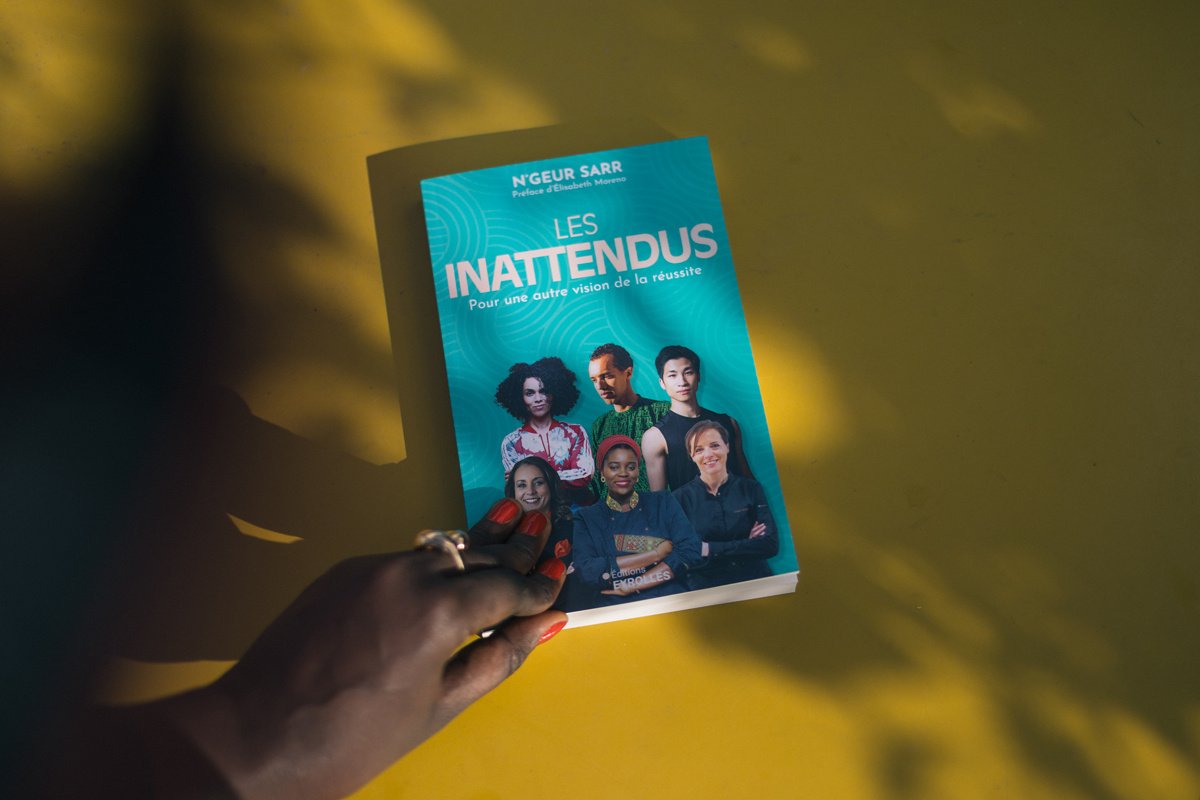N'Geur Sarr : « La liberté d'être soi, c'est ça la définition de la réussite »
23 mai 2024
6min

N’Geur Sarr se dépeint comme une « inattendue » : elle a su défier les statistiques et accéder à des positions où la société ne l'attendait pas. Elle sort aujourd'hui son premier livre « Les Inattendus, pour une autre vision de la réussite », afin de proposer une définition alternative de la réussite et déconstruire le mythe de la méritocratie à travers son parcours et celui de 32 autres « inattendus ». Entretien.
Votre ouvrage « Les Inattendus, pour une autre vision de la réussite » sort aujourd’hui, le 23 mai 2024. Pourquoi maintenant ?
En 2020, après un burn out, j’ai remis en question ma définition de la réussite. Après 7 ans au sein du groupe Canal+ pour lancer et développer des filiales du groupe dans une dizaine de pays africains, j’ai connu une vraie perte de sens. Je ne savais pas à quels modèles me fier, ceux prônés par la société ne me correspondant plus. J’ai donc lancé mon podcast Gatemeri, un podcast qui redéfinit la réussite et ses facteurs en m’inspirant de la réussite de différents leaders. J’ai réalisé que je n’étais pas la seule à ne pas me retrouver dans la vision « classique » de la réussite. C’est pour ça que j’ai voulu aller plus loin avec ce livre, un essai dans lequel je mêle mon parcours à ceux d’invités du podcast - Gaël Faye, Elisabeth Moreno, Claire Heitzler, Aude de Thuin,… - études et statistiques à la clé. Mon objectif est double : partager une autre vision de la réussite grâce à ces différents modèles de réussite « Inattendus », et reconsidérer le mythe de la méritocratie en France.
Quelle est la vision de la réussite prônée par la société ?
Aux yeux de la société et dans l’imaginaire collectif, la réussite signifie « accomplir des objectifs valorisés dans la société. » Ces objectifs sont toujours les mêmes : faire de « bonnes études » dans de « bonnes écoles », décrocher un « bon travail », un « bon salaire » et, de fait, être reconnu socialement. La condition pour réussir ? Travailler dur. On appelle cela la « méritocratie ».
D’où provient cette hiérarchie sociale de la réussite ?
Dès l’école, on nous forme à suivre un modèle unique de réussite. Il y a une hiérarchie des talents dès l’enfance. Par exemple, les matières scientifiques sont prises au sérieux, au détriment des matières littéraires. Cela se répercute dans l’entreprise, dans laquelle les talents doivent forcément sortir de « grandes écoles », comme les écoles de commerces, ou d’ingénieurs. Merouan Bounekraf, chef cuisinier (Top Chef) témoigne dans le livre. On lui a répété de travailler à l’école, sans quoi il deviendrait cuisinier, poste considéré comme un sous-métier par son interlocuteur. Et aujourd’hui, regardez où il en est…
« La vision que je prône de la réussite se mesure donc au contentement intérieur, et non aux signes extérieurs de réussite. » - N’Geur Sarr, fondatrice du podcast Gatemeri et auteure de « Les Inattendus, pour une autre vision de la réussite ».
Dans l’ouvrage, vous soulignez que cette vision classique de la réussite parle à de moins en moins de monde. Comment expliquez-vous cela ?
La remise en question du travail comme rôle central dans nos vies a commencé dans les années 80 avec le chômage de masse, la réduction du temps de travail et la généralisation des congés payés. Plus récemment, l’autonomisation croissante du travail a accéléré cette tendance. Sans compter la crise du covid ! Depuis, il n’y a qu’à voir le taux croissant de quiet quitting, de désengagement des collaborateurs, etc. Aujourd’hui, le travail n’a plus autant d’importance qu’avant. En 2023, seuls 24 % des Français estiment que le travail occupe une place « très importante » dans leur vie contre 60 % en 1990, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès.
Quelle est votre définition de la réussite aujourd’hui ?
Selon moi, la réussite est synonyme de « la liberté d’être soi ». Cela passe par de nombreuses choses, telles que suivre ses passions, ne plus prêter attentions au regard des autres, faire des choses à son image et qui aient du sens, être aligné·e avec soi-même. La vision que je prône de la réussite se mesure donc au contentement intérieur, et non aux signes extérieurs de réussite. Cela fait écho à la définition de la réussite selon Claire Heitzler, cheffe pâtissière : « La réussite, c’est être heureuse dans ma vie et fière de ce que je fais, c’est d’être bien dans mon travail et dans ma vie. »
Dans livre, vous citez cette étude selon laquelle « les jeunes issus des milieux ouvriers, âgés de 18 à 23 ans, représentent environ 30 % de la population, mais ne constituent que 1 % des élèves à Polytechnique… » Est-ce à prouver que, encore aujourd’hui, nous sommes bien loin d’être égaux et que la méritocratie ne fonctionne pas ?
Tout à fait. D’où la désignation des « inattendus », pour celles et ceux qui réussissent malgré les obstacles. Ces « inattendus » sont les étrangers, les enfants d’immigrés, les femmes, les personnes qui viennent de territoires socio-économiques non favorisés et les personnes qui ont des orientations sexuelles non hétero-normées, bref : ceux et celles à qui on demande de réussir à force de travail acharné, sans prendre leur condition en compte. Le milieu social et l’éducation dont nous sommes issus notamment, ont une répercussion sur le milieu professionnel. Seulement 4% des cadres dirigeants français ont des parents ouvriers, tandis que 62% des cadres ont des parents cadres ou de professions supérieures. Le genre aussi a son importance. Ainsi, les femmes représentent 52% de la population, mais selon Ethics & Boards, seulement 18 d’entre elles ont pu atteindre les postes les plus élevés parmi les 120 plus grandes entreprises françaises. C’est bien la preuve que la méritocratie n’est pas suffisante pour réussir.
Si le travail ne suffit pas, quels sont les autres éléments dont la « réussite » (sociale et professionnelle en tout cas) de chacun dépend ?
La réussite dépend de nombreux facteurs. Outre l’histoire et les origines (géographiques, sociales), le contexte familial a son importance. Certains parents, qui n’ont pas eu la chance de faire des études supérieures par exemple, poussent leurs enfants à avoir de l’ambition notamment dans les études. La place dans la fratrie peut aussi jouer un rôle. Les aîné·es sont souvent responsabilisés très tôt, ce qui peut influer sur la suite de leur vie, professionnelle notamment. Il y a aussi la découverte d’une passion, les rencontres et le facteur chance. Les accidents de la vie ont aussi leur importance. Gaël Faye, pour ne citer que lui, n’aurait peut être pas quitté le Rwanda s’il n’y avait pas eu le génocide contre les Tutsis et aurait peut être connu une trajectoire différente
« Je suis pourtant convaincue que la réussite est un travail d’équipe. Il faut repenser la réussite collectivement. » - N’Geur Sarr, fondatrice du podcast Gatemeri et auteure de « Les Inattendus, pour une autre vision de la réussite ».
Et vous, en quoi êtes-vous une « inattendue » ?
Mon père était ouvrier, puis est devenu indépendant en achetant sa licence de taxi, et ma mère femme de ménage, puis mère au foyer. Je fais partie des 5% d’enfants d’ouvriers à avoir intégré l’une des écoles les plus sélectives, l’ESCP, avant de décrocher un premier emploi chez Canal+, où je suis restée 7 ans, puis de fonder ma startup The Dots aux côtés de Jennifer Moukouma, pour accompagner les entreprises à révéler leur identité en alignant leur culture avec leur mission. On peut donc imaginer, si on se fie aux stéréotypes, que rien ne me prédestinait à la réussite.
Quels sont alors les facteurs qui vous ont permis de réussir ?
En premier lieu, c’est mon contexte familial. Mon père, bien que n’ayant pas fait d’études, vient d’une famille d’érudits mourides (une confrérie soufie au Sénégal), dans laquelle le savoir est très valorisé. Il nous a toujours encouragés, mes sœurs et moi, à travailler dur à l’école et nos différents voyages au Sénégal m’ont donné le goût à l’exploration dès mon plus jeune âge. Malgré mes origines sociales, j’ai eu un contexte familial très encourageant et mes grandes sœurs m’ont ouvert la voie que j’ai suivi. Le travail a donc payé, mais sans eux, je ne serais pas là aujourd’hui. J’ai aussi eu la chance d’être accompagnée par de nombreuses rencontres devenues de mentors, comme un ami de ma sœur qui m’a préparée aux oraux d’écoles de commerce. Je n’ai donc pas vocation à dire : « Moi je l’ai fait, donc n’importe qui peut le faire ! » Cela montre aussi l’importance d’être bien entouré·e. Le modèle de la méritocratie est individualiste, à l’heure où les réseaux sociaux sont envahis par des modèles de self made men ou women qui réussissent soit disant seuls, à la seule force du poignet. Je suis pourtant convaincue que la réussite est un travail d’équipe. Il faut repenser la réussite collectivement.
« A force de répondre aux diktats de la méritocratie, on ne s’écoute plus et on finit par confondre son ambition et sa santé mentale. » - N’Geur Sarr, fondatrice du podcast Gatemeri et auteure de « Les Inattendus, pour une autre vision de la réussite ».
Pourquoi déconstruire le mythe de la « hustle culture » ou du « no pain no gain », soit le travail acharné comme seule voie vers le succès ?
Cela mène souvent au surmenage. A force de répondre aux diktats de la méritocratie, on ne s’écoute plus et on finit par confondre son ambition et sa santé mentale. C’est particulièrement présent chez les personnes dont les parents ont valorisé le travail comme seul moyen de survie, elles pensent qu’elles ne peuvent s’en sortir que par le travail et ne comprennent pas le principe du repos ! C’est aussi extrêmement culpabilisant pour ceux et celles qui n’ont pas la chance de pouvoir sortir d’un déterminisme, parfois fataliste, social, racial ou de genre, même avec beaucoup de travail.
Quels sont les premiers à faire pour s’échapper de son propre déterminisme ?
Tout en gardant en tête que tout le monde n’a pas les mêmes chances de le faire, on peut commencer par se défaire de ce qui ne nous appartient pas : les cases, les étiquettes qui nous enferment. D’où l’intérêt de se demander ce que l’on veut vraiment faire et être, au lieu d’être déterminé par la société. Il faut aussi remettre l’injonction de la méritocratie comme seul facteur de réussite, pour (re)trouver un équilibre sain entre son ambition et son bien-être. Même si j’ai conscience qu’il faut du courage pour s’extirper de ce qu’on considère comme condition sine qua non de la réussite. Pour cela, je me suis inspirée de Karima Silvent, DRH Monde d’Axa. La leçon de vie qu’elle a mis le plus de temps à apprendre ? Arrêter de se battre sans arrêt pour aller toujours plus loin et profiter des petits plaisirs de la vie.
Article écrit par Anaïs Koopman et edité par Nitzan Engelberg - Photo Thomas Decamps pour WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : Mutations

Pauline Rochart : « Quitter la capitale, c’est troquer l’ambition pour l’ancrage »
Ils ont quitté Paris et les grandes villes pour retrouver leurs racines. Zoom sur ce retour aux sources avec Pauline Rochart.
20 févr. 2025

« Qu'est-ce que tu veux de plus ?! » : infos et absurdités sur la parité
« Avant 2022, il y avait plus d’hommes prénommés « Thomas » que de femmes dans les conseils d'administrations des grandes entreprises allemandes ! »
16 sept. 2024

David Le Breton : « En entreprise, nous sommes dorénavant seuls, ensemble »
« Il n’y pas pas d’éthique sans visage. » David Le Breton livre ses inquiétudes sur la qualité de nos relations au travail à l'ère du numérique.
23 juil. 2024

Société du matching : pourquoi la vie pro ne doit pas ressembler à Tinder
Pour Philippe Steiner et Melchior Simioni, le matching moderne dans le monde du travail individualise et dissout les collectifs. Tribune.
04 juil. 2024

« La valeur travail, qui nous pousse à produire toujours plus, c’est une arnaque ! »
Lydie Salvayre critique la valeur travail et prône la paresse dans son nouveau livre, questionnant notre rapport au travail et au bonheur.
17 juin 2024
La newsletter qui fait le taf
Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.
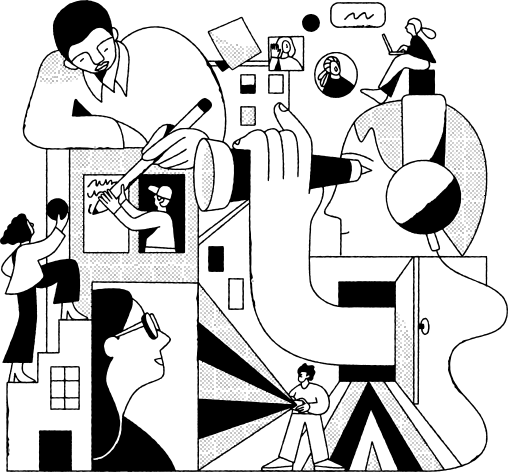
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?
Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.
Explorer les jobs