Désillusions : ils pensaient que leur métier changerait le monde... puis ont déchanté
27 mai 2024
7min

Préserver l’environnement, visibiliser les minorités, lutter contre la précarité… Certains salariés s’élancent dans leur carrière avec l’espoir de faire bouger les lignes. Au risque d’aller au-devant d’une cuisante désillusion, une fois confrontés à la réalité du terrain.
La fameuse « quête de sens ». Nouvel Eldorado du boulot, cet idéal au parfum capiteux pousse de nombreux employés vers les rivages de professions « engagées ». Avec, à l’horizon, la réjouissante perspective d’un monde qui, à force d’efforts et d’investissements, pourrait devenir « meilleur ». À moins qu’il ne s’agisse que d’un mirage ? Car entre le fantasme de « faire une différence » et les marges de manœuvres réelles, une fois en poste, il existe un fossé qui a tôt fait de conduire au désenchantement. Cette amère prise de conscience, trois employés nous en détaillent l’épreuve, entre cruelles déceptions, noires colères et… reculs assagis. Récits.
« Constater que l’écosystème dans lequel vous travaillez est si incohérent qu’il met en danger les personnes à qui vous prétendez tendre la main m’a poussé à l’écœurement - et au burn out »
- Camille, 31 ans, coordinatrice sociale
Même si je suis moins idéaliste qu’à mes premiers pas dans le métier, ce coup-ci, je n’ai pas pu réfréner mon enthousiasme. Il y a deux ans, une structure associative a créé un poste pour moi. Objectif : modéliser un mode d’intervention à la fois pour les professionnels et les « usagers », dans le champ de l’addictologie. Grosso modo, nous voulions accompagner des structures comme celles liées à l’hébergement d’urgence dans la prise en charge des toxicomanes. À mes yeux, il s’agit d’un enjeu de santé publique, alors j’avais évidemment hâte de mettre la main à la patte. D’autant qu’on m’avait promis carte blanche, dans une structure bien dotée, où j’étais donc censée avoir beaucoup de marge de manœuvre. Mais je me suis progressivement retrouvée sous la direction de personnes qui viennent du milieu du commerce, sans la moindre connaissance de notre public, ni du domaine médico-psychologique. Ce qui n’est pas le cas de nos managers direct, anciens travailleurs sociaux. Le haut de la hiérarchie gérait l’association comme un business - et c’est tout. Et puis il y a ce problème de fond, aux résonances kafkaïennes : on travaille sous perfusion d’argent public, alors même que l’État est responsable d’un phénomène de marginalisation, et de précarisation, qui pousse les concernés - réfugiés, personnes atteintes de troubles psychiatriques… - dans la gueule de la poly-addiction. C’est un peu le serpent qui se mord la queue. On a tôt fait de se dire : au fond, à quoi bon ?
Si c’est ainsi que le système fonctionne, ce n’est certainement pas nous, petite équipe de coordinateurs, qui changeront la donne. Une réalité sévère, qui fait aussi l’effet d’une leçon de modestie : au fond, nul n’est un super-héros. Pour trouver une forme de valorisation reste, quand même, les petites victoires. Psychologiquement, j’ai tenu le coup en me répétant que ce que je faisais avait du sens, puisque les retours des usagers étaient positifs. Seulement voilà. En début d’année, une ligne rouge a été franchie. Nos financements s’arrêteront bientôt, et il a donc fallu monter un nouvel appel à projet dans le cadre duquel j’avais fait remonter les stratégies qui fonctionnent - ou pas. Aucune de mes préconisations n’a été prise en compte. La claque. J’ai été envahie par le sentiment de travailler « dans le vent », avant de péter un plomb. Épuisement, burn out… Après une période de repos, aujourd’hui, je suis bien forcée de le reconnaître : j’aime mon métier, mais les conditions dans lesquelles je l’exerce m’écœurent. Il y a des décisions prises dans la hâte, une confusion directionnelle qui, maladresse après maladresse, provoque des maltraitances. À l’endroit des bénéficiaires, comme des salariés impliqués. Malgré moi, j’en viens à devenir complice d’un système nocif à l’égard de ceux que nous sommes censés accompagner - et cette pensée m’est devenue insupportable. À tel point que j’ai besoin d’un changement radical. Une reconversion vers un travail plus « léger » dans le secteur marchand, peut-être ? Histoire de savoir pourquoi je bosse. Et de me reposer, enfin.
« Quand tu travailles dans une structure humanitaire à l’aide de subventions octroyées au compte-goutte par des États qui poursuivent, eux, des objectifs intéressés, ça a de quoi dégoûter »
- Isabelle, 40 ans, représentante d’une ONG de développement en Afrique
Au début, bien sûr qu’il y a ce rêve de « changer les choses ». Sinon tu ne te lances pas dans l’humanitaire. Après avoir découvert l’Afrique dans ma jeunesse, j’ai réalisé que je souhaitais œuvrer dans des missions qui ont « de la valeur ». Lutter contre l’excision, les mariages forcés, la pauvreté… Raison pour laquelle je me suis détournée du secteur privé pour aller vers l’associatif, en pensant - naïvement ? - que les codes seraient différents. Moins rapaces, plus « justes ». Grossière erreur. Voilà la vérité crue : secteur du développement non-lucratif et entreprises à but marchand fonctionnent de la même manière. Il y a de vils calculs de rendement, une course effrénée à l’économie. Nous sommes en concurrence non stop contre d’autres structures associatives pour recevoir des fonds, et décrocher des appels à projets - quitte à user de subterfuges louches. Admettons que votre structure remporte les fonds, vous aurez tôt fait de vous dire « jackpot ». Le feu vert tant attendu pour pérenniser des projets de long-terme, quoi. Sauf que non. Voilà seize ans que je gère des projets, et j’ai tôt compris que nous étions des pions aux mains des bailleurs de fond. C’est à eux qu’il revient de décider quelle mission pourra se poursuivre, où s’arrêter du jour au lendemain, sans concertation de notre part - ni enquête sérieuse auprès des bénéficiaires. Sans doute parce que ces « financeurs » ont des intérêts tout autres que ceux de la population, au fond. Exemple : l’UE avait débloqué des sommes conséquente pour le Sahel, au moment de la flambée du terrorisme dans la zone - mais moins par élan altruiste que pour juguler les flux migratoires. Tout ça relève d’un cynisme monstre, c’est ainsi qu’il faut l’accepter. Notre monde n’est pas celui des bisounours, et le secteur associatif ne fait pas exception - jusqu’à son fonctionnement en interne, d’ailleurs. À plusieurs reprises, j’ai mis au jour des dysfonctionnements. Du vol, des détournements de fonds… Tout ça dans une structure qui ne cesse de prôner la « transparence », « l’exemplarité » ! Cumulez la frustration de ne pas pouvoir faire aboutir les projets qui vous tiennent à cœur faute de moyen, le climat de méfiance au sein des ONG, les instrumentalisations des politiques et vous obtenez un tableau bien terne. D’évidence, ce que j’étais venue chercher en Afrique, je ne peux pas le mettre en œuvre aujourd’hui. Pourtant, pas question de changer d’activité, ni de partir : j’y suis, j’y reste. Et après tout, il me reste encore un peu de marge de manœuvre ; en parallèle, je travaille bénévolement dans une autre boîte dédiée aux enfants des rues, où je retrouve - enfin ! - un rapport concret, direct, avec la population. Tant pis pour la fatigue, et les horaires à rallonge. C’est ainsi que je trouve mon point d’équilibre : il ne sera pas dit que je me laisserai abattre.
« Aussi paradoxal que cela puisse paraître, face à l’embrasement des conflits cultivé par notre système judiciaire, j’ai compris que pour rendre une justice fidèle à mon idéal, j’allais devoir rendre la robe d’avocate »
- Meriem, 31 ans, médiatrice professionnelle
« Quelle vision de société désires-tu défendre ? » C’est la question à laquelle j’ai souhaité répondre, en poursuivant des études d’avocat, puis en endossant la robe dans le droit civil. Au début, j’avais en tête une image de probité immaculée. Une justice accessible à tous, qualitative… Autant le dire d’emblée : si vous partagez ce fantasme, ne suivez surtout pas ma voie. Tout simplement parce qu’à mes yeux, « l’avocat » n’a rien d’un pacificateur. On attend plutôt de lui une approche véhémente, et agressive, qui vise à « remporter le procès » - parfois « coûte que coûte » - plutôt que « résoudre les conflits ». J’en eu vite la démonstration. En début de carrière, et alors que j’exerçais en libéral au sein d’un cabinet - où l’on me surnommait « la diplomate », comme par hasard -, j’ai voulu négocier mon salaire. L’idée a été bâclée d’un revers de la main et après avoir annoncé mon intention de partir, tout s’est envenimé. Ma supérieure a refusé de me payer mon préavis, puis l’affaire a atterri au tribunal. Là, j’ai assisté à un déferlement de hargne, et de coup bas. Avec de fausses accusations de détournement de fond, des phrases piquantes… Ça a été le déclic. Plutôt que de contribuer, moi aussi, à un système judiciaire qui exacerbe les conflits en ne pensant qu’à la « victoire du verdict », il fallait que je change de logiciel. En misant sur les dénouements pacifiés, grâce aux négociations à l’amiable. C’est une alternative qu’il y a urgence à considérer. Après tout, en l’état, notre système judiciaire est défaillant : 53 % des français n’ont pas confiance en lui, et n’importe quel justiciable s’en saisit au moindre problème. C’est une manière de déléguer le problème, de se dé-responsabiliser en laissant nos institutions résoudre des problématiques pourtant personnelles. D’ailleurs le mot « résoudre » est-il vraiment adapté ? Lorsque des voisins en arrivent au tribunal, que l’un des deux est condamné à payer une amende, et que leur proximité les condamne à continuer à se voir, peut-on sérieusement imaginer que le conflit soit « dénoué » ? En vérité, cette justice-ci, qui punit via des intermédiaires au lieu de pousser au dialogue, a plutôt tendance à embraser les haines. Pour faire advenir un modèle de société à même de cultiver le « vivre-ensemble » dont il tresse tant les lauriers, il est impératif d’investir les justiciables dans leur conflit, les faire contribuer à la « solution ». C’est la voie que j’ai essayé d’emprunter durant des années en orientant mes clients vers la négociation - en vain, la plupart du temps. Une fois devant le juge, il n’y a plus qu’à dégainer l’épée et à ferrailler. Mois après mois, ces luttes incessantes ont provoqué un profond découragement. Au point qu’il me soit devenu impossible d’exercer. Je devenais déloyale à l’égard de mes clients ; alors que je leur répétais que je ferai « tout mon possible », au fond, je savais que je n’en avais plus l’énergie. Alors j’ai quitté la profession, pour lancer ma propre start-up de résolution des conflits, à destination des salariés d’entreprise. L’idée étant de proposer un accompagnement pour restaurer la communication entre les partis afin d’éviter, précisément, d’en arriver à l’arène du tribunal, dans laquelle j’ai si longtemps combattu. Et pour la première fois depuis longtemps, j’ai le sentiment d’être à ma juste place.

Inspirez-vous davantage sur : Evolution de carrière et mobilité
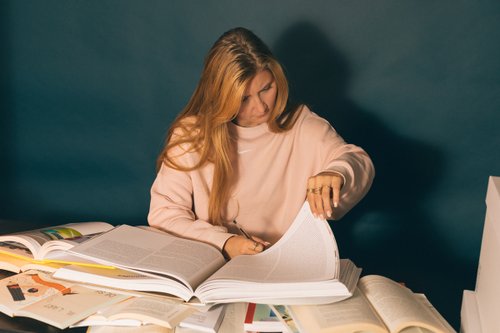
Reprise d’études en cours de carrière : tout ce qu’il faut savoir
Parce qu'il n'est jamais trop tard pour devenir ce qu'on aurait pu être !
28 nov. 2024

Pas d'augmentation : et si c'était votre job qui était « trop petit » ?
Non, ce n'est (peut-être) pas vous le problème !
27 nov. 2024

Réussite ou burn-out ? Ce qui vous attend cette année selon votre signe astro
Vous êtes lion ? Aïe...
11 sept. 2024

Au travail, plus vous accumulez des « bons points », plus on vous donne des libertés
Découvrez comment ce phénomène, baptisé « crédit idiosyncrasique », peut influencer votre carrière.
10 sept. 2024

Atteindre le sommet de sa carrière, et après ? Ils témoignent
« J'irai au bout de mes rêves ». Et après ?
16 juil. 2024
La newsletter qui fait le taf
Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.
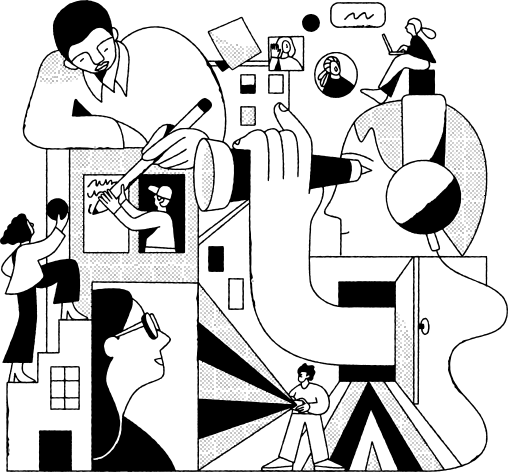
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?
Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.
Explorer les jobs

