Banque d’affaires : bienvenue dans la semaine de 120h
24. 3. 2021
8 min.


Coordinateur éditorial de Welcome to the Jungle France.
Cet article a été initialement publié dans le magazine n°5 de Welcome to the Jungle, paru en mars 2020. Pour vous le procurer, rendez-vous sur notre e-shop].
Dans un document Powerpoint publié le 18 mars 2021, de jeunes analystes de Goldman Sachs décrivent des conditions de travail « inhumaines » et « abusives ». En cause ? Des semaines de 105 heures, des deadlines incompressibles et des nuits tronquées à 3h du matin. Étonnant ? Pour vous peut-être mais pas pour le secteur de la banque d’affaires qui affole les compteurs depuis les années 90 où les employé.es pointent régulièrement à plus de 100h de travail par semaine. Mais quelles sont les raisons qui amènent les banquier·e·s à trimer comme jamais ? Réponses avec celles et ceux qui ont quitté le milieu ou qui y sont encore.
Paul (1) commence par s’excuser. Cela fait trois fois qu’il repousse l’entretien. La période est compliquée. « On a des deals extrêmement délicats à gérer, c’est toujours comme ça en début d’année », lance-t-il en validant son pass Navigo. Le jeune Parisien de 25 ans s’est décidé à parler au téléphone, entre deux métros. Il est attendu chez des amis, et il a déjà 1h30 de retard. Si Paul est un homme pressé, c’est parce qu’il travaille dans le monde de la finance, qui en plus de ne pas avoir de visage, n’a pas d’horaires. Surtout dans la branche que notre homme a empruntée, réputée comme la pire : la banque d’affaires et plus précisément la fusion-acquisition, ou la « fusac » ou en VO, le M&A (pour merging and acquisitions). Un milieu où les employé·e·s bossent régulièrement plus de 100h par semaine.
Banque de temps
À l’entendre, rien ne prédestinait Paul à faire des journées de 14h. « Je vivais le truc au jour le jour », explique-t-il après avoir résumé son parcours à la vitesse de l’éclair. Quand il débarque à HEC – « cheveux longs et 36 bracelets au poignet » –, l’étudiant n’a jamais entendu parler de M&A. Poussé par le prestige du secteur et ses camarades « à fond dessus », il postule dans les grandes banques d’affaires comme Goldman Sachs, Rothschild ou UBS. La suite, c’est l’histoire d’un engrenage. « Tu commences en stage et tu sais que tu vas bosser comme un malade. Mais quelque part, tu t’en fous de bosser toute la nuit du dimanche au lundi », commence-t-il. C’est une fois embauché que ça se corse. « Le premier signal, c’était le jour de mon anniversaire il y a deux ans, décoche-t-il. 50 personnes m’attendaient dans un bar pour le fêter mais c’était à la fin d’un gros projet. J’ai fini à 3h du mat’, je n’ai même pas pu y aller. » Depuis, le jeune banquier de 25 ans s’accroche malgré pas mal de nuits blanches, quelques endormissements et un petit burn-out. Enfin arrivé en bas de chez son ami, une chose est certaine devant l’interphone : il se donne encore deux ans maximum.
Aucune étude officielle ne s’est penchée sur le rythme de travail d’un milieu aussi singulier et opaque que celui de la fusion-acquisition. Pour trouver trace d’une étude, il faut traverser l’Atlantique et se pencher sur le travail d’Alexandra Michel. En devenant enseignante-chercheuse, cette ex-banquière de Goldman Sachs a décidé de consacrer sa nouvelle vie professionnelle à son ancien domaine, en étudiant deux grandes banques d’affaires de Wall Street. Pour elle, le constat est sans appel : les employé·e·s y travaillent entre 100 et 130h par semaine. Au bout d’une expérience ethnologique de 9 ans, cette doctorante a popularisé une expression aux États-Unis : « The cult of overwork », soit « Le culte du sur-travail ». Selon Alexandra Michel, la nature même des tâches en M&A impose un rythme de travail infernal : « Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans une salle de marché qui ouvre à 7h et qui ferme à 19h, explique la chercheuse en duplex de Los Angeles. Il ne s’agit pas de traders. En conseillant et collaborant avec des investisseurs qui engagent parfois plusieurs milliards de dollars, les banquiers leur sont absolument et constamment soumis. Et pour leurs dirigeants, ça vaut toutes les raisons de vous réveiller la nuit et de vous faire travailler le week-end. »
Des Powerpoints, un président de la République et l’UGC de la Défense
C’est peu ou prou le même regard que pose Guillaume (1) sur son expérience dans une grande banque d’affaires. Après cinq ans de finance à Paris, il vient de rejoindre une start-up, à 35 ans. Bien heureux de parler au passé d’un « rythme de dingue », il se souvient aussi des « sujets d’importance x 1000 » que recouvraient ses missions. « Quand tu bosses sur des dossiers confidentiels comme la privatisation de La Poste, tu t’y reprends à deux fois, confie-t-il. Surtout là où j’étais, où tu bosses avec des gens très importants qui ont des niveaux d’exigences infinis. Comme ce jeune dirigeant à l’époque, devenu président de la République. » Devant ce genre de managers qu’on appelle aussi « partners », des notions comme la rigueur, la ténacité ou l’abnégation renvoient au minimum syndical. « Cela devient de facto une question d’amplitude horaire, poursuit le startuper. Le temps que tu passes sur tes tâches est vachement lié à ton délivré. Et puis, tu finis par y voir un défi intellectuel… » Le challenge, c’est ce qui a animé Sylvain (1), 30 ans, pendant les quatre ans qu’il a passé chez Lazard, dans le quartier de l’Opéra à Paris. Une institution prestigieuse, connue pour sa minutie. « Je savais qu’en M&A, il n’y aurait pas de jeu de grades ou d’arrangements politiques. Qu’on serait jugés uniquement sur l’excellence au travail », souligne-t-il au téléphone. Quand il rentre chez Lazard, il trouve « un esprit commando » qui lui plaît beaucoup et qu’il associe au service militaire : « On est tous dans le même bateau, on souffre ensemble. » Guillaume, qui a troqué le costume pour le hoodie, décrit plutôt « une ambiance de vestiaire ». « Il y a un effet d’entraînement qui te fait tenir. Quand il est minuit et que tu vois ton voisin trimer sur son dossier, ça justifie aussi le fait que tu le fasses. La banque se nourrit de ça. »
Et nourrit parfois ses employé·e·s. Sylvain, qui a rejoint un fond d’investissement depuis, garde un très bon souvenir de son passage en fusac. « Ça m’a donné une exigence de moi-même et une capacité d’organiser mon travail que je ne n’avais pas forcément en école. » Des expériences aussi. Parce que pour justifier leurs nocturnes, les analystes en M&A sont nombreux·ses à souligner le sens et les enjeux capitaux qui gouvernent leur métier. « On te répète constamment pourquoi tu fais les choses, déroule Sylvain. Et puis à 26 ans, tu te retrouves à conseiller la BCE sur la recapitalisation du secteur bancaire portugais. Avec une enveloppe à 12 milliards pour sauver le pays de la banqueroute. » « Ça peut paraître bête, mais tu vois ton travail dans la presse », ajoute Guillaume. En revanche, l’ancien analyste confie paradoxalement que « 90% du boulot était super simple ». « En vrai, la banque d’affaires, c’est des PowerPoint et des documents Excel. Quand tu commences, tu passes ton temps à faire des présentations : tu collectes de la donnée, tu la traites et tu te retrouves au service reprographie à 4h du mat’ », souffle-t-il, confiant qu’il s’autorisait même la séance de 21h à l’UGC de la Défense pendant que son document était passé à la moulinette en réunion.
Et pour quelques dollars de plus
Pour Alexandra Michel, tout est organisé en banque d’affaires pour travailler plus longtemps. « Le prestige, suffisamment magnétique pour aimanter les meilleurs profils capables d’absorber la charge. La culture, suffisamment installée pour que tout le monde suive. Et les salaires, suffisamment importants pour justifier le temps de présence au bureau. » En France, en 2021, on peut gagner 100 000 euros par an, après seulement trois ans d’exercice du métier. Les stagiaires sont indemnisés entre 1500 et 2500 euros par mois. « Tu imagines la promesse ?, apostrophe Guillaume. On te dit qu’en quatre ans, tu peux gagner autant que ce qu’un PDG de PME gagne à la fin de sa vie… » Pour Sylvain, cela ne fait aucun doute : « Aucun secteur ne paye aussi bien que la banque d’affaires. » Alors, diplômes en poche, ils·elles restent nombreux·ses à consumer quelques années de carrière dans le secteur. Bien aidé·e·s par leurs écoles, qui présentent encore la fusion-acquisition comme la voie royale. Selon une étude publiée en 2019 par la conférence des grandes écoles françaises, 40% des diplômé·e·s en écoles de commerce choisissent encore le milieu du conseil et d’analyse en banque d’affaires. Un sacrifice implicite dont on se parle dans les couloirs des bureaux : donner quatre ans, économiser, puis s’exfiltrer et rejoindre un autre pan de la finance.
Aux États-Unis, même phénomène. Alexandra Michel assure que les viviers principaux que sont Princeton et Harvard envoient encore la moitié de leurs contingents de super-diplômé·e·s vers les bureaux feutrés des banques américaines. Et malgré le côté éphémère de l’expérience, la chercheuse démontre que même sur quelques années, le sur-travail fait des dégâts considérables. À l’issue de ses centaines d’interviews avec des banquier·ère·s, elle est formelle : l’espérance de travail d’un banquier en M&A est de 7 ans. « Après, le corps finit par lâcher, plaque-t-elle brutalement. Le manque de sommeil et d’hygiène de vie produit des changements dont les banquiers ne se rendent même pas compte, raconte la doctorante. Un jour, j’interviewe l’un d’entre eux qui avait la photo de quelqu’un sur son bureau. Je lui demande qui c’est et il me répond : “Moi”. Il avait juste pris 27 kilos et perdu tout ses cheveux. » Guillaume se souvient des micro-siestes aux toilettes, mais aussi de quelques malaises vagaux dans les couloirs de son service. « Le pire, c’est qu’on en vient à se réjouir de trucs complètement cons, tonne-t-il. Genre, bosser seulement 4h le week-end. En banque d’affaires, il y a aussi ça : tu vis avec l’illusion d’avoir ta soirée. » Et pour Alexandra Michel, ce rabotage permanent du temps libre est tout aussi pernicieux : « Cela produit des individus qui ne savent pas quoi faire quand ils sont off. Et pire, qui ne peuvent se légitimer socialement que par le travail, là où les autres ont leur famille et leurs amis. »
La promesse de l’offre
Guillaume a quitté Rothschild quand son quotidien s’est mis à friser le surréalisme. Après quelques nuits à s’endormir sur ses documents Excel ou dans les taxis, un déclic matinal le réveille en sursaut. « Je quittais les bureaux à 7h du matin et j’avais un pote en salle de marché qui arrivait à la même heure. Un jour, devant les locaux, on s’est fait un check. J’ai fait : “Wow, allez stop j’arrête”. » Le trentenaire startuper a toujours plus ou moins tenu la charge, sans doute avant l’escalade. « Tout le monde n’a pas la chance de conscientiser son sur-travail, pose Alexandra Michel. Bosser 15h par jour ne fait pas que démontrer votre engagement, il le renforce également. » Tout comme la promesse de gravir les échelons, jusqu’à pouvoir déléguer et se la couler douce. « C’est un mythe !, éructe Guillaume. Tout le monde pense qu’en bossant comme des chiens, on va devenir patron, avoir une secrétaire et qu’on ira jouer au golf. Moi, tout en haut, j’ai juste connu des mecs divorcés avec une hygiène de vie pas possible. » Alexandra Michel, elle, dégaine une autre anecdote, sur l’ancien numéro deux de Goldman Sachs : « À la fin de sa carrière, il souffrait tellement du dos qu’il finissait par gérer des négociations depuis son lit d’hôpital. Parfois, on le voyait en salle de conférence, allongé sur la table pour tenir ses réunions. »
Ces épisodes pourraient-ils conduire la banque d’affaires à faire sa mue ? Sylvain, qui a gardé pas mal de contacts dans le secteur, en est certain : « Les RH, jadis invisibles, commencent à jouer un rôle de plus en plus importants dans le contrôle du temps du travail. Une nouvelle fonction est aussi apparue, celle du staffer qui distribue les projets en fonction de la charge de tel ou tel employé. » Quoi qu’il en soit, pour Guillaume, le milieu sera forcé de faire sa petite révolution : « C‘est un secteur qui n’a plus autant la cote qu’avant. » L’arrivée des startups et la montée en puissance des GAFA ont fini de convaincre les jeunes de préférer d’autres voies que la finance, déjà abîmée par la crise de 2008. Si l’on en croit le baromètre « banque privée » du cabinet Headlink Partners, publié en décembre 2018, seuls 20% des 121 répondant·e·s recommanderaient cette voie à un·e jeune diplômé·e. Alors, les anticipations concernant la difficulté à recruter ou les questions de marque-employeur font poindre des velléités d’innovations sociales qui se nomment télétravail ou droit à la déconnexion. Des notions qui faisaient sourire Paul, alors au bout du fil entre deux stations : « Franchement, je me fais souvent chasser par d’autres établissements qui me parlent de leurs évolutions en interne. Pour juste me dire que c’est cool de bosser chez eux, parce que les gens ne terminent jamais après minuit… » Difficile de deviner ce qui s’organisera derrière les vitres teintées des bureaux de Wall Street ou d’Opéra. Néanmoins, on imagine que le jeune banquier n’est pas prêt d’arriver à l’heure à sa prochaine soirée.
(1) Le prénom a été changé
Suivez Welcome to the Jungle sur Facebook, LinkedIn et Instagram ou abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir, chaque jour, nos derniers articles !
Photo by WTTJ

Viac inšpirácie: Modern Work

Zineb Fahsi : « En entreprise, le yoga est utilisé au service de la productivité »
Et oui, faire un chien tête-en-bas peut être un des signes que le capitalisme vous a eu.
11. 7. 2023

Semaine de 4 jours : « Il faut prouver que c’est possible partout »
Jérémy Clédat et Laurent de la Clergerie ont fait le pari de la semaine de 4 jours dans leurs entreprises. Conversation sur leur retour d'expérience.
11. 7. 2023

Samuel W. Franklin : « Non, tout le monde ne peut (et ne doit) pas être créatif ! »
« Aujourd’hui, tout le monde veut se distinguer en tant que personne créative »
03. 7. 2023

Addiction au travail : « Il faut réfléchir à pourquoi les gens travaillent autant »
« La notion d’addiction au travail en tant que pathologie n’existe pas » - Marc Loriol, sociologue.
30. 6. 2023

Burnout : les salariés ne devraient pas avoir à démissionner pour sauver leur peau
« Le burnout n’a certainement pas pour cause le manque d’efforts, d’investissement ou d’intelligence de la part d’un individu. »
30. 6. 2023
Novinky, ktoré to vyriešia
Chcete držať krok s najnovšími článkami? Dvakrát týždenne môžete do svojej poštovej schránky dostávať zaujímavé príbehy, ponuky na práce a ďalšie tipy.
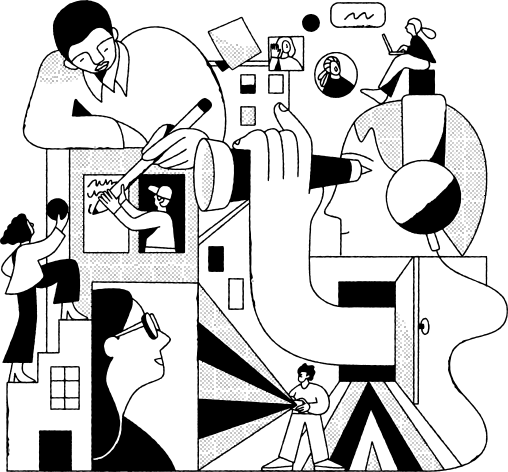
Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?
Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle
Preskúmať pracovné miesta