Paul Magnette : « Pour la moitié des gens, le travail génère de la souffrance »
Mar 04, 2024
6 mins


Journaliste indépendante
Dans « L’autre moitié du monde » (janvier 2024, éd. La Découverte), l’homme politique belge Paul Magnette (Président du PS francophone) invite à repenser la fameuse « valeur travail » et à regarder en face les difficultés, bien réelles, que rencontrent les salariés. À commencer par leurs conditions de travail. Entretien.
Quelle est cette « autre moitié du monde », qui donne son titre à votre livre ?
Ce titre me vient d’une phrase de Rabelais, qui disait: « La moitié du monde ne sait pas comment l’autre moitié vit ». Aujourd’hui, j’entends beaucoup de gens de droite qui donnent des leçons, notamment sur la valeur du travail alors qu’en réalité, ils connaissent peu le monde du travail. Il y a une étude de la Dares qui montrait récemment qu’en France aussi bien qu’en Belgique, seule la moitié des travailleurs se disent heureux et satisfaits de leur emploi. L’autre moitié du monde souffre soit de l’absence de travail, soit de conditions de travail difficiles, soit de la précarité de sa rémunération et de son statut. Je veux que la moitié du travail qui souffre rejoigne les autres dans cette « joie » du travail, d’où le titre du livre.
Vous considérez, c’est la thèse de l’ouvrage, que la « valeur travail » est aujourd’hui dévoyée en Europe. Pourquoi ? Par qui ?
Le travail n’a pas toujours été une valeur. On le considère comme tel depuis assez peu de temps au regard de l’histoire de l’humanité. À la fin du 18e siècle, c’était une corvée réservée aux groupes sociaux considérés comme subalternes : les femmes, les esclaves, etc. Le travail devient une valeur grâce au mouvement ouvrier qui valorise le beau geste, le savoir-faire, l’autonomie de travail… Ce sont des penseurs comme Fourier et Proudhon en France qui théorisent cette fierté du travail. Sauf qu’au même moment, le travail se heurte à une transformation de ses conditions matérielles, qui en font une nouvelle forme d’épreuve.
Aujourd’hui, cette « valeur travail » est dévoyée par la droite. L’ancien Président français Nicolas Sarkozy ne s’en cachait pas, il disait ouvertement que la gauche avait laissé tomber Jaurès et Blum. Sauf que s’il se revendique de leurs noms, il ne reprend pas du tout les combats qui y sont associés. Le fameux « travailler plus pour gagner plus » est une négation totale de leurs combats.
« Il faut mettre fin à ce qui nous empêche d’être épanoui au travail, et dans le même temps faire en sorte que le travail nous prenne moins de temps qu’actuellement. » - Paul Magnette, homme politique.
En France, c’est une valeur que l’on associe à la droite. Vous pensez qu’il s’agit d’une forme de détournement idéologique?
En se revendiquant de la valeur travail, les partis de droite récupèrent l’éthique de travail de la gauche - qui assumait la dureté de son labeur et valorisait l’effort physique - sans reprendre l’aspiration à l’émancipation des travailleurs. En fait, ils reprennent cette rhétorique de l’effort dans une forme de pure instrumentalisation idéologique. J’y vois une manière de dresser les travailleurs aux faibles revenus contre ceux qui seraient « assistés ».
Vous dites que le travail joue un rôle fondamental dans nos vies personnelles et dans la société, et serait même une composante de notre bien-être. Quel est ce rôle?
Il nous définit de manière très marquante, parce que notre place dans la société dépend encore très largement de notre travail, que l’on ait un bon travail ou un travail contraint.
Dans le même temps, vous estimez que les promesses dont le travail est porteur ne sont pas tenues. Pourquoi?
La « valeur du travail » que revendiquait la gauche à la fin du 19e siècle partait du principe que le travail avait un rôle dans notre émancipation, dans le développer de nos facultés, nous permettait de construire des liens sociaux, d’acquérir des droits, de mieux gagner notre vie que la génération suivante, que le futur serait meilleur pour nos enfants… Tout cela reste vrai pour une partie des travailleurs, mais pour l’autre moitié du monde, ce n’est plus vrai ! Pour eux, le travail est contraint. On est même parfois empêché de faire son travail correctement. Le député français François Ruffin le décrypte très bien dans son livre « Mal travail: le choix des élites » (éd. Les liens qui libèrent) : des infirmières lui disent qu’elles n’ont plus le temps de s’occuper de leurs patients, des postiers qu’ils ne peuvent plus se permettre de discuter avec les personnes qu’ils livrent, etc. Tous ces gens ont le sentiment d’être soumis à la pression d’impératifs de rentabilités qu’on leur impose et qui vident le travail de son sens.
En fin de compte, le problème réside-t-il dans le fait de travailler (et d’être le subordonné de quelqu’un) ou dans la manière dont les entreprises d’aujourd’hui traitent leurs salariés ?
Le lien de subordination ou d’autorité n’implique pas forcément un rapport de souffrance. Simone Weil, que je cite longuement dans mon essai, le montre très bien : dans les entreprises qu’elle a observées, les contremaîtres ont un rapport d’autorité aux ouvriers parce qu’ils ont plus d’expérience. Ils sont reconnus par les autres travailleurs pour leur expertise dans le travail sans que cela ne signifie que l’un domine l’autre. J’y vois plutôt une forme de coopération assumée dans laquelle chacun tient son rôle en fonction de son savoir-faire. On peut vouloir que tout le monde n’ait pas le même statut sans que cela ne génère de la souffrance au travail.
« Ce que la jeunesse dit, ce n’est pas qu’elle ne veut pas travailler, mais que le travail routinier l’ennuie, qu’elle a besoin de choses pour s’épanouir ! » - Paul Magnette, homme politique.
Vous expliquez que les salariés souhaitent davantage de liberté dans le but de mieux organiser leur travail, mais pas forcément pour le réduire. Pourtant, on parle beaucoup en ce moment de droit à la paresse et de semaine de quatre jours, pour laquelle vous plaidez vous-même…
Je pense qu’il y a deux choses : il faut mettre fin à ce qui nous empêche d’être épanoui au travail, et dans le même temps faire en sorte que le travail nous prenne moins de temps qu’actuellement. Cela passe par exemple par le droit à la déconnexion, ou le fait de réellement appliquer la semaine de 35 heures… Ce sont des enjeux qui redeviennent très actuels, notamment pour la nouvelle génération. Je vois souvent passer sur Internet des contenus de jeunes américains qui se plaignent du « 9 to 5 » (9 heures-17 heures, ndlr). Ce que cette jeunesse dit, ce n’est pas qu’elle ne veut pas travailler, mais que le travail routinier l’ennuie, qu’elle a besoin de choses pour s’épanouir ! Il ne faut pas tomber dans la caricature de « l’épidémie de flemme » et écouter ce que les jeunes nous disent : ils aspirent à être plus autonomes dans leur travail et avoir plus de temps pour d’autres activités.
Plutôt que de chercher à reprendre le contrôle de leurs emplois du temps, les salariés ne gagneraient-ils pas à se distancier du travail ? En attendre moins et considérer que d’autres choses peuvent être importantes dans la vie ?
La difficulté, c’est que le travail sera toujours indispensable. Le Covid nous l’a montré ! Il faudra toujours soigner les malades, récolter les déchets, s’occuper des enfants, etc. Plus que jamais, nous avons besoin de travail humain. L’enjeu, selon moi, c’est de mieux répartir ce travail socialement nécessaire. D’ailleurs, je ne suis pas le premier à le dire. Au 20e siècle, les penseurs socialistes comme André Gorz imaginaient un système dans lequel chacun s’acquitterait quelques heures par semaines des tâches les plus pénibles, pour éviter une division entre des gens qui ont un travail chouette et ceux qui font les métiers les plus pénibles.
Que proposez-vous pour améliorer le travail ? La démocratisation des rapports de travail semble une alternative importante pour vous, que voulez-vous dire par là ?
Je pense que les salariés doivent s’intéresser très concrètement à leurs conditions de travail. Aujourd’hui, on sait qu’une entreprise publique, si elle a les mêmes techniques de management, peut être aussi aliénante qu’une entreprise privée. Il faut tenir compte de cette évolution et se demander comment trouver de l’autonomie dans son travail et mettre en débat la question du sens de l’entreprise. Il faut discuter collectivement de ce qu’elle produit, comment, ce qu’on fait des marges. Tout cela devrait être démocratisé. Beaucoup de choses changeraient pour le mieux si les travailleurs étaient vraiment associés à ces décisions.
« Si on ne relaie pas la souffrance que le travail génère, la colère des gens qui subissent peut être déviée vers autre chose : des discours contestataires, populistes, etc. » - Paul Magnette, homme politique.
Vous êtes un homme politique, pas un chercheur. Pourquoi écrire un livre sur le travail ?
Avec ce texte, j’essaie de remettre le travail au cœur du débat public, car je trouve qu’on en parle encore trop peu. Or, le travail change très profondément. Le Covid a bouleversé nos manières de vivre le travail et nous avons repris comme si de rien était, alors qu’il y a des tas de leçons à tirer de cette crise. Le travail est toujours très structurant dans nos existences.
C’est pour ça qu’il y a urgence à libérer la parole sur ce sujet et dire la réalité des conditions du travail d’aujourd’hui. Là où certains se contentent de slogans creux sur le travail, nous devons dépeindre la réalité que vit « l’autre moitié du monde ». Pour eux, le travail est pénible. Rien qu’en France, si les gens se sont mobilisés contre la réforme des retraites l’an dernier, c’est parce qu’ils se disaient: « dans ces conditions, on ne tiendra pas ». C’est le rôle de la gauche de relayer cette parole. Si on ne relaie pas la souffrance que le travail génère, la colère des gens qui subissent peut être déviée vers autre chose : des discours contestataires, populistes, etc. C’est notre devoir de rappeler que si les gens souffrent dans leur travail, ce n’est pas à cause des chômeurs ou des étrangers, mais bien à cause de leurs patrons et des facteurs financiers. Il ne faut pas se tromper d’adversaire.
Article écrit par Emma Poesy, édité par Clémence Lesacq pour WTTJ

More inspiration: DEI

« Pour les hommes, se faire coacher peut être considéré comme une faiblesse »
Le coaching révèle des disparités entre les genres. Bien que plus de femmes le recherchent, elles y ont moins accès par le biais des entreprises.
Apr 23, 2024

Le cheveu comme motif de discrimination au travail ? Une loi veut y remédier
Une loi contre la discrimination capillaire pour protéger l'expression individuelle est en débat. Certains s'inquiètent de son effet discordial.
Apr 18, 2024

« Le sédentarisme tue » : quelle(s) responsabilité(s) pour les entreprises ?
95 % des Français sont exposés à des problèmes de santé liés à la sédentarité. Mais est-ce vraiment aux entreprises de s'engager sur le sujet ?
Apr 11, 2024

Dans les campagnes, « les jeunes renoncent très tôt aux métiers désirables »
Les jeunes ruraux font face à des obstacles professionnels. Repenser les politiques est crucial pour éviter leur fuite des territoires ruraux.
Apr 02, 2024

Élise Fabing : « Le travail est le domaine où les femmes ont le plus à gagner »
Dans "Ça commence avec la boule au ventre", l'avocate révèle les difficultés rencontrées par les femmes via ses dossiers les plus sensibles.
Mar 28, 2024
The newsletter that does the job
Want to keep up with the latest articles? Twice a week you can receive stories, jobs, and tips in your inbox.
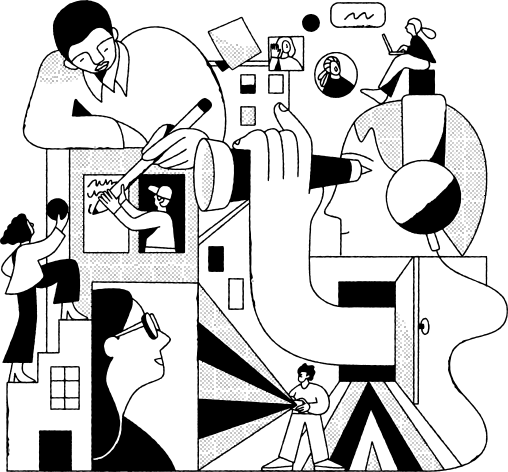
Looking for your next job opportunity?
Over 200,000 people have found a job with Welcome to the Jungle.
Explore jobs