« Je ne vois pas à quoi sert mon travail » : un livre sur le désarroi des cadres
24. 10. 2023
6 min.

Voués à diriger nos grandes entreprises grâce à leur parcours en forme de voie royale, les cadres se retrouvent aujourd’hui confrontés à la perte de sens : une autonomie restreinte, des valeurs écologiques et sociales en contradiction avec le rôle de « pion de l'économie mondialisée » qu’ils occupent. C’est le constat porté par Laurent Polet, professeur de management et cofondateur de l’école Primaveras, qui accompagne des cadres en quête de sens au travail, dans son ouvrage “Le pouvoir, le bonheur, le climat : Le désarroi des cadres” (2023, Ed. du Détour).
Vous avez choisi d’étudier les cadres et leur “désarroi”. Pourquoi s’intéresser d’aussi près à cette population ?
Déjà, parce que c’est une population que je connais bien. Mais surtout parce que je me suis aperçu qu’on en parlait assez peu dans les médias grand public car elle est associée à un statut privilégié. Dans les débats télévisés, on parle plutôt (et c’est légitime) des populations ouvrières ou intermédiaires moins favorisées. On évite de parler de la vie des cadres, qui est peut-être moins glorieuse que la façade qu’on leur attache à travers ce statut lié à des études supérieures puis à des fonctions à responsabilités. Or, le désarroi que j’observe chez eux - pour les diverses raisons que je développe dans l’ouvrage - me semble assez largement partagé au sein de cette population.
Vous pointez notamment une mathématisation d’un travail dans lequel les cadres se trouvent réduits à de simples gestionnaires, dépossédés de leur autonomie et du sens de leur travail, noyés dans un environnement hyper métrique qui décide de tout.
On attache souvent la fonction cadre à celle qui organise, structure ou pense des méthodes pour le travail des exécutants. Mais aujourd’hui ce n’est plus le travail des cadres : on voit que les lignes hiérarchiques sont beaucoup plus plates, qu’il y a parfois une distance avec les exécutants. Le paradoxe qui amplifie cela, c’est qu’on demande à ces cerveaux bien construits de modéliser des systèmes d’informations et de mesures qui, comme une spirale infernale, ne font qu’envahir et alourdir leur univers. Cela crée également un sentiment d’inutilité, de manque de fierté pour le travail final accompli. J’ai voulu montrer à quel point cet environnement hyper-métrique constitue l’alpha et l’oméga de cette population qui doit faire des reportings à la direction. Cela augmente la charge de travail des cadres tout en leur ôtant une part d’autonomie. C’est une tendance qui a pris une ampleur évidente au travers de l’informatique et du digital.
« Le danger derrière, c’est qu’on se retrouve avec une population hyper qualifiée, qui devient un peu étrangère à l’univers dans lequel elle vit, éloignée des couches sociales de la société. »
Vous écrivez : « Nos surdiplômés seraient comme des marins qui resteraient dans leur cabine, les yeux rivés sur les écrans de la météo, comme source unique de décision, sans jamais sortir sur le pont pour observer l’état de la mer et du ciel ». En sommes, les cadres n’arrivent plus à concevoir l’impact de leur travail et sont déconnectés ?
J’aimerais que cela soit entendu comme un signal d’alarme. Il y a une vraie distanciation sociale, une déconnexion. « Je ne vois pas à quoi sert mon travail » est une phrase qui revient souvent dans la bouche des cadres. Le danger derrière, c’est qu’on se retrouve avec une population hyper qualifiée, qui devient un peu étrangère à l’univers dans lequel elle vit, éloignée des couches sociales de la société. Une population socioprofessionnelle avec autant de pouvoir mais à ce point déconnectée du réel, ça doit nous interpeller. Pour certains d’entre eux, il y a un sursaut, souvent caractérisé par le drame écologique que nous traversons. Ils se disent désalignés entre ce qui se joue sur la planète, leur missions quotidiennes et les capacités qu’ils ont. Je pense que nous pourrions faire exactement le même constat sur les enjeux sociaux, de solidarité ou de cohésion sociale.
Concernant le reporting auquel sont soumis les cadres, vous dites qu’il est parfois l’objet de dérives, puisque dans certains cas il conduit à truquer les résultats comme pour le « dieselgate », tant le chiffre semble gouverner aux décisions. Les cadres se retrouvent alors confrontés à des injonctions paradoxales.
Oui et d’ailleurs les cadres ne sont pas dupes. On ne peut pas demander à ceux qui ont fait des études d’être forts en analyse et modélisation et d’un autre côté d’être naïfs sur le décrochage qu’il y a dans de nombreuses organisations entre les enjeux climatiques ou sociaux et la réalité de ce qui est fait au quotidien. Ça crée une mésalliance entre les employeurs et cette population dont on a souvent reconnu une forme de loyauté. Ils ont longtemps été les lieutenants des directions générales mais aujourd’hui cela se fissure et les DG ne le voient pas. Le greenwashing, puisque c’est le terme en filigrane de votre question, cause une forme de connivence ou de résistance, avec des réactions extrêmement variées.
« Si cette population prend conscience que les aptitudes qu’elle a développées pendant ses études peuvent s’exercer dans le monde du travail, elle reprendrait le pouvoir. »
De bon élève à bon soldat, voire lieutenant de la direction, vous opposez l’obéissance ou la loyauté des cadres envers leurs directions, à ce que vous appelez la « compétence de jugement ». Elle serait pourtant l’une des clefs pour permettre aux cadres de retrouver du sens dans leur travail.
Globalement, les bons élèves du système éducatif sont ceux qui suivent l’autorité de l’enseignant. Cette qualité façonnée et valorisée se retrouve dans le monde du travail où l’on attend d’eux une certaine docilité, un respect de l’autorité. Avec le bon sens et les compétences de jugement qu’ils ont développés, on pourrait imaginer qu’ils soient au contraire responsabilisés pour repenser, dénoncer, critiquer dans le sens positif du terme. C’est un peu l’injonction paradoxale « soyez créatifs, soyez disruptifs » qu’on entend dans certaines grandes organisations. Au contraire, on attend d’eux une extrême obéissance et un rôle d’exécutant. Si cette population prend conscience que les aptitudes qu’elle a développées pendant ses études peuvent s’exercer dans le monde du travail, elle reprendrait le pouvoir.
Pour illustrer, vous racontez l’exemple d’un stagiaire chargé de Développement durable sur un chantier, qui se rend compte que les bois utilisés proviennent de forêts menacées et en fait part à sa direction. Vous invitez les cadres à assumer un pouvoir de décision lorsque leurs convictions personnelles sont en jeu. Pour vous, ce sont ces petites touches volontaristes qui sont capables d’impulser le changement ?
Personnellement, je ne pense pas que le changement viendra par le haut, donc oui il doit venir individuellement. Mais pour le moment, quand un cadre s’autorise ce genre d’attitude “poil à gratter”, il n’est pas dans son rôle, il dérange. Je trouve cet exemple du stagiaire en développement durable tellement emblématique de ces indicateurs dits « pastèques », où tout a l’air vert d’extérieur mais, si on gratte un peu, c’est orange voire rouge. Pour moi, c’est symbolique de ce que les cadres devraient être autorisés à faire : exercer une forme d’impertinence. Il est dans l’intérêt de tous, y compris des populations moins qualifiées, que les cadres se réveillent en osent davantage être impertinents.
« Je pense qu’il faudrait d’abord aider ces cadres à faire le constat qu’il y a la possibilité de changer. Le fait que la seule alternative possible semble être la bifurcation, la reconversion ou la démission, crée un état de tétanisation chez cette population. »
Lorsque nous avons rencontré Jean-Philippe Decka pour la sortie de son ouvrage “Le courage de renoncer”, il posait le constat suivant : les jeunes ont une prise de parole plus visible sur ces sujets que des cadres plus ancrés dans des positions de pouvoir et qui pourraient avoir un vrai impact à leur échelle. Comment expliquez-vous ces différences ?
Sur ce sentiment d’action pour la cause écologique, je ne vois pas de nuance générationnelle dans la compréhension et la volonté d’action. À l’inverse, j’ai aussi des étudiants pour qui la transition écologique n’est pas un sujet. Selon les histoires de vies nous n’avons pas les mêmes manières de nous exprimer ou d’agir. Comme phénomène nouveau, nous observons les reconversions radicales de cadres parfois très expérimentés, qui décident de renoncer à une trajectoire plutôt linéaire et confortable pour un travail avec un impact plus visible pour eux.
Vous relayez un chiffre : pour 2/3 des cadres, le premier critère de satisfaction d’un emploi serait les signes extérieurs de réussite et le statut social. Selon vous, cela serait la première des causes d’inertie de cette population ?
Il y a une peur irrationnelle : ce sont ceux qui ont le plus d’atouts d’employabilité qui ont le plus peur de perdre leur job. Ce qui permet au système de tenir malgré un travail parfois harassant, qui peut abîmer la santé, la planète et la société, c’est bien le poids du statut social de la reconnaissance extérieure. Je pense qu’il faudrait d’abord aider ces cadres à faire le constat qu’il y a la possibilité de changer. Le fait que la seule alternative possible semble être la bifurcation, la reconversion ou la démission, crée un état de tétanisation chez cette population. Ils ont parfois cette croyance qu’il n’y a qu’une alternative à leur job bien payé dans une boîte réputée : se lancer dans la permaculture ! Alors qu’entre les deux il y a un large champ des possibles, à la portée de cette population parfaitement équipée financièrement et culturellement. Mais il ne suffit pas toujours de s’investir dans une finalité noble pour être bien dans son travail, c’est une réalité qu’on n’ose pas trop dire. Je croise des personnes qui ont fait le choix de s’engager dans l’humanitaire et qui se disent quelques mois plus tard qu’il leur manque quelque chose dans leur travail.
Jean-Philippe Decka parle du courage de « renoncer » à la voie royale. Vous êtes plus nuancé et évoquez la phrase de de Gaulle : « Le plus difficile ce n’est pas de sortir de Polytechnique, c’est de sortir de l’ordinaire. »
J’ai voulu démontrer que la voie royale n’est plus la promesse d’une trajectoire épanouissante, autonome, sereine et rémunératrice. Il y a de nombreuses fissures, c’est le constat. Mais j’invite aussi à se détacher de celle-ci, à sortir du cadre. Qu’on soit d’accord, je suis convaincu de la nécessité de bifurquer écologiquement mais ce n’est pas forcément cette motivation qui va embarquer les cadres. La radicalité, pour une population plutôt docile, obéissante et formatée au conformisme, c’est une sacrée remise en cause. Si on veut embarquer cette population, il faut lui montrer qu’elle a le pouvoir d’agir, qu’elle comprenne que son propre sort dépend d’elle-même.
Article édité par Clémence Lesacq et Kévin Corbel - Photo Thomas Decamps pour WTTJ

Další inspirace: Working for the planet

Déserter ou s’engager pour changer le monde : le nouveau péril jeune ?
Le chef d'entreprise Hubert de Boisredon cherche à comprendre l'attitude des plus jeunes face au réchauffement climatique.
15. 11. 2023

Fresque du climat en entreprise : en sortir « sonné », et après ?
La "FresqueMania" changera-t-elle le monde ?
06. 11. 2023

« La chaleur tue en silence » : le travail à l'heure du réchauffement climatique
Sans adaptation aux fortes chaleurs, c'est notre productivité mais surtout notre santé que nous mettons en péril.
27. 7. 2023

Et si porter un short au bureau était écolo ?
Parce que dress code et climatisation ne font pas bon ménage.
27. 7. 2023

« Tous les animaux domestiques, le chien y compris, “travaillent” pour l’homme »
La sociologue Jocelyne Porcher nous explique tout.
22. 6. 2023
Zpravodaj, který stojí za to
Chcete držet krok s nejnovějšími články? Dvakrát týdně můžete do své poštovní schránky dostávat zajímavé příběhy, nabídky na práce a další tipy.
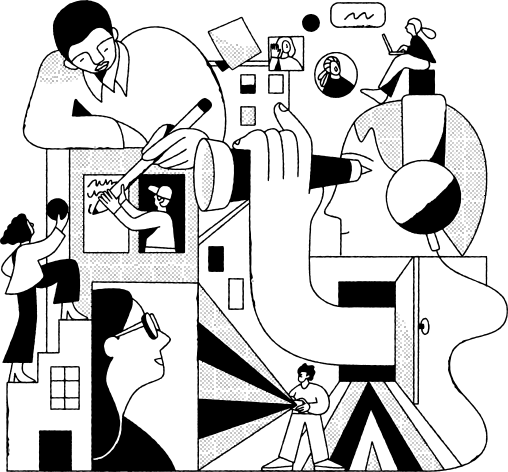
Hledáte svou další pracovní příležitost?
Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle
Prozkoumat pracovní místa




