Pourquoi vos salariés ne sont pas préparés au monde pro (et comment y remédier) ?
02 abr 2024
6 min

Voilà un leitmotiv que l’on entend depuis la nuit des temps (ou presque). Tant du côté des actifs que des entreprises, on regrette l’inadéquation entre la formation initiale et les besoins réels sur le terrain. Alors, comment résoudre l’équation pour augmenter la satisfaction de toutes les parties prenantes ? Décryptage.
D’après une enquête menée par Go1, 46 % des 3 000 salariés américains, australiens et anglais estiment que l’université ne les a pas suffisamment préparés à la vie professionnelle et à leur fonction actuelle. Plutôt que de s’attarder sur la théorie, les principaux intéressés auraient souhaité obtenir davantage d’informations sur la manière de faire évoluer leur carrière, ou encore la façon de collaborer avec leurs collègues. En face, les entreprises ne semblent guère plus satisfaites : selon une enquête menée par Intelligent.com, 4 dirigeants sur 10 estiment que les jeunes diplômés ne sont pas prêts à entrer dans le monde du travail. Ils seraient même 94 % à reconnaître éviter d’embaucher cette population.
Des accusations à l’égard du système éducatif qui n’ont rien de nouveau selon Laëtitia Vitaud, autrice, consultante et conférencière sur le futur du travail, membre du Lab de Welcome to the Jungle : « Durant la IIIème République, l’idée de l’école était déjà de préparer de bons petits soldats capables d’être bien à l’heure pour faire tourner les usines. » Bien que l’enseignement supérieur français compte des formations très théoriques comme les Grandes Écoles et universités, elle souligne que le système regorge aussi de filières très pratico-pratiques avec des cursus comme les bacs pros, CAP ou tout autre dispositif en lien avec les entreprises. Toutefois, les filières générales attirent encore majoritairement les étudiants : 51,5 % des bacheliers en 2019 contre 48,5 % pour les filières technologiques et professionnelles d’après le Ministère de l’Enseignement Supérieur. Plus intéressant encore, 80 % des bacheliers technologiques continuent leurs études, tandis que le taux de poursuite dans le supérieur pour les bacheliers professionnels a bondi de douze points en 10 ans.
« Les entreprises ont davantage besoin de techniciens que d’ingénieurs »
Pour Matthias Jean, fondateur de Tarentö, un cabinet de conseil RH spécialisé dans la Gen Z, une bonne partie de la problématique réside justement autour de cette poursuite d’études : « Je rencontre de nombreuses entreprises qui aimeraient bien que les étudiants stoppent leurs études à bac +2 ou 3. Par exemple, un jeune en BTS fait ensuite un excellent conseiller clientèle. Job qu’il refusera de prendre s’il poursuit en master. » De même, on sait que les géants du BTP ou de l’industrie ont énormément de difficultés à recruter des profils terrain. Par exemple, dans le cadre de la relance du programme nucléaire, la France manque cruellement de soudeurs. « Si l’on devait grossir le trait, on dirait que les entreprises ont davantage besoin de techniciens que d’ingénieurs, mais les élèves en DUT sont encouragés à poursuivre dans des écoles d’ingénieurs », poursuit-il.
Face à ce constat, Céline Méchain, DRH freelance et membre du Lab de Welcome to the Jungle, s’interroge : outre son rôle d’instruire et socialiser, l’école doit-elle ou non prodiguer des connaissances intellectuelles désintéressées de toute utilité professionnelle ?
« À mes yeux, l’école forme nos jeunes à être autonomes et à savoir réfléchir d’une certaine façon : on ne raisonne pas en droit comme on raisonne en ingénierie. L’école forme également à de grandes familles de métiers. Mais devant la variété des métiers -il s’en crée de nouveaux constamment- et l’opacité de certaines fonctions -qui comprend ce que cache le titre de growth
hacker ?-, l’école ne saurait répondre seule à toutes les attentes des entreprises », analyse-t-elle.
De nouveaux formats d’enseignement qui tentent de résoudre le problème
Face à cette inadéquation, l’alternance est montée en puissance ces dernières années, y compris dans les cursus Grandes Écoles qui se sont, du même coup, ouverts à des profils plus diversifiés. Les hackathons représentent également un bon levier pour faire entrer davantage les entreprises dans les cycles de formation, en proposant aux étudiants de plancher sur de vraies thématiques rencontrées par les structures. Dans le même temps, de nombreuses écoles nouvelle génération ouvrent leurs portes. L’initiative la plus disruptive de la dernière décennie ? La fameuse École 42, née sous l’impulsion de Xavier Niel. En 2013, le fondateur de Free déclarait ni plus ni moins : « Nous allons faire le boulot que l’éducation nationale ne fait pas. » Fondé sur l’entraide et l’autonomie, ce programme mise sur l’auto-apprentissage et la collaboration entre pairs. « Cela permet aux étudiants de développer des compétences pratiques et de résolution de problèmes essentielles pour réussir dans un environnement professionnel », constate Céline Méchain.
Dans le sillage de 42, de nouvelles formations ont pensé des apprentissages extrêmement pratiques pour monter en compétences sur des métiers précis. Par exemple, IconoClass forme au métier de business développeur. Les élèves remboursent les frais de scolarité après avoir décroché leur CDI. 80 % du contenu est dédié à la pratique. Chez Kare School, on se forme en 4 mois au métier de customer success manager. Même chose concernant l’école Gustave pour les plombiers ou encore l’Atelier des chefs pour la pâtisserie. « Ce qui est intéressant, c’est qu’on observe que ces formations concernent un spectre de métiers très différents. Surtout, elles privilégient des formats asynchrones et l’alternance, ce qui permet aux profils en reconversion de pouvoir se former à de nouveaux métiers sans prendre de risques », analyse Matthias Jean.
Vous êtes fier de votre boîte ? Affichez-la sur Welcome to the Jungle !
Le système d’orientation, véritable trou dans la raquette ?
Et justement, on en parle de la reconversion ? Alors que de 25 à 33 % des salariés souhaitaient changer de métier ces cinq dernières années, seulement 58 % de ceux-ci ont suivi une formation pour mener à bien leur projet. Avec ces nouveaux formats courts, le champ des possibles s’élargit donc pour tous ces travailleurs désorientés… ou tout simplement mal orientés à l’allumage ? Selon le dernier baromètre de confiance dans l’avenir de l’Étudiant et Orange, mené par BVA Opinion, les lycéens sont 86 % à s’inquiéter pour leur avenir. Plus de la moitié estiment même que leurs choix d’orientation les « inquiètent beaucoup ».
Pour Laëtitia Vitaud, la question de l’orientation est effectivement centrale lorsque nous abordons le sujet de l’inadéquation entre la formation et le terrain. « Il faut distinguer la formation elle-même des services d’orientation/d’information sur les cursus existants. L’orientation est notoirement déficiente : les gens ne savent pas tout ce qu’ils peuvent faire comme cursus », estime-t-elle. Elle recommande de s’inspirer des associations mettant en relation des ados défavorisés avec des mentors pour leur ouvrir de nouveaux horizons. C’est le cas par exemple de Proxité, qui propose à des actifs de venir mentorer des jeunes issus des quartiers.
On peut aussi s’interroger sur le rôle des stages : leur vocation est-elle de faire découvrir aux jeunes des secteurs d’activité, ou de les former à un métier ? « Les stages sont plus réguliers et présents dans le système éducatif de nos jeunes d’aujourd’hui par rapport aux générations précédentes. Mais seuls les stages d’une durée de 6 mois ou concernant des étudiants déjà avancés dans leurs cursus sont prisés des entreprises. Il faut dire qu’il est difficile d’accueillir dans ses équipes des individus qui ne sont pas destinés à produire et qui prennent un temps précieux aux équipes en place », analyse Céline Méchain. Elle ajoute cependant qu’en matière d’orientation, les entreprises ont leur rôle à jouer en adaptant davantage leur langage aux jeunes. Par exemple, les structures sont encore trop nombreuses à baragouiner sous forme d’acronymes et d’anglicismes devant des lycéens circonspects qui ne comprennent pas la teneur du métier dont il est question. « Il y a un vrai effort de vulgarisation à
opérer », estime-t-elle.
Alors, comment faire pour continuer à connecter les besoins des entreprises avec les formations initiales ? Matthias Jean croit beaucoup au mécénat de compétences, mais dans une version remasterisée. « Aujourd’hui, les procédures sont si complexes que les DRH abandonnent le sujet. Je travaille justement actuellement à créer un outil SAS pour que les travailleurs puissent dégager un dixième de leur temps en entreprise pour donner des cours ou mentorer des jeunes, le tout en maintenant leur salaire grâce à la défiscalisation », explique-t-il. Il ajoute notamment que l’un des soucis majeurs de l’enseignement actuel, comme il est dispensé dans les universités ou en Grandes Écoles, c’est la présence trop faible de professionnels en activité dans les équipes pédagogiques par rapport aux enseignants-chercheurs.
« Les intérêts des individus et des entreprises ne sont pas toujours alignés »
Pour clore ce sujet, Laetitia Vitaud nous invite à prendre de la hauteur et nous interroger en profondeur sur le rôle de l’école. Son opinion ? « La mission de l’école n’est pas seulement de former des travailleurs, c’est aussi de former des citoyens et de développer des capacités cognitives. On travaille la plasticité cognitive aussi bien en faisant des échecs, des maths abstraites ou de la musique, qu’en apprenant le langage informatique en demande actuellement. » Dans un contexte où le cycle de vie des compétences en entreprise ne fait que s’accélérer (5 ans contre 20 ans auparavant), on peut effectivement se questionner sur cette forme de fuite en avant, notamment dans les métiers intellectuels : il y aura toujours un décalage de connaissances entre le moment où un jeune commence ses études et celui où il entre sur le marché du travail.
Dès lors, un parcours « personnalisé » l’est-il pour l’élève ou le recruteur ? « Les intérêts des individus et des entreprises ne sont pas toujours alignés », poursuit l’experte. Et d’ajouter : « Les individus doivent avant tout apprendre à apprendre pour opérer des transitions professionnelles dans leur intérêt à eux. » À l’heure où l’IA toque à la porte de toutes les entreprises, il semblerait que cette fameuse « agilité » soit plus que jamais fondamentale, en tout cas dans la caste de métiers dits
« intellectuels ». Dès lors, on pourrait se dire que les formations qui forment des têtes bien faites et leurs fournissent autant de compétences relationnelles et émotionnelles pour collaborer avec les autres ne sont finalement pas autant à côté de la plaque qu’on pourrait le prétendre… Le débat est ouvert !
__
Article rédigé par Paulina Jonquères d’Oriola et édité par Mélissa Darré, photo par Thomas Decamps.

Más inspiración: Employee experience

7 stratégies de rétention de talents moins couteuses qu'un recrutement !
Recruter un talent, c'est bien. Mais pour notre experte Céline Méchain, savoir le retenir dans la durée, c'est encore mieux !
17 abr 2024

L’autocensure : la face cachée du quiet quitting ?
Pas moins de 38 % des salariés français estiment qu’ils s’autocensurent au travail... Outch !
15 feb 2024

Pourquoi promouvoir un salarié ne suffit pas à le retenir
Promotion ne rime pas forcément avec fidélisation. Découvrez nos conseils pour que les évolutions de vos salariés ne virent pas au fiasco...
11 ene 2024

Rapport d'étonnement : tout ce qu'un nouveau collaborateur peut vous apprendre
Lors de leur phase d'onboarding, vos nouvelles recrues peuvent vous partager des retours précieux sur votre entreprise.
04 ene 2024

Entretien annuel : comment réagir quand vos salariés négocient via leur vie perso ?
Inflation, désir d'achat, bébé en route... managers, découvrez nos 5 conseils pour répondre avec tact à votre équipe.
13 dic 2023
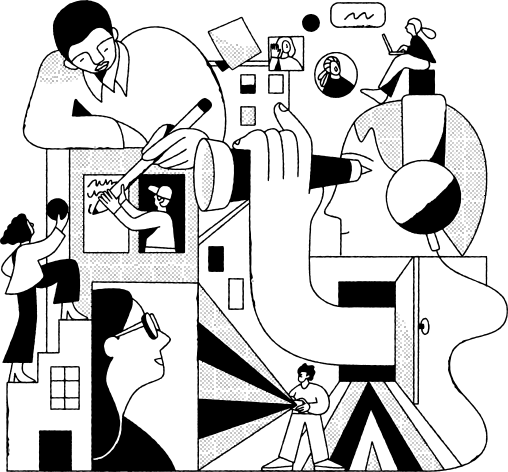
¿Estáis orgullosos de vuestra cultura empresarial?
Dadle la visibilidad que merece.
Más información sobre nuestras soluciones


