« Mon ode au salariat chiant et ringard »
Apr 26, 2024
6 mins

Quand on a un âge qui commence par le chiffre trois, plusieurs choses se passent. Sautiller à un feu rouge habillé en fluo est normal, dépenser 600 balles dans un aspirateur sans-fil Dyson devient une priorité et féliciter outrageusement tout et n’importe quoi sur LinkedIn, un mode de vie. Pour traverser cette crise existentielle, les cadres sup’ porteurs d’Apple Watch se tournent bien souvent vers la seule lumière qu’ils aperçoivent au bout du tunnel : l’entrepreneuriat. Censé être la récompense ultime à leurs années de salariat, un dû situé en haut d’une pyramide de Maslow qu’ils ont eux-mêmes construite, tous aspirent à diriger une entreprise profitable capable de les transformer en hommes riches et accomplis – quant à moi, rester un misérable salarié qui s’extasie de tickets restaurants et de RTT.
Laissez-moi en paix, svp !
Je ne saurais pas dire quand le changement a eu lieu – sans doute vers 2016, entre une vidéo de Maxime Barbier et une annonce pour un stage de “growth hacker” – mais le salariat a été relégué au rang de ces choses ringardes, comme la gyroroue pour aller travailler. LinkedIn, paroisse longtemps dévouée à la vie d’entreprise et à ses happiness managers chargés de nous onboarder, s’est peu à peu convertie à l’entrepreneurship, sans doute beaucoup plus scalable sur le long terme. Et il suffit aujourd’hui de s’y promener quelques minutes pour se faire aspirer par des posts de parcours entrepreneuriaux exceptionnels racontés tel un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle sous cocaïne. Et bien sûr, comment quitter le salariat a été une révélation. Le tout sous un tonnerre de commentaires positifs envoyés par des salariés au bout du rouleau depuis un RER, quelque part en Île-de-France.
Le jour où j’ai failli craquer
Je serais très malhonnête avec vous si je disais qu’il ne m’était jamais arrivé, à moi aussi, d’y penser. Comme tout homme occidental moyen, je peux me questionner en regardant ma machine à laver tourner. Qu’est-ce que je vais faire dans cinq ans ? Suis-en train de faire n’importe quoi ? Dois-je adopter un chien ? Le salariat est-il une forme moderne d’esclavagisme ? C’est comme ça que les vidéos-podcast bros (vous voyez, ce format) font de moi leur pantin chaque matin. Quand les yeux encore collés et courbé devant ma tartine tel un gnome qui attend d’aller à la mine, je scroll sans réfléchir leurs vidéos qui m’expliquent qu’en achetant tous les iPhone d’un pays, ils ont créé un business et sont maintenant millionnaires. Ou que conduire une voiture n’a aucun intérêt car c’est du temps en moins pour « bosser sur son business ». Toutes ces choses qui semblent être plus connes les unes que les autres mais qui, à force de répétition, finissent par agir comme un insecte qui grignote mon cerveau jusqu’à me dire « et si je montais ma boîte ? » (oui, avec le mot « boîte »).
Entreprendre, c’est un peu comme acheter un appart, se marier ou oser sortir une liseuse dans le métro : n’importe quel trentenaire y pense à un moment ou un autre. Soit par pression sociale, soit parce qu’il n’a plus d’objectif dans sa vie en dehors du semi-marathon. Moi aussi, j’ai écouté tous ces gens qui parlent de liberté, de ne plus avoir de patron, de bosser dans une « start-up house » au Costa-Rica. Moi aussi, je me pose des questions sur le salariat. Et puis, dès que je me regarde dans la glace le matin, le visage un peu pâle et que je cherche quelques idées de start-ups, le même phénomène se produit systématiquement : je m’en fous. Non pas que je n’en sois pas capable - mais juste, je n’en ai pas envie. Sans doute parce qu’au fond de moi, j’aime être salarié.
The voice of the voiceless
Je me souviens d’un documentaire, « Attention danger travail » de Pierre Carles, que mon prof de philo de lycée nous avait montré en cours pour nous faire réfléchir à l’intérêt d’une société fondée sur le travail salarié. Ce dernier commençait par cette phrase choc « Travail vient du grec tripalium, un outil de torture ». Si j’ai dans un premier temps eu un genre de « ah ouais quand même », j’avais 17 ans et le sujet me semblait un peu lointain et imperceptible - contrairement à MTV et aux sessions de skate. En 2024, ce film a toujours une résonance particulière, dans un monde où le salarié est encore vu comme un esclave qui bosse pour un patron jusqu’à épuisement et ne trouve aucun épanouissement. Une sorte de croix que l’on doit porter toute sa vie, à moins de connaître un jour les joies de l’entrepreneuriat. Pourtant, j’ai toujours pensé que détenir des entreprises de cuvettes de toilette n’était pas plus épanouissant. Allez savoir.
Être un salarié-esclave n’a pas que des mauvais côtés. Il y a tellement de choses que j’apprécie en étant salarié. Les gens déjà. Pas tous, mais j’ai rencontré des personnes exceptionnelles, devenues des amis, avec lesquels j’ai partagé des moments qui dépassent l’intensité de la réunion « kick-off ». Se rencontrer dans une entreprise, c’est un peu comme se rencontrer au lycée. On se lève le matin et on va retrouver ses potes pour faire des choses parfois intéressantes, parfois non. À la seule différence qu’ils ne vivent plus chez leurs parents et qu’on a plus d’argent. On se crée une vie parallèle, dans laquelle on n’est pas exactement la même personne qu’en dehors. Et le meilleur dans tout ça, c’est qu’on n’est même pas obligé d’en parler - à l’inverse de l’entrepreneur qui ne parle que de son job, ne sort qu’avec des entrepreneurs et ne couche qu’avec des entrepreneurs. Le salariat peut rester là où il est. Un job de cadre reste très prenant, mais je peux rentrer chez moi et ne plus y penser, avoir un semblant de vie en dehors. On peut prendre de la distance avec son emploi, l’oublier, le retrouver, le quitter. Il n’est pas l’objet principal de mon existence - même si pour certains, malheureusement il l’est. Enfin, on peut se libérer de ses responsabilités quelque temps. Ce n’est pas comme si la survie de l’entreprise reposait sur les épaules de trois personnes ivres dans un bar un mardi soir. Il peut y avoir plus de légèreté, de détachement. Tout n’est pas capital sans cesse, tout n’est pas toujours sérieux. Et c’est important. Bon et puis je peux aussi voyager tous les ans également grâce à mes congés payés, discuter de ragots à la machine à café en chuchotant et faire chier les mecs de l’informatique.
Ils pensent à nous mais on ne pense jamais à eux
Ce débat me rappelle l’époque où être freelance était la solution à tous les maux du monde du travail. On vantait leur liberté, le fait de bosser dans un café (chose horrible d’ailleurs) ou encore de pouvoir « choisir ses horaires ». Le freelance était la version cool du travailleur, celui qui gagne plein de fric avec un MacBook hors de prix alors qu’il est finalement en train d’écrire un article pour une somme dérisoire (comme celui-ci) qui ne suffira pas à le faire vivre. Le salariat est toujours le bouc émissaire, le con du groupe qui a oublié de jouer au loto le jour où tout le monde a gagné. L’herbe est toujours plus verte loin du salariat semble-t-il.
Bien sûr, il m’arrive de sentir une pointe de jalousie face à celles et ceux qui lancent quelque chose et deviennent riches. Surtout quand moi je suis dans une réunion où je ne comprends pas la moitié des mots qui sortent de la bouche des intervenants. Mais rapidement je me souviens que beaucoup d’entrepreneurs sont de gros lourds, très souvent uniquement attirés par l’argent. Car quand je les vois parler sur Instagram et LinkedIn, l’argent semble être le moteur à 99% du temps. La réussite. Le succès. Le chiffre d’affaires. La valorisation. Peu importe le business, ce qui compte c’est l’argent. Sans doute une version tronquée liée aux réseaux sociaux, car beaucoup veulent, j’imagine, travailler autrement et faire ce qu’ils veulent. Quoi qu’il en soit, ils ne peuvent s’empêcher une fois la réussite atteinte de pondre des podcast aussi intéressants qu’une trend TikTok. Car le monde a terriblement besoin d’avoir un nouvel entrepreneur qui explique comment il a créé une start-up de location de voiture depuis le BDE de l’Essec via son téléphone, pendant que nous, salariés, on se demandait ce qu’il y avait à déjeuner à la cantine.
Beaucoup se moquent d’une vie d’entreprise, ringardisée autour de la machine à café, des interminables réunions et d’un management un peu absent. Et c’est exactement ça. Mais personnellement je ne la trouve pas plus ringarde que bosser pour une start-up qui veut être leader sur le marché du Poke végé en te faisant bosser dans un pouf. Alors laissez-moi tranquille avec mes tickets-restaurants, mes collègues qui ne payent pas de mine mais deviennent parfois des amis, mes journées de boulot qui ont une fin, les réunions toujours trop longues, les gossips à la photocopieuse, les rencontres fortuites, les pots de départ, les cagnottes de gens que je ne connais même pas, les engueulades de places de parking, les négociations salariales, les congés payés, les RTT et les mecs de l’informatiques qui doivent nous supporter tous les jours. Dostoïevski écrivait « On se demande parfois pourquoi la mémoire s’acharne à retenir certaines histoires aussi anodines que banales. » Sans doute parce que ce sont elles qui bouleversent le plus notre vie.
Article écrit par Paul Douard ; édité par Gabrielle Predko ; Photo Thomas Decamps pour WTTJ

More inspiration: Career switch

« La maternité a ruiné ma carrière » : cadres et mères, elles payent le prix fort
« Quand je vois ma robe d'avocate dans ma penderie, ça me brise le cœur. »
Mar 28, 2024

Carrière & chance : certains salariés ont-ils plus de “bol” que les autres ?
Coup du destin ou simple coïncidence, voyons de plus près l'impact de se trouver « au bon endroit, au bon moment ».
Feb 13, 2024

Validation des acquis de l'expérience : tout, tout, vous saurez tout sur le VAE
Il est temps de faire reconnaître vos compétences !
Jan 30, 2024

Quelle formation pour booster sa carrière : qualifiante, certifiante ou diplômante ?
Quelles sont les différences ? Et laquelle choisir en fonction de ses besoins ? On fait le point.
Jan 08, 2024

Retour de congé formation : « Mon absence suscitait de la jalousie chez mes collègues
Revenir après un congé formation n'est pas toujours une sinécure...
Nov 21, 2023
The newsletter that does the job
Want to keep up with the latest articles? Twice a week you can receive stories, jobs, and tips in your inbox.
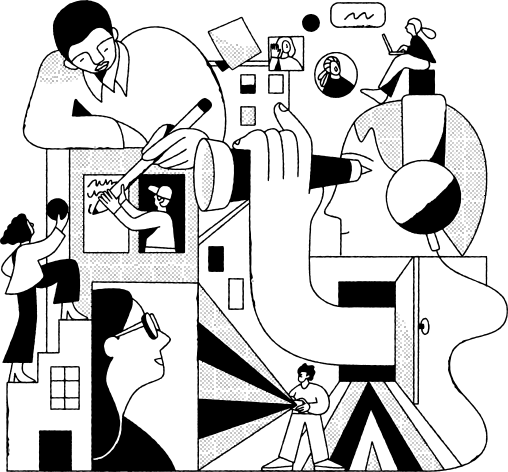
Looking for your next job opportunity?
Over 200,000 people have found a job with Welcome to the Jungle.
Explore jobs

