Anti-taf : quel job ont-ils fini par « supporter » ?
29. 2. 2024
6 min.

Trop prédateur, pas assez permissif… Que ce soit par souci éthique, contestation idéologique ou simple volonté d’indépendance, certains nourrissent une telle aversion pour le monde du travail qu’ils refusent d’y glisser le moindre orteil. Jusqu’à ce que, par surprise et au gré de compromis, ces « antiwork » invétérés trouvent leur match (presque) parfait. Florilège de ces heureuses rencontres.
« En tant que personne neuro-atypique, anarchiste et non-binaire, jamais je n’aurais espéré trouver un environnement de travail sécurisant », Alice, 35 ans, responsable de communication
Je ne suis pas contre le fait de travailler. C’est plutôt notre modèle capitaliste hégémonique, axé autour de l’exploitation, des privilèges de classe et de l’autorité verticale, qui me pose problème. Mais j’ai finalement trouvé une structure alignée avec mes valeurs, auprès d’une association dédiée à la transition socio-écologique qui représente aussi, un environnement de travail safe. Notamment vis-à-vis du handicap que représente, parfois, mon diagnostic de personne HPI (Haut Potentiel Intellectuel) souffrant de TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans hyperactivité). Après des expériences pro douloureuses où l’on me répétait que j’étais « trop sensible », j’évolue aujourd’hui auprès de collègues « alliés ». Ils nourrissent le dialogue sur la neuroatypie, aménagent des horaires souples pour que je puisse cultiver mon activité d’autrice, et me rappellent que ce n’est « pas de ma faute » si j’ai à relever les défis auxquels je fais face. Que ce soit au niveau de l’organisation ou de la plannification. Et puis la dernière fois, ils ont même remplacé les néons d’une salle de réu’ par des petites lampes, pour que je ne me sente pas agressée. Mignon.
« Pourquoi s’abîmer au travail ? Célébrons plutôt la flemme ! », Gaël , 27 ans, planificateur marketing
Mais par quel bizarre tour de passe-passe en est-on venu à attendre du travail de « l’épanouissement » ? Aujourd’hui, les gens se définissent par leur boulot et parlent de « vocation » là où il s’agit toujours, au fond, de labeur. Pour ne pas finir dupe de cette logique d’une course à la performance travestie en goal life, je revendique un « droit à la paresse ». Concrètement : j’assure le strict minimum - quiet quiting à fond -, dans ma « planque ». Une boîte de marketing qui autorise le 100% télétravail et reçoit peu de demandes. Cerise sur le gâteau : mes tâches sont simplissimes. Autant dire que je prends mes aises. Sorry, not sorry, patron.
« Recevoir des ordres, se faire engueuler… C’était juste pas mon truc », Pauline, 28 ans, journaliste indépendante
J’aime faire ce que je veux. Alors dans un modèle salarial où l’on exige notre « formatage », forcément, ça coince. Après un premier CDD passé dans une redac’ à la hiérarchie pas cool, entourée de collègues relous, et bien obligée de bosser sur des actu’ qui ne me motivaient pas, il était évident que j’allais devenir indépendante. Flexibilité horaire, stimulation dans le choix de mes sujets… Une liberté que je chéris, et à laquelle je ne suis pas prête de dire au revoir, malgré une précarité de plus en plus problématique. Autant l’instabilité pécuniaire à 24 ans, il y a un côté roots, un peu yolo. Mais à 28 ans ça devient moins glam’ - voire craignos. Comme si je n’avais pas les moyens matériels de m’engager vers une « vie adulte ». De là à réfléchir à un compromis, qui m’assurerait un plancher financier sans tomber dans les filets du CDI, en écrivant de temps à autre pour un secteur plus porteur, tel que la com’ ? L’idée fait son chemin.
« Quand je sors du métro pour monter sur scène, je me dis que je vais m’éclater avec les potes - et c’est tout ! », Loa, 29 ans, créature de cabaret
Quand j’ai voulu prendre des congés à mon premier CDI et qu’on m’a répondu que c’était injouable, je me suis dit : « Ah mais c’est ça le travail en fait ? Ok, bah, au revoir. » Ou plutôt, adieu. J’ai touché le chômage, puis vécu au RSA avant d’intégrer un cabaret. Plusieurs fois par semaine je deviens une créature sur scène. Je danse, je joue du piano, je raconte ma vie. Le reste du temps, je bosse sur ma musique ou bien… je ne fous rien. Strictement rien. Parce que c’est ça, être une anti-travail pur jus.
« Pour ne pas perdre ma vie à la gagner, j’ai tablé sur le zen », Aurélie, 31 ans, professeure de yoga
J’ai vu trop de proches broyés par le travail. Il y a les cas de burn out, bien sûr. Mais aussi tous ces amis dont la santé mentale a été minée par les harcèlements sexuels, le racisme d’entreprise… Étant de nature anxieuse, je me suis jurée de m’épargner ça, en prenant soin de mon équilibre psy - et de ceux des autres, quelque part - en me lançant à mon compte dans le yoga. Mes journées se résument à des rencontres cool, et des méditations en bord de mer. Que demander de plus ?
« En découvrant l’ampleur des violences policières, j’ai compris que ma place était là, auprès des jeunes », Chelsea, 29 ans, coordinatrice sociale
Je suis de celles qui n’ont jamais trop su ce qu’elles voulaient
« faire de leur vie ». Déscolarisée à 15 ans, j’ai longtemps enchaîné les jobs de misère. Plonge, distribution de journaux… À mes yeux, la vie pro n’avait rien de plus à m’offrir. Alors, j’ai envisagé de vivre en squat et ne vivre que du RSA, avant d’emménager en banlieue parisienne, où je suis devenue coordinatrice sociale. C’est un job difficile. Faute de moyens, on fonctionne en équipe réduite, obligée de bosser sans locaux. Tous les jours, il y a une confrontation directe avec la violence. Les trajectoires brisées des jeunes, la brutalité policière, le racisme systémique… Oui, c’est un job difficile. Mais ce côté « challenge de tous les jours » justement, a éveillé ce qui me paraissait inconcevable, jusque-là : une passion pro. Pas question de décrocher.
« Quitte à subir le sexisme au quotidien, autant rentabiliser l’objectivation de mon corps en devenant TDS », Macha, 26 ans, travailleuse du sexe
À force de voir mes potes galérer dans le monde du travail, j’ai voulu prendre un chemin de traverse, en monétisant du contenu érotique sur OnlyFans. D’abord histoire de financer mes études, puis à la manière d’un projet « pro » à part entière. Pourquoi suer pour des salaires fatalement dévalorisés par rapport à ceux des hommes, quand ces mêmes hommes sont prêts à payer mon loyer ? Tout ça pour un « travail sexuel » qui se résume à quelques photos de ma poitrine postées par mois. L’exploiteur termine escroqué, quoi. Sacrée morale.
« On doit tous bosser pour survivre. Foutu pour foutu, autant viser un job avec des avantages », Hadrien, 35 ans, chargé de programmation
Enchaîner les petits boulots m’a fait réaliser à quel point le monde du travail pouvait être absurde et violent. Journées à rallonge, patrons agressifs, pénibilité… Pour échapper à ce circuit, j’ai creusé mon sillon dans le milieu du ciné, jusqu’à intégrer la boîte d’un grand distributeur. La hiérarchie belliqueuse est toujours là, les horaires extensifs aussi. Mais, il y a un sacré
« mais ». Des places à toutes les avant-premières, une avalanche de billets pour des spectacles de théâtre, de danse… Et il y a même moyen de gratter quelques accréditations au festival de Cannes ! Rien d’idyllique. Disons qu’au bout du compte, je m’y retrouve.
« Confortablement en mairie, je fais mon nid malgré mes incompétences », Balthasar, 30 ans, coordinateur pédagogique
Je suis un « bon à rien » assumé. Je n’ai jamais forcé à l’école, et mes études supérieures n’ont, à aucun moment, servi de tremplin vers la vie pro. C’était plutôt un cadre « idéal » pour enchaîner les teufs l’esprit léger. Il ne s’agissait pas juste de glander, mais d’appliquer une philosophie hédoniste : on n’a qu’une vie, à la durée incertaine, alors autant profiter. Je n’ai fait aucun stage, aucun service civique. À part savoir préparer un Moscow Mule - et encore… -, je n’ai développé aucune
« compétence ». Tétanisé à l’idée des responsabilités qu’implique un contrat de travail, j’ai sans cesse retardé mon entrée dans le monde pro en rallongeant, encore et encore, mes études. Par miracle, enfin plutôt par « piston », j’ai dégoté un travail en mairie. Je suis devenu fonctionnaire, avec tous les avantages qui vont avec. Sécurité de l’emploi, salaire coquet. Et puis surtout, des congés alignés sur ceux des collégiens, puisque je coordonne les projets culturels d’établissements scolaires. Le job est taillé pour moi, en somme. Vivement l’été.
« Chaque interaction humaine étant source de stress, j’ai fui l’open space, en me lançant à mon compte » Nathanael, 34, rédacteur indépendant
Je n’ai jamais reçu de diagnostic lié à ma phobie sociale. Mais le moindre coup de fil suscite de la gêne et un profond malaise à surmonter. Alors dès que ça a été possible, j’ai emménagé dans une petite ville. Là-bas, loin du tumulte des artères routières auxquelles j’étais habitué, je me suis lancé dans la rédaction indépendante, depuis chez moi. C’était la voie royale pour limiter mes interactions sociales, tout en cultivant un travail de plume que j’apprécie. Avec, en prime, un cadre de vie idyllique. Des panoramas montagneux à perte de vue, du soleil toute l’année… Peut-être que mon côté « hermite » paraîtra lugubre aux yeux de certains. Mais à chacun sa manière d’être heureux. Je suis certain d’avoir trouvé la mienne.
« Avec un profil aussi sensible que le mien, l’art était la seule voie possible », Isidore, 26 ans, plasticienne
Je suis trop inadaptée socialement pour rentrer dans les clous de la « vie de bureau ». Rien que de penser aux costards, aux tailleurs, à la novlangue managériale du genre happiness manager… Tout ça me gêne vraiment. Et m’emplit de blues, même. Étant dépressive chronique, m’exprimer - et gagner ma vie - à travers l’art n’était pas un luxe, mais une question de survie. Alors, je vivote en vendant quelques œuvres. Mais c’est une situation si précaire, qu’elle demande un investissement monstre. Demandez donc à un artiste la dernière fois qu’il a pris des vacances ! Ça fera l’effet d’une bonne blague. Mais pas forcément du meilleur goût ; à force de devoir repousser mes limites pour maintenir la tête hors de l’eau, je suis tombée, comme d’autres, dans le piège du workaholisme. Sacrée ironie pour une anti-taff, non ?
Article édité par Gabrielle Predko, photo Thomas Decamps pour WTTJ

Další inspirace: Náš vztah k práci

« Avec l'inflation, mon salaire équivaut maintenant au SMIC »
Avec l'inflation, ces salariés payés au-dessus du smic sont rattrapés par ceux payés au salaire minimum.
25. 3. 2024

Brown out : comment prévenir et surmonter ce syndrome pernicieux ?
Vous connaissez le burn et le bore out ? Gare aussi à son cousin, le brown out...
28. 2. 2024

L'intimidation silencieuse : une forme de harcèlement qui ne dit pas son nom
Linda Valade nous dévoile les conséquences de la communication non-verbale au travail et projette ses espoirs pour le futur du travail.
21. 2. 2024

« Je n’ai pas vu grandir mes enfants à cause de mon travail »
Un jour, le plus jeune m’a balancé « de toute façon t’en sais rien, tu n’es jamais là. »
05. 2. 2024

Anorexie, boulimie... Elles racontent comment les TCA ont hachuré leur vie pro
« Aujourd’hui, la crainte de nouvelles rechutes obstrue mes horizons de carrière. »
18. 1. 2024
Zpravodaj, který stojí za to
Chcete držet krok s nejnovějšími články? Dvakrát týdně můžete do své poštovní schránky dostávat zajímavé příběhy, nabídky na práce a další tipy.
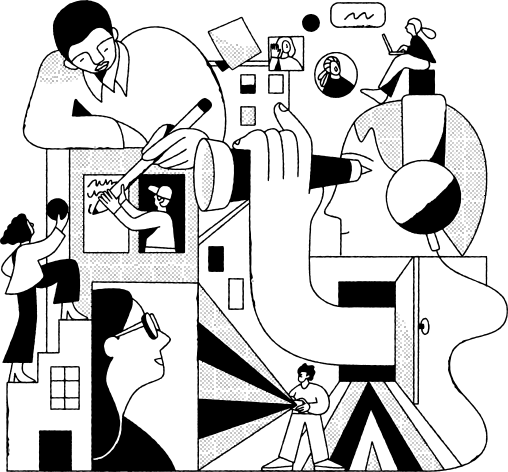
Hledáte svou další pracovní příležitost?
Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle
Prozkoumat pracovní místa

