Turquie : le paradis des développeurs de jeux vidéo ?
11 avr. 2022
8min


Journalist
La Turquie vient de passer deux années mouvementées. En pleine lutte contre le Covid-19, le pays a dû faire face à une crise monétaire qui continue de secouer toute l’économie du pays, du secteur tertiaire aux industries lourdes. Un secteur a cependant résisté et signé une année record en 2020, avec des revenus culminant à 800 millions d’euros : celui du gaming. En juin 2020, le géant américain Zynga, entreprise spécialisée dans les jeux vidéo sur mobile, faisait l’acquisition du stambouliote Peak Games pour 1,65 milliard d’euros, faisant du développeur de jeux vidéo la toute première licorne (une start-up valorisée à plus d’un milliard de dollars) du pays. Les jeux mobiles développés en Turquie ont représenté 20 % des 100 titres les plus téléchargés aux États-Unis en 2021.
Cette bonne fortune a attiré de jeunes développeurs passionnés de gaming et avides de profiter à leur tour d’une manne qui semble toute promise. Mais derrière les paillettes, les chiffres astronomiques et les titres au succès international se cache une dure réalité pour les développeurs, entre journées à rallonge, concurrence féroce et salaires au rabais.
En plein essor depuis une dizaine d’années, l’industrie du jeu en Turquie a décollé en 2020. Le pays est devenu incontournable dans l’hypercasual gaming, ces petits jeux faciles destinés au très grand public, que l’on sort dans le métro, le bus ou le train pour aller au travail : Candy Crush Saga ou Temple Run, pour ne citer qu’eux. En 2020, l’industrie, qui pèse plus de 7,3 milliards d’euros, a recensé 33 % de joueurs dits casuals. Peak Games et Dream Games, deux acteurs turcs dans le secteur du gaming, sont devenus des licornes, et plusieurs autres studios majeurs, à l’image de Rollic, ont été rachetés par des Américains pour des centaines de millions d’euros. Depuis 2015, la Turquie a ainsi attiré 2,2 milliards d’euros d’investissements. Un chiffre qui donne le tournis.
Pourtant, en toile de fond, la Turquie s’enfonce actuellement dans sa pire crise économique en près de vingt ans. L’inflation a atteint 36,1 % en début d’année, un record depuis 2002. La valeur de la lire, la monnaie locale, a chuté de moitié face à l’euro en 2021, suite à une prise de position du président Erdoğan sur les taux d’intérêt, dont la baisse devait permettre une hausse du pouvoir d’achat pour les consommateurs. À la tête du pays depuis bientôt deux décennies, le leader turc est contesté et voit sa cote de popularité baisser.
Des passionnés bien mal payés
Entre mauvaise passe économique et crise du coronavirus, la Turquie traverse donc une période difficile. Mais dans ces temps compliqués, l’industrie du gaming a, elle, bénéficié des réglementations gouvernementales alors en vigueur. À la faveur des confinements et temps de trajets réduits, la consommation de jeux mobiles et vidéo a explosé. Les jeunes Turcs ont alors afflué dans les métiers du secteur, espérant échapper à la récession qui touche leur pays. La crise économique n’est pourtant pas sans effet sur leur industrie. Si certains, plus chevronnés, perçoivent un salaire compétitif, la dégringolade de la lire turque fait fondre le pécule remporté comme neige au soleil. Les employeurs n’ayant aucune obligation d’aligner les rémunérations sur l’inflation, tout, salaires comme épargne, est soumis à une instabilité permanente.
Mete Sezgin, lead game designer et ancien enseignant, témoigne de la difficulté des jeunes développeurs à boucler correctement leurs fins de mois. « Si on fait la conversion en euros, ils gagnent autour de 275 euros par mois. C’est vraiment très peu. Trop peu. La question se pose pour certains de quitter le pays. Un ordinateur qui tient à peu près la route coûte autour de 60 000 lires (4 000 euros) ici. C’est une grosse somme, une porte fermée au nez de ces jeunes motivés. »
La loi oblige les entreprises turques à payer leurs collaborateurs en lire turque, quand les acteurs étrangers peuvent verser les salaires dans la devise de leur choix. La plupart des studios du pays sont encore sous pavillon turc, mais ils sont de plus en plus nombreux à être rachetés par des entreprises étrangères. Ces dernières choisissent souvent de payer leurs équipes en lires turques, cherchant ainsi une optimisation des coûts du travail, aux dépens des collaborateurs, explique Özgü Türk, avocate en droit du travail installée à Izmir. C’est par exemple le cas de Peak Games, premier studio de la capitale.
« Pour les salaires, les entreprises choisissent entre le dollar ou la lire turque. Rien ne force les investisseurs américains, par exemple, à verser les salaires en dollars. La stratégie gouvernementale, celle de l’AKP, est de les attirer dans notre pays en faisant miroiter un droit du travail peu contraignant. L’exploitation des salariés peut tranquillement s’y dérouler. Si la Turquie attire les entreprises étrangères, c’est avant tout en raison du faible coût du travail ici. »
Certaines font l’effort de proposer des contreparties à leurs équipes dans un contexte général d’instabilité, mais les salariés sont nombreux à se sentir exploités. Attila Kabakcıoğlu est développeur de jeux. Il reconnaît que si de nombreux studios sont effectivement pieds et poings liés par la loi, ils ne cherchent pas non plus à partager équitablement les profits avec l’ensemble des collaborateurs. « Les entreprises sont obligées de payer en lires turques d’un point de vue strictement légal. Mais la plupart des fondateurs se gardent quoi qu’il en soit tout le gâteau pour eux, ne laissant que des miettes à ceux qui bossent pour eux. Certains cèdent des actions à leurs collaborateurs ou leur accordent des primes. Mais cela reste vraiment une exception dans le métier. »
Un secteur marqué par l’épuisement
Les jeunes développeurs se ruent souvent vers le secteur du gaming avec une soif de tirer un peu d’argent de leur passion. Ils se heurtent vite à un quotidien pressurisant : on leur demande de travailler beaucoup, et vite. Toujours plus. Avci en a pris conscience lorsqu’il a décroché un poste. « J’ai travaillé dans trois studios en trois ans. Dans le premier, on subissait du harcèlement de la part des directeurs, qui n’hésitaient pas à pousser leurs collaborateurs à la démission. On était payés une misère, graphistes et développeurs confondus. Ils nous traitaient comme des esclaves. Je travaillais vingt heures par jour, je dormais quatre heures à peine – au bureau, affalé sur un pouf. En Turquie, la plupart des jeunes intègrent le secteur du jeu vidéo avant tout par passion. Mais les aspirants graphistes et développeurs sont nombreux. À la moindre contrariété, les patrons peuvent menacer de chercher quelqu’un d’autre, de moins cher, pour faire le taf. Ils s’en servent contre nous. »
Les horaires à rallonge sont le fruit d’une cadence de production bien plus élevée en Turquie que dans les studios européens. L’industrie du gaming turque va vite et broie ses salariés. Comme en témoigne Avci, la charge de travail est intenable. « Le salaire peut être bon, mais en face on te demande de bosser comme un forcené. C’est arrivé à un ami graphiste 3D, à qui son boss demandait de sortir 15 jeux par mois. Dans l’hypercasual gaming, deux ou trois c’est raisonnable. Mais quinze, c’est le burnout assuré. Il y a de quoi craquer, physiquement et mentalement. »
Özgü Türk va dans le même sens : « En Turquie, les conditions de travail favorisent le burnout. Les gens trinquent sur le plan psychologique. Ils se sentent aliénés, comme des machines accomplissant mécaniquement le travail qui leur est dévolu. Ces personnes n’ont plus suffisamment de temps pour elles. Les salariés souffrent de ne pouvoir se décoller un instant de leur travail. Ils deviennent leur travail. » L’avocate décrypte : au poids mental que ces conditions de travail font peser sur les salariés s’ajoute l’illégalité des pratiques. « La loi prévoit un temps de travail hebdomadaire légal de 45 heures, que peuvent venir compléter trois heures supplémentaires maximum, d’après un verdict rendu par la Cour suprême. Ici, les studios exploitent purement et simplement leurs salariés. »
Il faut aussi jouer des coudes pour obtenir et conserver sa place dans le secteur du jeu mobile et vidéo. Un facteur supplémentaire de burnout. On compte 600 studios rien qu’à Istanbul, un chiffre en croissance constante. Les jeunes se bousculent, la concurrence fait rage. Batuhan Avucan, fondateur de Mobidictum, sites d’actualités sur l’industrie du jeu, prévient : c’est marche ou crève. Les idées de l’un seront reprises par un autre, développées avant que leur inventeur ait eu le temps de reprendre sa respiration. « L’hypercasual gaming impose un rythme d’enfer. C’est le nerf de la guerre. Si tu as une idée, quelqu’un d’autre l’a forcément eue aussi. Dès que ton jeu passe en phase de test, il peut être repéré et si ton voisin est plus rapide que toi en programmation, il te pique l’idée. Voilà comment le succès risque de te passer sous le nez, surtout si en face ils ont un budget de communication et marketing plus élevé. Le burnout est inhérent au business model. Les nouveaux studios poussent comme des champignons. Certains produisent quatre jeux par mois quand d’autres en pondent vingt. Quand la vitesse est le critère de réussite numéro un, soit tu te lances dans la course, soit tu quittes la compétition. »
Une fuite des cerveaux inévitable ?
La crise économique et l’instabilité politique qui bouleversent le pays ont conduit à une fuite des cerveaux, avec plus de la moitié de la population se déclarant désireuse de partir travailler ou étudier à l’étranger (enquête MetroPoll). Quitter son pays lui a brisé le cœur, raconte Avci, mais depuis qu’il est en Finlande, il a l’impression de revivre. « Les jeunes diplômés turcs sont extrêmement nombreux à tenter de fuir le pays. C’est triste d’employer un tel mot, mais il s’agit bien de fuite. Et même pour un salaire plus bas. L’argent n’est pas leur unique priorité. Ils cherchent aussi une certaine qualité de vie. Ça me fait mal de le dire ainsi, mais en arrivant ici je me suis senti considéré comme une vraie personne. »
La fuite des cerveaux et le fonctionnement du secteur de l’hypercasual gaming vont sans nul doute continuer de poser problème à l’industrie. Les jeux produits sont par nature simplistes et souvent boudés par des développeurs passionnés en quête d’opportunités autour de jeux casuals plus recherchés ou dans de grosses productions, sur lesquelles la Turquie demeure à la traîne. Journées à rallonge et bas salaires ne font qu’un temps parmi les développeurs ambitieux. Mete Sezgin évoque ses anciens étudiants, qui n’avaient qu’une idée en tête : partir à l’étranger avec leurs compétences sous le coude et leur ambition pour bagage. « Les jeunes développeurs se sentent souvent vite à l’étroit dans le domaine du jeu hypercasual. Ils veulent se tourner vers le secteur du casual ou ce que nous appelons le AAA gaming, les productions des grands studios internationaux. Je les entends tous évoquer leur rêve d’un départ, une fois leur diplôme en poche, vers les États-Unis ou le Canada, comme à Vancouver ou à Montréal, où l’industrie du jeu est très bien implantée. »
Si le boom du secteur de l’hypercasual gaming en Turquie témoigne du talent des équipes sur place, le chemin est encore long avant que les conditions de travail se rapprochent davantage des pratiques européennes en la matière. Certains restent confiants, espérant que les choses bougeront avec le temps. « En Turquie, l’industrie du jeu n’est encore qu’une jeune pousse, observe Batuhan Avucan. L’Europe et les États-Unis éditent d’autres types de jeux, différents de ce que nous savons faire pour le moment. Ça viendra. Le vivier de talents est limité, mais les choses évoluent, de nouveaux genres font leur apparition dans les studios ici. Ils sont en train de défricher le terrain. »
Avci estime que si la situation est compliquée et difficile, c’est le prix à payer lorsqu’on est en phase de forte croissance. « Les salariés de l’industrie du travail ne jouissent pas encore de leurs propres droits. Il n’existe aucun critère de référence, pas de norme établie. Le gouvernement n’y connaît rien à cette industrie ni à son fonctionnement. Et je ne parle pas des syndicats, absents du paysage. Le secteur est en essor depuis peu de temps, c’est très récent, donc il y a forcément des pots cassés. »
Article traduit par Sophie Lecoq ; article édité par Etienne Brichet ; Photo par Thomas Decamps pour WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : A l'international

L’Allemagne teste la semaine de 4 jours: « Le temps libre a une valeur inestimable »
Plus de 30 entreprises allemandes testent la semaine de 4 jours. L'objectif : rendre le travail plus attractif.
02 mai 2024

Rencontre avec « 4 Day Week Global », ceux qui ont impulsé la semaine de 4 jours
Le jeune PDG Dale Whelehan nous explique les coulisses des pilotes "Semaine de quatre jours" actuellement en cours dans plusieurs pays.
15 mars 2024

Vous n’êtes pas une « Girlboss » ? Grand bien vous fasse !
Pour Nadia Shehadeh, il faut déconstruire le mythe de la réussite facile et appeler à une révolution du repos dans nos vies.
01 mars 2024

« Travailler moins ne va pas rendre notre travail plus utile, ni plus valorisant »
Pour la sociologue et chercheure Julia Posca, « travailler moins est une première étape pour construire un autre modèle de société ».
20 févr. 2024

Au Japon, un café vous empêche de sortir tant que vous n’avez pas fini votre travail
Pour le prix d'un café, pas le droit de rêvasser !
22 déc. 2023
La newsletter qui fait le taf
Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.
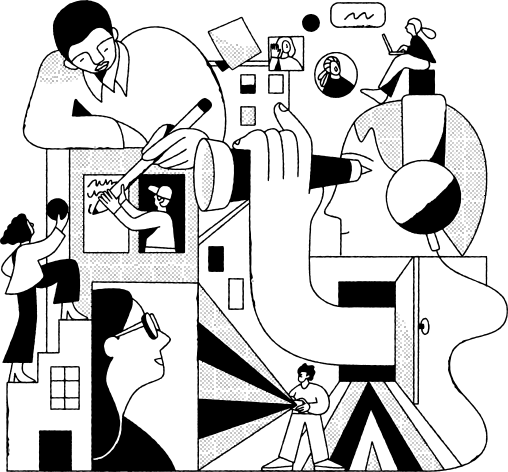
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?
Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.
Explorer les jobs