Anorexie, boulimie... Elles racontent comment les TCA ont hachuré leur vie pro
18 janv. 2024
8min


Journaliste pigiste art et société
En infatigables hantises, les troubles du comportement alimentaire (TCA) assaillent chaque pan de l’existence - sphère du travail comprise. Une irruption persistante, qui parasite le quotidien des victimes et cabosse leur trajectoire pro, parfois au point d’obscurcir toute perspective de carrière.
Faire attention à l’assiette. Qu’il n’y ait ni trop de nourriture, ni pas assez. Prendre discrètement des compléments alimentaires, sourire poliment aux « eh ben, tu vas vraiment manger tout ça ? » des collègues, pour cacher la brûlure de la culpabilité. Être saisi par la honte, prendre peur d’être découvert. Esquiver les déjeuners, souvent - et se faire vomir en cachette, parfois. Sur le lieu de travail, le poids de cette double vie aux allures de parcours du combattant - des réflexions intérieures assassines aux stratégies d’esquive épuisantes - est partagée par celles et ceux qui, dans l’Hexagone, souffrent de troubles du comportement alimentaire. Un mal encore largement incompris, voire tabou, alors même qu’il touche une partie importante de la population - 900 000 personnes, selon les chiffres de la Fédération Française Anorexie Boulimie (FFAB). Entre incompréhension avec la hiérarchie, vertiges du doute et lueurs d’espoir, quatre salariées ont accepté de nous confier l’impact de ces pathologies mentales, vis-à-vis d’exigences du monde pro dont elles relèvent courageusement le défi, crise après crise, jour après jour. Témoignages.
« Au moment des déjeuners, il m’arrive d’aller me faire vomir en secret », Emmanuelle, 45 ans, infirmière atteinte d’anorexie et de boulimie
Je suis comme tout le monde, mais avec ce challenge en plus : devoir reprendre les armes, chaque jour, pour lutter contre mes démons. Il y a l’anorexie, dont j’ai été diagnostiquée à 11 ans et qui passe par des privations de nourriture, et puis ces crises de boulimie, qui se traduisent, à l’inverse, par une consommation à outrance souvent suivie de vomissements intentionnels. À l’origine, j’ai emménagé à Paris pour m’engager dans des études de musique. Mais mes TCA ont fait irruption, provoquant ma première hospitalisation à 17 ans. À cette époque, j’étais si maigre, si fatiguée, que je n’arrivais plus à jouer correctement de mon violon alto. À force d’échouer aux examens, je me suis résolue à une réorientation vers la médecine ; j’ai réussi les concours d’infirmière, ce qui a pavé la voie à une période d’accalmie de sept ans. J’ai cru être libérée - enfin ! Mais mes TCA ont resurgi à l’occasion d’une dépression sévère ; conséquence des traumatismes essuyés au moment de la crise du covid, où j’exerçais comme infirmière en réanimation. Il y a eu une perte vertigineuse de poids, d’appétit. Le retour de la maladie est un boulet qui pèse, évidemment, sur les repas entre collègues desquels je dois parfois m’éclipser pour me faire vomir. Pire encore : mon travail lui-même est impacté. J’ai le sentiment que les TCA accaparent mes pensées et mon énergie, ce qui m’empêche parfois d’aider mes patients à la hauteur de ce que je souhaiterais, lorsque ce n’est pas moi qui suis directement touchée. Après m’être empêchée de manger pendant trois jours consécutifs, j’ai fait un malaise lié à de l’hypotension l’an dernier. Il m’a fallu rentrer chez moi pour me reposer, durant plusieurs jours. Pour pouvoir répondre aux exigences de ma vie professionnelle, qui requièrent beaucoup d’énergie et de concentration au moment des prises en charge, j’ai dû passer à un mi-temps, qui n’est malheureusement pas comptabilisé comme mi-temps thérapeutique, puisque j’ai dépassé les quotas. Ce qui me plonge dans une grande précarité financière. Quant aux perspectives d’avenir… Au total en 2023, j’ai été hospitalisée quatre mois ; j’aimerais évoluer dans ma profession en tant qu’infirmière anesthésiste, ou faire de l’encadrement, mais j’ai enchaîné trop d’arrêts maladie pour pouvoir obtenir le financement nécessaire, même si je réussissais les concours. Aujourd’hui, la crainte de nouvelles rechutes obstrue mes horizons de carrière. C’est une impression qui confine à un sentiment de paralysie dont j’espère me départir, pas à pas.
« Sur scène, je suis terrorisée non-stop à l’idée qu’on me trouve obèse », Sabine, 28 ans, animatrice pour enfants atteinte d’hyperphagie et de dismorphophobie
Pour le dire rapidement : je ne peux pas saquer mon corps. C’est l’effet de ma dismorphophobie, qui me pousse à me trouver grosse - obèse, même - alors que je n’ai jamais été en surpoids, médicalement parlant. Ce sentiment de dégoût face au reflet du miroir est accentué par l’hyperphagie ; c’est-à-dire ma tendance à pouvoir me resservir jusqu’à 5 fois d’un même plat et empiler les desserts, sans aucun sentiment de satiété. Alors que, à l’instar de toutes les filles nées avant l’ère du bodypositivism, j’ai toujours gardé en tête, malgré moi, l’objectif des égéries de magazines skinny, je me suis vite retrouvée à avoir l’impression cuisante d’être un ogre. C’est quelque chose que je vis en solitaire ; par honte, je n’ai jamais consulté de thérapeute - même si ça complique mon quotidien. En tant qu’animatrice pour enfants, je travaille souvent en camping où tous les moments sont partagés - y comprit ceux des repas. Idéalement, si mes collègues étaient au courant, ils pourraient me rassurer step by step en évitant tout commentaire sur le physique, et en optant pour la mise en confiance. Ça peut paraître idiot, mais dire « fais toi plaisir, manges-le ce gâteau, ça va pas te tuer », c’est déjà le début de quelque chose. Voilà pour l’utopie, mais dans la réalité, à chaque déjeuner, il faut me faire violence pour être au diapason des autres, en faisant mine de pouvoir me contenter d’une salade - quitte à compléter ce menu plus tard, en catimini et dans la culpabilité - pour éviter les remarques du genre : « Ah, si tu manges tout ça, tu risques pas d’avoir faim hein ! » Ça m’est déjà arrivé, et même s’il n’y a pas de mauvaises intentions derrière, lorsqu’on est atteint de TCA, ces phrases sont meurtrières ; elles sont littéralement capables de vous anéantir. Et puis, au travail, il y a aussi la violence de la banalisation des remarques grossophobes, la comparaison incessante avec les collègues que je trouve plus minces, et le manque d’écoute des supérieurs. Comme cette fois où mon n+1 m’a reproché d’être « trop sensible », lorsque je lui avais confié mes troubles alimentaires, après avoir fondu en larmes au moment où un de mes collaborateurs a expliqué que j’étais trop « lourde » pour faire un porté sur scène. Évidemment, impossible pour lui de savoir qu’au moment de performer, j’ai toujours l’impression que le public se focalise sur mes rondeurs. De sorte que j’élabore systématiquement des stratégies, histoire d’éviter qu’avec tel costume et dans telle position, je puisse révéler aux spectateurs des cuisses que je tiens en horreur. C’est une charge de travail supplémentaire considérable, ces « tactiques » à mettre en œuvre dans le secret - et dont j’espère pouvoir me départir un jour. Car des solutions existent, et même si le suivi thérapeutique « traditionnel » ne me convient pas, pas question de rester dans l’impasse. Alors j’envisage d’explorer d’autres pistes ; on m’a beaucoup parlé d’hypnose, récemment. Et après tout, pourquoi pas ?
« Sensibiliser à la santé mentale alors que je souffre de TCA, n’est-ce-pas le comble de l’hypocrisie ? » , Macha, 28 ans, responsable en prévention atteinte d’anorexie mentale
À cause de ma condition, j’ai le sentiment que l’ensemble de mon parcours professionnel est hachuré, comme séquencé par des « virgules » de prises en charge médicales. Je souffre d’anorexie depuis 10 ans ; ce qui me donne l’impression d’être dans une forme de prison mentale, où tout orbite autour des chiffres. Les calories, le poids… J’ai été hospitalisée, et régulièrement accueillie en clinique. Il y a eu plusieurs mois écoulés en arrêt maladie, puis des pauses ponctuelles, à la suite de dégradations de mon état de santé. La plupart du temps, lorsque je ne surinvestis pas le travail jusqu’à l’épuisement pour oublier ma maladie, je peine à réaliser mes tâches, tant la fatigue rogne mes capacités de concentration. Plusieurs fois, j’ai cru que j’allais m’évanouir au moment de faire des présentations sur l’enjeu de la santé mentale auprès d’écoles, de collèges, de lycées. Et au moment de prendre la parole dans ce genre de contexte, il y a infailliblement cette petite voix, qui demande : « Es-tu vraiment légitime ? » Une fille atteinte d’anorexie mentale qui prétend offrir des outils de prévention sur la maladie mentale… Quelle ironie. Cette « imposture » est d’ailleurs presque impossible à déceler puisque, alors même que l’anorexie touche au bas mot 1% à 2% des femmes et qu’elle est la maladie psychiatrique ayant le taux de mortalité le plus élevé, ce trouble demeure largement incompris. La majorité des gens restent convaincus qu’il ne concerne que des filles faméliques, au visage creusé et aux côtes saillantes. Par manque d’information, personne n’irait soupçonner qu’avec mon poids, j’en suis atteinte. Raison pour laquelle certaines collègues me félicitent bien innocemment pour mon « self-control », au moment de refuser des desserts par exemple. Elles sont loin d’imaginer que, aussi bienveillantes soient-elles, ces remarques nous « confirment » insidieusement dans notre maladie. Comme si manger devait être source de honte, et se priver de nourriture, un motif de fierté. Une spirale de pensée qui, je le sais, pourrait à nouveau m’entraîner vers l’hospitalisation. Et me faire sombrer, encore, dans ce schéma coutumier balançant entre période de travail, et parenthèse de surveillance médicale. Pour maintenir la tête hors de l’eau - et éviter l’impression de subir une « fatalité » - j’évite de penser au moyen terme, et me concentre sur le moment présent. Celui sur lequel j’ai le plus de prise.
« Pour éviter la gêne des pause déj’ avec les collègues, je suis passée en full télétravail », Chelsea, 25 ans, cheffe de projet atteinte d’anorexie mentale et de dysmorphophobie
Il n’y a pas une seule heure où ça s’arrête. Suite à de sévères pertes de poids l’an dernier, j’ai reçu le diagnostic d’anorexie mentale et de dysmorphophobie. Concrètement, cela implique que je m’empêche de manger jusqu’à l’extrême, et que je ne perçois pas mon corps comme les personnes extérieures ; alors que j’ai bien conscience de ne faire “que” un 34, je me trouve en surpoids. Ce qui provoque des passages au crible permanents. Auto-shaming par rapport à ma morphologie, crainte d’être positionnée de telle manière que mes bras ou mes cuisses paraissent « gros » et j’en passe… Cette sur-analyse fonctionne 24h/24h, 7j/7j et ne connaît aucune frontière ; une fois sortie de chez moi, je l’emmène sur mon lieu de travail. Il faut alors lutter contre des pensées parasites, rester concentrée sur ma tâche. Et puis il y a les moments de convivialité ponctuels, que je préfère éviter. Durant les congés de l’été dernier, je me suis habituée à sauter le repas du midi et désormais, malgré mes efforts, je n’arrive plus à faire autrement. Alors j’ai opté pour un passage en full télétravail, histoire d’esquiver la pause dej’ - et les moments de gêne qui pourraient l’accompagner. C’est une crainte entêtante, alors même que mon entourage pro est non seulement au courant de ma condition, mais a reçu la nouvelle avec bienveillance, ce qui n’avait pas été le cas lors de ma précédente expérience de travail. Au moment d’évoquer mes troubles psy, on m’avait rétorqué qu’il ne fallait pas que je ramène « ça » au travail, et personne ne se privait de commenter mes rendez-vous médicaux, l’air de dire : « Dis donc, ça fait beaucoup ». Comme si c’était quelque chose d’anormal, de déplacé. Voire d’obscène. De la part de l’environnement pro dans lequel je m’investissais, j’étais en droit de recevoir une autre forme d’écoute. Surtout de la part de collègues et de supérieurs issus de générations qui, comme moi, ont été bombardés depuis la naissance de pubs autour de « l’objectif minceur », et été élevés auprès de mères aux yeux de qui, souvent, l’enchaînement de régimes était la norme. Nous avons tous subi cette pression sociale simplement certains, plus que d’autres, en portent les séquelles. Alors pourquoi ne pas faire preuve de compréhension, de solidarité ? C’est à partir de ces bases-ci seulement qu’on pourra faire des bureaux une safe place, que ce soit à l’égard des TCA ou de la santé mentale en général. J’ai la chance d’évoluer dans un tel milieu, où chacun veille à ne pas émettre de jugement qui ajouterait du stress au stress. Pour l’heure, je me sens en sécurité, mais lorsque je pense à l’avenir, impossible de ne pas être effrayée à l’idée de me retrouver, à nouveau, au sein d’une culture d’entreprise intolérante. Isolée, la conscience d’avoir une santé fragile pourrait me freiner dans mes objectifs de carrière ; j’aurai tôt fait de m’auto-limiter, en me persuadant que je n’ai pas les épaules pour assumer telle, ou telle responsabilité. Alors même qu’un simple mot de soutien de la part de collaborateurs pourrait renverser la vapeur, en me faisant réaliser que non, résolument non, face à la maladie, je n’ai pas à me résigner à un parcours professionnel « au rabais ».
Article édité par Gabrielle Predko, photo Thomas Decamps pour WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : Notre relation au travail

« Avec l'inflation, mon salaire équivaut maintenant au SMIC »
Avec l'inflation, ces salariés payés au-dessus du smic sont rattrapés par ceux payés au salaire minimum.
25 mars 2024

Anti-taf : quel job ont-ils fini par « supporter » ?
« Je ne veux pas travailler... » Pink Martini ? Non, « Antiwork » !
29 févr. 2024

Brown out : comment prévenir et surmonter ce syndrome pernicieux ?
Vous connaissez le burn et le bore out ? Gare aussi à son cousin, le brown out...
28 févr. 2024

L'intimidation silencieuse : une forme de harcèlement qui ne dit pas son nom
Linda Valade nous dévoile les conséquences de la communication non-verbale au travail et projette ses espoirs pour le futur du travail.
21 févr. 2024

« Je n’ai pas vu grandir mes enfants à cause de mon travail »
Un jour, le plus jeune m’a balancé « de toute façon t’en sais rien, tu n’es jamais là. »
05 févr. 2024
La newsletter qui fait le taf
Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.
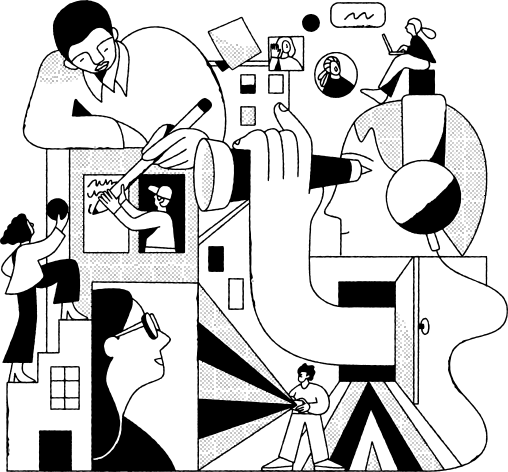
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?
Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.
Explorer les jobs