Souffrances au travail : « Beaucoup de gens, par honte, ne réagissent pas »
19 avr. 2022
7min


Journaliste
Psychothérapeute libérale et en milieu hospitalier, Isabelle Bordat encadre depuis des années les personnes souffrant d’épuisement professionnel. Des souffrances qui ont été exacerbées par la crise sanitaire mondiale. Cette professionnelle de la santé vient de publier un livre au titre évocateur : “Souffrances au travail – Chroniques d’une tempête” (Marie B Eds ). Elle y raconte l’histoire de cinq personnages dont l’expérience vient illustrer ce mal, et donne des outils utiles pour faire face. Le but : permettre aux lecteurs de revisiter leur lien avec le travail et la place qu’il occupe dans leur vie.
Votre livre s’intitule « Souffrances au travail », au pluriel. Quelles sont ces souffrances ?
Souvent, quand on parle de souffrance au travail, on pense au burn out, qui est la plus fréquente. Mais il y a plein de petites choses qui peuvent nous faire souffrir : la perte de sens, les relations inter-personnelles, le conflit de valeurs, le perfectionnisme, le syndrome de l’imposteur, l’anxiété, l’estime de soi…
Votre sous-titre parle, lui, des “chroniques d’une tempête” : pourquoi ce terme de tempête ?
Cette souffrance au travail est vraiment un bouleversement. Il y a souvent un avant et un après. Les personnes qui ont vécu un burn out vivent un tsunami émotionnel, dont elles mettent du temps à se remettre. Comme après le passage d’un tsunami, il faut réparer, reconstruire, mais pas à l’identique.
La crise sanitaire n’a-t-elle pas encore amplifié ce phénomène de souffrance au travail ?
Pour certains pas du tout, mais pour d’autres oui, bien sûr. Les organisations de travail ont changé, certaines personnes se sont retrouvées en télétravail alors qu’elles n’étaient pas équipées, certaines professions se sont retrouvées au cœur de la pandémie. Il a aussi fallu faire l’école à la maison tout en continuant de travailler. On le voit avec l’un des personnages du livre, Sandra First (une surveillante pénitentiaire en proie à un conflit de valeurs, ndlr), il y avait aussi la crainte de transmettre la maladie à ses proches. Ce n’est pas la crise en elle-même qui a rajouté de la souffrance, mais les organisations liées à cette crise qui étaient complexes. On a reçu beaucoup d’informations contradictoires qui ont entraîné de la confusion. Cela a engendré du stress et de l’incertitude en plus de ce que l’on a déjà habituellement dans notre cadre professionnel.
« On oublie que le travail n’est que du travail. On n’y va pas pour chercher de l’affection. Si cela arrive c’est super, mais c’est en plus » - Isabelle Bordat, psychothérapeute et autrice
Votre livre présente cinq personnages aux caractères et à la profession très différents. Pourtant, ils ont tous en commun de souffrir de burn out et de n’avoir pas fait attention aux signes d’alerte…
Beaucoup de gens en souffrance ne réagissent pas, à cause de la honte, la peur de dire non, l’envie d’être aimé. Ce sont les schémas les plus fréquents. Ce besoin d’être aimé et d’être parfait ont encore été accentués par l’arrivée des réseaux sociaux. Nous sommes dans une société extrêmement narcissique : on se filme, on se raconte, on donne la meilleure image de soi, on cherche à exister, à influencer l’opinion.
Existe-t-il des personnalités plus susceptibles de tomber dans l’épuisement professionnel ?
Les perfectionnistes, les personnalités dépendantes ou abandonniques, les personnalités qui ont besoin d’être aimées ou ont besoin de reconnaissance en permanence. Beaucoup recherchent dans leur univers professionnel une validation de leur droit à exister. Ils recherchent une reconnaissance importante qu’ils n’ont pas toujours eu, dans leur enfance, dans leur milieu familial… Mais on oublie que le travail n’est que du travail. On n’y va pas pour chercher de l’affection. Si cela arrive c’est super, mais c’est en plus. La reconnaissance vient surtout par le salaire, les tâches qu’on nous confie, par la confiance qu’on nous accorde. Ce sont aussi nos croyances par rapport au travail qui font cela. Si on croit que c’est un lieu où tout se passe bien, on aura forcément beaucoup de déception.
À force de beaucoup l’entendre, pour des cas très variés, n’a-t-on pas trop banalisé le terme “burn out” ?
Le banaliser je ne sais pas, mais je pense que c’est plus facile pour quelqu’un de dire « j’ai fait un burn out » que de dire « j’ai fait une dépression ». Or souvent l’épuisement professionnel va conduire à la dépression, surtout s’il n’est pas traité.
La façon dont notre société évolue favorise-t-elle le développement du burn out ?
Il me semble que bien que la pénibilité physique du travail ait été largement améliorée au fil de la mécanisation des outils, la charge psychique commence seulement à être prise en compte. L’apparition du numérique est venue complexifier notre rapport au travail : rapidité des échanges, délais raccourcis, distances géographiques abolies… La course au pouvoir et au profit peuvent également mettre à mal les valeurs et le sens du travail que chacun s’emploie à défendre quel que soit son rôle ou sa place.
Existe-t-il enfin une définition reconnue pour cette maladie ?
Oui, mais l’OMS a décidé de ne pas introduire le burn out comme une pathologie. D’ailleurs dans le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et psychiatriques, ndlr ), qui est un peu le catalogue de toutes les pathologies connues, le burn out n’y figure pas. Cela ne veut pas dire que notre société ne le prend pas au sérieux, en témoignent le nombre d’émissions ou d’articles à ce sujet. Il n’est pas reconnu comme maladie professionnelle car il est difficile d’identifier les différents facteurs concourant à son apparition. Mais on peut voir que le débat reste ouvert puisque le candidat EELV à la Présidentielle, Yannick Jadot l’avait introduit dans sa profession de foi comme une mesure qu’il aurait prise.
Dans votre ouvrage, vous évoquez trois questions pour prendre sa température émotionnelle. Quelles sont-elles ?
Elles sont assez simples. La première chose à faire d’abord est : « identifier l’émotion dans laquelle je suis ». La plupart du temps, on est assez neutre, mais imaginez qu’un midi vous soyez stressé. Dans ce cas-là, vous pourrez vous poser la question : « je suis stressé·e, mais à combien sur une échelle de 0 à 10 ? » Enfin, la troisième question va être : « est-ce que là tout de suite mon agacement est justifié ? » On va parfois se rendre compte qu’on est agacé par quelque chose qui va se passer dans plusieurs jours, ou qui a déjà eu lieu. On porte donc sur soi des choses qui n’ont rien à voir avec ce que l’on est en train de vivre. Le fait de s’en rendre compte nous permet d’être un peu plus dans le présent et de se sentir mieux.
Si c’est à nous de prendre notre “température” et comprendre si l’on va bien ou mal, quelle est la part de responsabilité pour les entreprises ?
L’entreprise a évidemment une responsabilité. Il y a des indicateurs qu’elle doit prendre en compte, comme le turnover. S’il est très rapide, on peut s’interroger sur la raison pour laquelle les salariés ne restent pas. Pareil, s’il y a beaucoup de plaintes, des conflits de personnes, l’employeur se doit de les prendre en compte et d’apporter la preuve qu’il a mis en place des stratégies pour que le conflit se résolve. L’employeur doit également interroger régulièrement ses employés sur la qualité de vie au travail, l’organisation, les moyens mis à disposition… Les médecins du travail sont aussi chargés de faire respecter ce bien-être au travail.
« C’est important de se dire qu’on a une place, qu’on est le maillon d’une chaîne, et non quelqu’un dont on peut se passer. Cela redonne du sens, de la fierté, le sentiment d’appartenir à un groupe » - Isabelle Bordat
Plusieurs personnages de votre livre souffrent d’un conflit de valeur dans leur travail. Trouver un sens à son travail est-il une demande réellement grandissante ?
Oui, c’est important pour les gens d’être en cohérence avec qui ils sont. Cela a toujours existé de vouloir donner du sens à son travail, mais les choses se sont beaucoup accélérées. Il y a eu la fracture numérique, le fait d’aller de plus en plus vite, la course aux profits… Cela crée de plus en plus de pression et de tension. Et on voit maintenant, entre la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, qu’on se pose beaucoup de questions sur les délocalisations. On se dit que tout ce qu’on nous a vendu depuis les années 1980 et la mondialisation, ce n’est peut-être pas ce qu’il faut faire et qu’il faut faire un virage à 90 ou 180 degrés. On le voit avec « la grande démission » aux États-Unis. Ce mouvement est petit à petit en train d’arriver en France, car il y a un problème de valorisation de certains métiers. Or c’est important de se dire qu’on a une place, qu’on est le maillon d’une chaîne, et non quelqu’un dont on peut se passer. Cela redonne du sens, de la fierté, le sentiment d’appartenir à un groupe.
Vos personnages sont proches de la quarantaine. Est-ce que cela signifie que la jeune génération est mieux armée ?
Oui, elle l’est. Moi, j’ai 62 ans. Nos mères avaient eu accès à la contraception un peu tardivement et le droit de vote pas si longtemps avant. Donc pour les femmes de ma génération, le travail était une manière de s’affirmer, d’obtenir de la reconnaissance, de développer leur indépendance et d’accéder à des postes à responsabilité. Les jeunes générations, elles, ne se sont pas battues pour ça. Elles sont conscientes de leurs droits, et elles savent mieux s’affirmer et se faire respecter. Elles n’ont pas la même vision du travail, vont oser prendre une année de césure, négocier leur salaire, imposer leurs conditions…
Vous dites que le travail, autrefois considéré comme marqueur social, serait en perte de vitesse, et que la manière dont le temps libre est utilisé deviendrait tout aussi déterminante. Comment expliquer ce changement dans notre rapport au travail ?
Il y a eu dans les années 1980 un grand mouvement d’individualisme, on a beaucoup encouragé les gens à développer les loisirs, comme le sport, ou les arts plastiques. Quelque part, cela devient presque une obligation. Aujourd’hui un enfant qui ne fait pas de musique ou d’activité sportive, on trouvera ça bizarre. Face à ce besoin de temps libre, les entreprises se sont d’ailleurs adaptées. Regardez les startups qui proposent des moments pour faire du sport, un salon de relaxation, une salle de jeux, ou qui proposent la crèche sur leur lieu de travail. C’est d’ailleurs aussi décrié, car c’est un moyen d’inciter ses salariés à rester au travail.
Finalement, pensez-vous qu’il soit possible d’être heureux au travail ?
Il ne faut pas chercher à être heureux, justement ! Le bonheur, c’est en plus. Faire ce qu’on a envie de faire, se sentir bien au travail, au bon endroit, et faire ce qu’on peut, c’est déjà un bon début.
Article édité par Etienne Brichet ; Photos par Philippe Magoni pour WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : Mutations

Anticiper les Jeux : les entreprises et salariés mis à l’épreuve
Télétravail, flexibilité, congés interdits ou forcés : comment les franciliens se préparent à la période des JO.
12 avr. 2024

« Le sédentarisme tue » : quelle(s) responsabilité(s) pour les entreprises ?
95 % des Français sont exposés à des problèmes de santé liés à la sédentarité. Mais est-ce vraiment aux entreprises de s'engager sur le sujet ?
11 avr. 2024

Chanson, livre, série… Comment le burn-out a envahi la sphère culturelle
Le burn-out est de plus en plus courant, donc il n’est pas surprenant que cela se reflète dans la culture. 4 œuvres qui abordent ce sujet.
09 avr. 2024

Les “Fuckup Nights” : ils et elles partagent leurs échecs sur scènes
Pour Pepe Villatoro, cofondateur de Fuckup Nights, éviter l'échec est impossible. Mieux vaut le partager pour grandir.
08 avr. 2024

« Les bureaux sont vides » : peut-on encore se faire des amis au travail ?
Avoir des amis au travail est crucial pour le bien-être mental, mais le télétravail et une culture d’entreprise négative en font un défi.
04 avr. 2024
La newsletter qui fait le taf
Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.
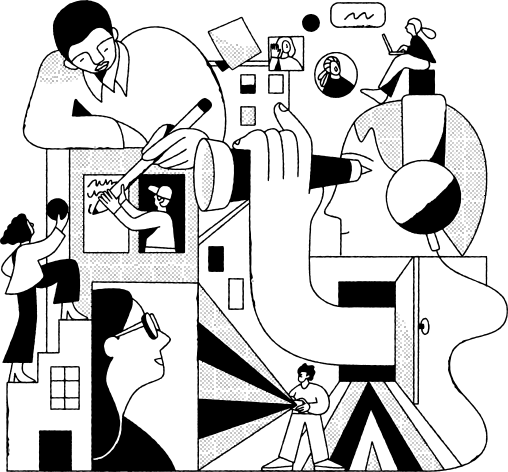
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?
Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.
Explorer les jobs
