Comment le culte de soi a (aussi) envahi la sphère professionnelle
04 janv. 2024
6min

Aujourd’hui, on change d’amoureux comme de chemise, et de travail comme de pantalon. On cherche l’emploi qui nous correspond, le seul et l’unique, en miroir de notre “moi” forcément unique ! Une quête égocentrée, loin du collectif et qui nous rendrait malheureux ? C’est ce qu’affirme l’essayiste Vincent Cocquebert dans son nouveau livre « Uniques au monde » (ed. Arkhê, 2023).
Dans votre précédent essai « La civilisation du cocon » (Ed. Arkhê, 2021), vous mettiez la lumière sur la tendance moderne au repli sur soi. Dans ce nouveau livre, vous affirmez que nous vivons dans l’ère de « l’egocène ». Comment la définissez-vous ?
Ce que j’appelle l’egocène, c’est la période historique que nous vivons depuis une trentaine d’années. La société a beaucoup été vidée de son discours politique, collectif et fédérateur. Une des conséquences majeures, c’est que l’épanouissement de soi est devenu un des principaux buts de nos vies. Comme par appel d’air, c’est cette quête individuelle qui est devenue notre utopie collective.
Vous écrivez que cela amène les individus à se replier sur eux-mêmes. Comment cela se traduit dans le monde du travail ?
Je ne dis pas que les individus sont boursouflés d’ego : le repli sur soi est une réponse défensive, une manière de trouver un appui existentiel en soi-même. Dans le monde du travail, on a moins l’impression d’œuvrer pour un projet commun, de faire partie d’un grand tout où chacun est interdépendant. On se pense comme des électrons libres, désolidarisés du corps collectif. Cela amène davantage de désengagement au travail. C’est maintenant à l’individu de créer ses propres mythologies, ses propres valeurs pour s’épanouir. On n’a jamais autant entendu parler de culture d’entreprise, justement car le sens donné au collectif est beaucoup plus flou.
Le travail a toujours été un moyen de définition de soi : on est militaire, médecin, commerçant, avocate… En quoi notre époque est-elle différente ?
Les corps de métier ont toujours assuré au travail une dimension existentielle, qui structure notre identité. Dans les années 1970, on se définissait évidemment déjà beaucoup par le travail, qui nous donnait un statut. Notre métier était aussi le symbole de l’ascension sociale : un enfant d’ouvrier qui devient médecin ou avocat, par exemple. Ce que je note aujourd’hui, c’est que ces identités sont beaucoup moins stables qu’avant. Les journalistes, par exemple, se reconvertissent en moyenne au bout de 15 ans selon les dernières études. De manière générale, les individus changent beaucoup plus de carrière dans une même vie. Il y a aussi moins de sécurité de l’emploi depuis les années 1980. Comme l’air du temps se durcit, on se replie davantage sur soi par réflexe de protection.
« C’est maintenant à l’individu de créer ses propres mythologies, ses propres valeurs pour s’épanouir » - Vincent Cocquebert, essayiste
Dans cette quête d’un monde à notre image, vous soulignez d’ailleurs le besoin quasi-existentiel que nous avons désormais à nous reconvertir ! Ces quêtes de sens (qu’elles soient d’utilité sociale, pour un équilibre familial, le retour à la nature…) qui nous poussent à tout remettre en cause et à nous comparer parfois trop aux autres nous rendent-elle plus malheureux, selon vous ?
Les individus ont l’impression de pouvoir changer de trajectoire du jour au lendemain. Pour ça, il y a d’ailleurs tout un business, avec les coachs en transformation de carrière par exemple. Le problème, c’est que cela répond à une injonction moderne : « Si tu es malheureux, c’est que tu n’as pas réussi à t’épanouir, c’est de ta faute ! » Alors que les raisons sont peut-être plus structurelles, plus collectives. Tout est mis sur les épaules des individus, qui deviennent totalement responsables de leur sort. Ça entraîne ce que le sociologue Alain Ehrenberg appelle la « fatigue d’être soi », qui génère beaucoup de dépression et d’anxiété. Il y a quelque chose de terrifiant dans la liberté.
Autour de vous, les gens vous semblent donc si malheureux au travail ?
Mon entourage travaille dans le monde de la recherche universitaire ou du journalisme, des métiers à forte charge existentielle. Pourtant, beaucoup se disent : « Ma vie n’est pas là ». Avant, et ce pour toutes les professions, l’intime et le professionnel se mêlaient davantage. L’entreprise était le lieu où on rencontrait son futur mari ou sa future femme, et les études montrent que c’est moins vrai aujourd’hui. Aux États-Unis, on se fait de moins en moins d’amis au travail, et c’est sûrement le cas en France aussi. Donc « malheureux », je ne sais pas, mais on pourrait parler d’un désengagement émotionnel.
Où s’engage-t-on émotionnellement, alors ?
Énormément dans la famille, qui a toujours été une valeur importante mais jamais autant qu’aujourd’hui. On porte beaucoup d’attention aux enfants, qui ont une charge narcissique très forte. Et puis on s’engage dans les loisirs, et dans la consommation qui est devenue davantage existentielle.
« L’entreprise était le lieu où on rencontrait son futur mari ou sa future femme, et les études montrent que c’est moins vrai aujourd’hui. » - Vincent Cocquebert, essayiste
D’après un sondage de l’IFOP que vous citez, près de la moitié des Français et Françaises estiment donner plus au travail que ce qu’ils en tirent. Le chiffre a doublé depuis 1993. En parallèle, vous notez un discours des professionnels RH très centré sur la personnalisation des carrières. Pourquoi cette impression grandissante de subir le travail alors qu’il s’adapte davantage à nous ?
Dans les années 70, le pacte du travail entre le salarié et l’employeur était différent. Le salarié - s’il jouait le jeu - se donnait beaucoup au travail, et en contrepartie recevait un bon salaire, se logeait dans des endroits qui lui correspondent et avait une trajectoire de carrière régulière. Aujourd’hui, c’est plus difficile d’être logé dans les métropoles, les salaires augmentent moins, les carrières sont en zigzag… La promesse initiale n’est plus respectée. On a l’impression que le contrat est pipé, comme une trahison de l’entreprise au sens général du terme.
Lors de notre précédente interview, à l’occasion de la sortie de La civilisation du cocon, il y a deux ans, vous nous disiez que le management était voué à devenir toujours plus “maternant”. Avec l’égocène, cette tendance s’est-elle encore accentuée ?
Les attentes des employés sur ce terrain sont toujours très fortes. Aujourd’hui, la moitié des salariés se disent en situation de fragilité psychologique et 66 % attendent que l’entreprise leur vienne en aide de ce point de vue-là. Ça montre qu’on attend toujours beaucoup de l’entreprise, même si le travail n’est plus aussi central. Il y a aussi une forte injonction dans l’air du temps, c’est d’avoir un peu de chez soi partout. Ça s’observe dans l’apparition de lieux intimes au travail, comme les salles de sieste par exemple.
Faites-vous partie de ceux qui pensent que, comme pour des enfants trop gâtés, il manque aujourd’hui des cadres clairs aux travailleurs ? Est-il temps de serrer la vis ?
Non, je ne pense pas que la solution soit du côté de la contrainte. Pour recréer de la sécurité psychique, les salariés ont besoin de deux choses : de la reconnaissance et de la stabilité. En fait, les réponses à cette fragilité intérieure sont souvent à côté de la plaque. Dans une entreprise où je travaillais, les RH avaient organisé des « moments expresso » pour qu’on se raconte nos vies autour de la machine à café… C’est complètement inadapté, car ça ne répond pas du tout au besoin latent de reconnaissance morale et économique.
Les entreprises qui adoptent la semaine de 4 jours comprennent mieux le problème, elles proposent un nouveau contrat moral : l’employeur donne de bonnes conditions de travail et efface davantage le présentéisme, et en échange les employés vont mieux travailler pendant ces 4 jours-là.
« Si on veut que les salariés s’engagent au travail, il faut nouer un nouveau contrat moral avec eux. » - Vincent Cocquebert, essayiste
En ouverture de votre livre, vous proposez une « transition egologique » pour « retrouver le sens de notre dépendance réciproque les uns envers les autres ». Comment faire cette transition, concrètement ?
Cette transition passe à la fois par le politique et l’individuel. Pour moi, l’école est un endroit clé pour apprendre le travail collectif et la coopération, plus que la compétition entre les élèves. Il faut toutefois qu’on arrive à conserver une forte exigence des savoirs. De toute manière, une fois que les individus sont sur le marché du travail, ils vont devoir travailler en groupe.
En attendant que l’éducation prenne cela à bras-le-corps, n’y a-t-il pas d’ores et déjà des solutions à appliquer en entreprise pour recréer du collectif ?
Il y a des pistes à explorer. En entreprise, il me semble important d’assurer un ancrage territorial fort. Plusieurs mastodontes qui ont fait un méga développement dans les années 2000 sont en train d’être rachetés ou liquidés (GAP ou Camaïeu, le groupe Casino…). À l’inverse, les entreprises qui se sont enracinées au niveau local sont plus stables, elles réussissent mieux économiquement. Le modèle de la fin des années 1990, qui anonymise les salariés et déshumanise les modes de production, a atteint ses limites. Si on veut que les salariés s’engagent au travail, il faut nouer un nouveau contrat moral avec eux.
Comment les entreprises peuvent-elles créer ce nouveau contrat moral ?
Cela passe d’abord par un management sain, dans lequel on fait confiance au salarié. Il faut créer des postes dans lesquels les individus sont reconnus et non dénigrés. Ensuite, la culture d’entreprise ne doit pas être un mantra vide de sens. Si on le répète trop pour que les gens y adhèrent, il y a de bonnes chances que ce mantra soit creux. Il faut au contraire un projet commun, un plan stratégique qui sera une manière d’imaginer demain ensemble. C’est en se projetant dans l’avenir qu’on va façonner une entreprise qui a du sens. Pour bâtir ce projet, il faut écouter et prendre en compte les salariés, car ce sont eux qui vont réaliser le travail.
Article édité par Clémence Lesacq - Photo Thomas Decamps pour WTTJ

Inspirez-vous davantage sur : Mutations

L’Allemagne teste la semaine de 4 jours: « Le temps libre a une valeur inestimable »
Plus de 30 entreprises allemandes testent la semaine de 4 jours. L'objectif : rendre le travail plus attractif.
02 mai 2024

Anticiper les Jeux : les entreprises et salariés mis à l’épreuve
Télétravail, flexibilité, congés interdits ou forcés : comment les franciliens se préparent à la période des JO.
12 avr. 2024

« Le sédentarisme tue » : quelle(s) responsabilité(s) pour les entreprises ?
95 % des Français sont exposés à des problèmes de santé liés à la sédentarité. Mais est-ce vraiment aux entreprises de s'engager sur le sujet ?
11 avr. 2024

Chanson, livre, série… Comment le burn-out a envahi la sphère culturelle
Le burn-out est de plus en plus courant, donc il n’est pas surprenant que cela se reflète dans la culture. 4 œuvres qui abordent ce sujet.
09 avr. 2024

Les “Fuckup Nights” : ils et elles partagent leurs échecs sur scènes
Pour Pepe Villatoro, cofondateur de Fuckup Nights, éviter l'échec est impossible. Mieux vaut le partager pour grandir.
08 avr. 2024
La newsletter qui fait le taf
Envie de ne louper aucun de nos articles ? Une fois par semaine, des histoires, des jobs et des conseils dans votre boite mail.
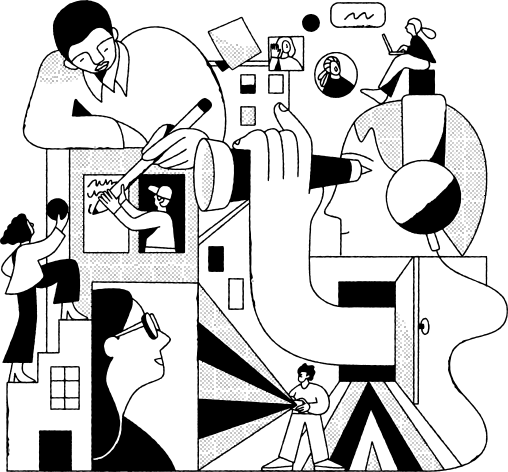
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité ?
Plus de 200 000 candidats ont trouvé un emploi sur Welcome to the Jungle.
Explorer les jobs



