Marque employeur : 5 entreprises qui ont renié leur ADN
27. 5. 2021
9 min.



Photographe chez Welcome to the Jungle
Conversations censurées au travail, changement de modèle organisationnel… Certains employeur·e·s n’hésitent pas à prendre des virages culturels qui détruisent leur marque employeur. Lorsqu’on a une culture d’entreprise forte, faut-il nécessairement changer de cap pour répondre aux nouveaux enjeux économiques et sociaux ? Et côté salarié·e·s, comment ces transformations sont-elles perçues ? Zoom sur 5 entreprises qui ont renié leur ADN… et n’auraient peut-être pas dû.
La marque employeur au cœur des débats
La marque employeur est devenue un sujet central pour les entreprises. Attirer les meilleurs talents mérite tous les efforts possibles. C’est pourquoi certaines sociétés se tournent vers des certifications comme B-Corp ou Great Place to Work pour mettre en avant leur culture attrayante, leur responsabilité sociale et l’importance qu’elles accordent au bien-être de leurs employé·e·s. D’autres font la promotion de leurs espaces de travail, de leur engagement en faveur de l’environnement ou de la diversité. Et certaines essaient aussi de créer une culture d’entreprise qui offre aux employé·e·s plus d’autonomie, de liberté et un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Quelques entreprises se présentent comme des utopies du futur du travail, parmi lesquelles Patagonia et Buurtzorg sont depuis longtemps citées comme des employeurs modèles. Et puis il y a celles qui ont beaucoup investi pour être vues comme telles et qui ont ensuite opéré un virage radical. Vous souvenez-vous de l’année 2017, quand IBM et Yahoo ont soudain interdit le travail à distance après l’avoir autorisé pendant des années ? Récemment, on a beaucoup parlé du changement culturel chez Basecamp après que ses dirigeants ont annoncé que les discussions politiques seraient interdites sur le lieu de travail.
Passer de progressiste à conservateur, de permissif à strict, ne va jamais vous faire gagner la faveur des médias, ni celle des salarié·e·s qui peuvent y voir une trahison. Ils / elles n’ont pas signé pour cela et décident parfois de démissionner. La plupart des entreprises ne souhaitent pas délibérément abîmer leur marque employeur. Alors pourquoi certaines opèrent-elles de telles volte-face ? Ces virages peuvent être révélateurs d’un déclin de l’activité, ou être le signe d’une déconnexion entre le modèle d’entreprise et la culture, ou encore être justifiés par une forte croissance, car une entreprise plus mature a besoin de profils d’employé·e·s différent·e·s. En bref, il existe plusieurs raisons, bonnes ou mauvaises, d’opérer un virage culturel.
5 « shifts » culturels qui ont mal tourné
Le désordre provoqué par la volte-face de Basecamp
Le logiciel de travail collaboratif de Basecamp ne compte pas tant d’utilisateur·rice·s. Bien avant Slack, Teams Facebook, Trello et autres, Basecamp, la société (qui s’appelait autrefois 37Signals), a lancé un logiciel pour aider les équipes distribuées à collaborer. Mais elle est surtout devenue célèbre pour les conseils de vie et de travail délivrés par ses fondateurs Jason Fried et David Heinemeier Hansson (DHH), dont les livres Rework (2010), Remote (2013) et It Doesn’t Have To Be Crazy At Work (2018) ont été d’énormes best-sellers avec des idées radicales sur l’avenir du travail.
Dans ces publications, Basecamp était présentée comme un employeur progressiste, tourné vers l’avenir et socialement engagé, où les salarié·e·s peuvent travailler avec autonomie et flexibilité, équilibrer sainement vie professionnelle et vie privée, et être au travail comme ils/elles sont dans la vie. Aussi, lorsqu’en avril 2021 les fondateurs ont annoncé une série de changements, parmi lesquels la fin des discussions politiques au travail, plus d’une douzaine d’employé·e·s ont démissionné et de nombreuses critiques ont émergé dans les médias. On a accusé les fondateurs d’être des hommes blancs privilégiés qui n’ont pas la moindre idée de ce qu’est la vie des « vrais » gens. Pour les critiques, tout est politique.
Fried et Heinemeier Hansson n’ont sans doute pas complètement anticipé les réactions que provoqueraient ces annonces. Un débat interne sur la diversité, l’inclusion, ce qui est culturellement acceptable et ce qui ne l’est pas, est devenu incontrôlable. Ils ont alors pris la décision d’y mettre fin sans réfléchir aux conséquences. Basecamp n’est pas une société cotée en bourse et personne ne sait exactement combien d’utilisateur·rice·s elle compte. Peut-être que cette volte-face est le signe d’une crise plus profonde de leur modèle. Je suis persuadée que Fried et DHH sont assez malins pour rebondir un jour, mais à court terme, leur réputation personnelle en tant que pionniers du futur du travail en a pris un coup.
Quant à la société Basecamp, soit elle était déjà en difficulté et la démission de son designer et de plusieurs développeurs clés ne fera pas de différence, soit ces démissions vont mettre la société en difficulté. Non seulement le départ soudain d’un tiers de tous / toutes les employé·e·s constitue un défi organisationnel sans précédent, mais qui peut dire comment les utilisateur·rice·s vont réagir ?
Buzzfeed : un modèle économique défaillant avant tout
Fondé en 2006, Buzzfeed est ce média en ligne révolutionnaire qui a compris les principes de la viralité. Ses « listicles » originaux et ouverts permettaient aux utilisateur·rice·s d’attribuer le sens qu’ils souhaitaient à un contenu. Buzzfeed s’est développé avec des promesses d’impact et d’autonomisation. Voilà qui a bouleversé le modèle médiatique traditionnel. On y a compris avant tout le monde que la clé de l’engagement est la suivante : « Un excellent contenu n’est pas une question de contenu, mais tout dépend de l’émotion suscitée chez les lecteur·rice·s. » Lorsque le média s’est mis au journalisme d’investigation, c’était avec la même promesse d’émotion et d’impact.
Mais Buzzfeed fait face à des difficultés depuis des années maintenant. Début 2019, les employé·e·s ont été informé·e·s par un mémo que 15% d’entre eux / elles seraient licencié·e·s. En 2020, elle a fait l’acquisition du HuffPost pour annoncer quelques semaines plus tard que 30% de son personnel serait mis à la porte. Et parmi les licenciements, on compte des journalistes chevronné·e·s qui ont travaillé près de dix ans au HuffPost. Cette annonce a été ressentie comme une trahison, un revirement complet par rapport à une culture de travail axée sur l’impact.
En fait, comme l’a noté Ben Thompson sur son blog Stratechery, « si l’on met de côté l’impact sociétal, ne serait-ce qu’un instant, l’histoire de la disparition d’un média est plutôt banale : une concurrence presque infinie combinée à un produit de qualité inférieure, voilà ce qu’entraîne l’échec du modèle d’affaires. (…) Le produit de qualité inférieure, c’est la publicité : autrefois, les journaux étaient la seule option (…) ; aujourd’hui, ces annonceurs qui ne payaient pour des espaces dans les journaux que parce qu’ils n’avaient pas le choix, peuvent cibler les utilisateur·rice·s là où ils / elles passent le plus de temps, à savoir sur Facebook et Google. C’est pour ça que le modèle économique a échoué : faut-il s’étonner que le contenu banalisé et le modèle publicitaire n’aient pas fonctionné ? »
Les volte-face culturelles s’expliquent le plus souvent par le déclin (relatif) du modèle économique de l’entreprise. Aucune utopie du futur du travail ne peut résister à l’épreuve de la décroissance. Yahoo en est un bon exemple. Buzzfeed aussi.
Le changement de cap d’Etsy face aux difficultés
Etsy est cette plateforme en ligne d’articles faits main et de produits artisanaux, qui se propose de remettre au goût du jour les valeurs de l’artisanat. À l’origine, l’objectif commercial (permettre à des particuliers de vendre leur artisanat en ligne) correspondait à la fois à la culture d’entreprise et à la vision du travail. Etsy est devenue une B-Corp en 2012. Elle a souvent été saluée comme l’une des meilleures entreprises pour les parents actifs (l’un des « meilleurs employeurs pour les jeunes pères ») et offrait des congés parentaux extraordinairement généreux. Les candidat·e·s voulaient travailler chez Etsy parce qu’ils / elles étaient « convaincu·e·s que l’entreprise a un objectif social au-delà du seul profit. »
En 2015, l’introduction en bourse d’Etsy a été jugée très décevante. Deux ans plus tard, Etsy a licencié son PDG, Chad Dickerson, et l’a remplacé par Josh Silverman. Ce dernier a également restructuré l’entreprise dans le but de générer de meilleurs revenus et de la rendre plus rentable. Un quart du personnel a été licencié du jour au lendemain. Etsy a opéré un virage culturel et est devenue plus corporate. Naturellement, la plupart des salarié·e·s restant·e·s n’étaient pas heureux / heureuses de ces changements. Certain·e·s d’entre eux / elles ont alors publié une pétition publique dans laquelle ils / elles expriment leurs inquiétudes sur « ce que l’avenir [leur] réserve en tant qu’employé·e·s d’Etsy et pour la communauté des entrepreneurs créatifs d’Etsy. »
De plus, il a été révélé par la suite que la plupart des vendeurs / vendeuses gagnent moins de 100 dollars par an sur la plateforme. Etsy est depuis l’une des nombreuses sociétés technologiques qui ont dû subir un backlash de l’opinion publique. Peut-être les promesses de « l’économie de la passion » ont-elles été exagérées et survendues ? Aujourd’hui, Etsy ne ressemble plus à cette « utopie culturelle » qu’elle était dans les premières années. Elle compte plus d’utilisateur·rice·s actif·ve·s (4,3 millions), mais depuis son introduction en bourse, « la tension entre le soutien aux petites entreprises sur la plateforme et la transformation d’Etsy en une entreprise en croissance semble être une bataille sans fin. »
Le géant Google peut désormais « faire le mal »
Pendant des années, Google a eu pour devise (non officielle) ‘Don’t Be Evil’ (« Ne faisons pas de mal »). En tant qu’employeur, l’entreprise est rapidement devenue célèbre pour avoir permis à ses employé·e·s d’exprimer leur créativité. Les ingénieur·e·s originaux / originales étaient attiré·e·s par Google car elle était réputée pour offrir un environnement de travail stimulant. On pouvait même y consacrer un cinquième de son temps à des projets personnels, ce qui était vu comme un moyen pour l’entreprise de stimuler l’innovation. Ses avantages en nature et son campus extraordinaire ont été salués dans le monde entier. Lorsqu’on accusait l’espace de travail de ressembler à une aire de jeu géante, cela servait en fait la marque employeur de l’entreprise, car le message était le suivant : « Oui, c’est une cour de récréation parce que nous savons nous amuser ! »
Puis Google a grandi et est devenue un mastodonte dont la culture ne ressemble plus en rien à ce qu’elle était à l’origine. Elle compte plus de 100 000 employé·e·s depuis 2019. C’est l’une des 5 plus grandes entreprises du monde par sa capitalisation boursière. Sa valeur a été multipliée par 8 en moins de 10 ans ! Comme toutes celles qui grandissent à ce point, elle est devenue plus rigide, moins innovante et moins amusante. De nombreux / nombreuses employé·e·s qui y ont travaillé à la fin des années 2000 et au début des années 2010 racontent avoir vécu ce changement culturel. Ils / elles disent qu’à mesure que la culture changeait, l’ambiance et les gens changeaient aussi. Il est évident qu’un géant comme Google n’a pas les mêmes besoins en matière de ressources humaines qu’une startup et qu’il recrute des personnes différentes, moins de penseurs / penseuses originaux / originales, peut-être, et plus de profils corporate. Les personnes attirées par l’actuel Google veulent travailler pour une entreprise qui offre des avantages et de la sécurité. Contrairement à eux / elles, les premiers / premières employé·e·s de Google étaient surtout attiré·e·s par un environnement stimulant composé de personnes brillantes.
Comment développer une culture de la reconnaissance au travail ?
Il y a quelques années, Google (qui fait désormais partie du groupe Alphabet) a abandonné sa devise ‘Don’t Be Evil’. Et depuis longtemps déjà, l’entreprise est embourbée dans de nombreux scandales et controverses concernant l’évasion fiscale, l’utilisation abusive des résultats de recherche, la violation de la vie privée, la consommation d’énergie de ses serveurs, l’antitrust, etc. On l’accuse même de porter atteinte à la démocratie. Enfin, la marque employeur Google a traversé « des années de misère » à cause d’un certain nombre de controverses sur son manque de diversité, la persécution des minorités, les cas de harcèlement sexuel et les politiques sexistes. L’an dernier, le licenciement de la chercheuse en IA Timnit Gebru, qui avait tiré la sonnette d’alarme sur le manque d’éthique et de diversité de Google, a fait grand bruit. La responsable des ressources humaines de Google, Eileen Naughton, a démissionné en 2020, mais cela n’a pas réglé les problèmes internes.
Tout cela a conduit de nombreuses personnes à considérer Google comme une entreprise désormais ouvertement « diabolique », qui ne fait même plus semblant de rechercher la responsabilité sociale, la diversité et l’inclusion. D’autres disent qu’elle l’a toujours été. La volte-face culturelle de Google ne semble pas l’avoir mise en péril. Le fait est que Google ne recrute plus le même type de personnes qu’auparavant et a changé de besoins.
Zappos et la fin de « l’holacratie »
Zappos est une entreprise américaine de vente de chaussures en ligne fondée en 1999 et rachetée dix ans plus tard par Amazon. La même année (2009), elle a été classée par Fortune parmi les « 100 meilleures entreprises où travailler ». Dirigée par le regretté Tony Hsieh, Zappos a développé une marque employeur puissante autour du concept d’holacratie, c’est-à-dire un modèle de travail basé sur la gestion décentralisée et la répartition des décisions dans une organisation composée d’équipes autogérées. Ici, les « holons » sont des équipes autonomes reliées à « l’entité supérieure » dont elles font partie.
On doit ce système à l’entrepreneur et auteur Brian Robertson, mais c’est surtout Hsieh qui l’a popularisé. Pendant longtemps, Zappos a probablement été l’exemple numéro un de l’organisation holacratique. En 2010, Hsieh a publié un best-seller intitulé Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion and Purpose, dans lequel il racontait l’histoire de la culture d’entreprise de Zappos et des principes de gestion révolutionnaires qui l’ont rendue célèbre. Mais est-il possible que tout cela ait été fait sans penser au bien-être des salarié·e·s ? En 2015, après une offre de rachat, Zappos a lancé un ultimatum à ses employé·e·s : adoptez notre stratégie d’auto-organisation ou partez. Beaucoup sont parti·e·s.
C’est en toute discrétion que Zappos a finalement abandonné l’holacratie en 2015. Peu de choses ont été écrites sur le sujet (en fait, beaucoup de gens croient toujours que Zappos est une holacratie). L’insatisfaction à l’égard de ce modèle a probablement joué un rôle. Après, Zappos n’a plus figuré dans la liste des « Best Companies to Work For de Fortune ». D’autres, dont le fondateur de Medium, Evan Williams, ont également abandonné l’idée de l’holacratie, affirmant que l’obsession des processus peut nuire à l’accomplissement du travail. Peut-être que le revirement de Zappos par rapport à l’holacratie n’a pas pu être rendu public et justifié parce que l’idée est si séduisante qu’il est difficile de voir lorsqu’il y a un décalage entre elle et les aspirations des personnes censées l’incarner.
Photo par WTTJ
Article édité par Ariane Picoche
Suivez Welcome to the Jungle sur Facebook, LinkedIn et Instagram ou abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir, chaque jour, nos derniers articles !

Viac inšpirácie: Laetitia Vitaud
Future of work author and speaker

JO : 5 leçons de grands champions français applicables au monde de l'entreprise
Entre diversité, leadership et innovation, découvrez comment manager « plus vite, plus haut, plus fort » d'après les meilleurs sportifs français.
18. 4. 2024

Santé des femmes au travail : différencier n’est pas discriminer !
« Si le monde du travail a été pensé par et pour des hommes, la prise en compte de certaines différences biologiques est indispensable. »
08. 4. 2024

Pourquoi les femmes seniors disparaissent des entreprises (et pourquoi l'éviter)
Et si le futur du travail résidait dans les travailleuses de 50 ans et plus ? Tribune de notre experte Laetitia Vitaud
21. 3. 2024

Faut-il compter sur l’entreprise là où la politique échoue ?
« On prête aux entreprises, et à travers elles à leurs dirigeants, le pouvoir de relever les grands défis de notre temps »
17. 3. 2024

Managers : pourquoi la moitié de votre équipe ne se sent pas respectée au travail ?
Un salarié sur deux ne se sentirait pas respecté au travail. Pour quelles raisons et comme y remédier ?
11. 3. 2024
Vnútri džungle: HR newsletter
Štúdie, udalosti, odborné analýzy, riešenia... Každé dva týždne vo vašej poštovej schránke.
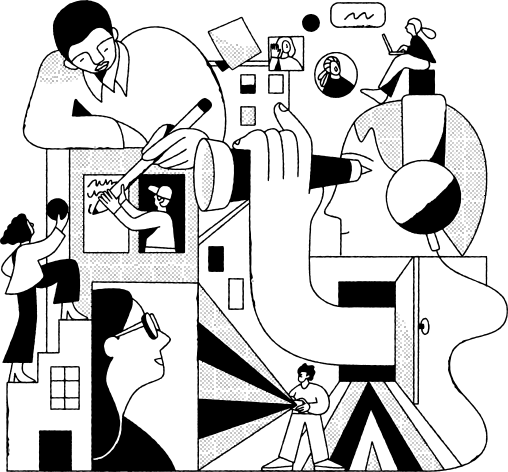
Ste hrdí na vašu firemnú kultúru?
Poskytnite jej viditeľnosť, ktorú si zaslúži.
Zistite viac o tom, ako propagovať firemnú kultúru.