Oraux d'écoles : comment expliquer les biais de genre ?
31. 8. 2020
7 min.


Ces dernières semaines, beaucoup d’encre a coulé à propos des résultats du plus récent concours d’entrée à Normale-Sup. À cause de la pandémie, de nombreuses écoles (dont Normale-Sup) se sont contentées des épreuves écrites pour sélectionner leurs étudiant.e.s… et on a constaté partout une hausse spectaculaire du nombre de femmes parmi les admis. À Normale-Sup, le contraste est saisissant. Habituellement, les femmes représentent un peu plus de la moitié des admis.e.s (54% en moyenne au cours des cinq dernières années). Mais cette année, elles représentent 67% des reçu.e.s. Chez les littéraires, la prestigieuse institution de la rue d’Ulm comptera 78% de femmes (contre 59% habituellement).
Les contraintes sanitaires particulières liée à la pandémie auront fait de cette année 2020 une sorte d’expérience de laboratoire unique pour révéler toutes les distorsions qui existent entre la sélection à l’écrit et la sélection à l’oral. Sociologues et psychologues savent depuis longtemps que certaines catégories réussissent moins bien la sélection orale : les personnes issues de milieux sociaux moins privilégiés, les femmes, les personnalités introverties, les personnes neurodivergentes. Cette année nous oblige à nous demander pourquoi, et si la sélection par les épreuves orales n’est pas fondamentalement injuste.
Les femmes sont-elles systématiquement victimes de discrimination quand la sélection se fait à l’oral ? Ou bien la différence de confiance en soi entre femmes et hommes est-elle si forte qu’elle justifie une déperdition systématique des femmes aux concours oraux et entretiens d’embauche ? Ces questions concernent autant le monde de l’enseignement supérieur que celui du recrutement professionnel, où l’évaluation et la sélection des candidats reposent en grande partie sur l’appréciation de l’oral.
- Lire aussi :
Recrutement : la fin du règne des diplômes ?
Pourquoi et comment leur toute puissance est contestée dans la course aux talents.
L’écart de confiance en soi fait que les femmes et les hommes n’appréhendent pas les épreuves orales de la même manière
Avant d’écrire sur le futur du travail et les ressources humaines, j’ai été professeure en classes préparatoires pendant huit ans. À ce titre, j’ai participé à de nombreux jurys de concours divers et variés, et surtout accompagné plusieurs générations d’étudiant.e.s aux concours et suivi leur parcours. Pendant toutes ces années, j’ai éprouvé un certain découragement face à la “déperdition” féminine systématique aux concours, que je ne pouvais pas expliquer par les seuls biais des jurys.
Non seulement mes étudiantes (y compris les meilleures d’entre elles) semblaient souvent souffrir davantage d’un manque de confiance en soi que leurs homologues masculins, mais en plus, je pouvais constater chaque année, qu’elles “perdaient” effectivement quelques points entre les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales d’admission. Parfois, elles perdaient déjà leurs moyens au moment des épreuves écrites du concours. Connaissant les qualités scolaires de ces étudiantes, je pouvais constater la “perte de moyens” liés aux concours. Inversement, j’observais plus fréquemment des parcours “surprise” (réussite au concours plus grande que pendant l’année scolaire) chez les étudiants que chez les étudiantes.
Même aux concours des écoles de commerce, où la mixité femmes/hommes semble a priori parfaite, il existe une déperdition systématique. Par exemple, en 2017 au concours d’HEC, les femmes représentaient 50,8% des candidats inscrits, mais 43,5% des candidats admissibles (après les épreuves écrites), et seulement 41,5% des candidats admis. Dans tous les concours, quelle que soit la filière, on observe à des degrés divers une déperdition de ce type.
Ce que les sociologues observent depuis plusieurs décennies, c’est que le système des concours aux grandes écoles entretient un phénomène de reproduction sociale endémique qui s’exprime aussi dans la manière dont les candidat.e.s appréhendent les concours. Ceux/celles issu.e.s de milieux défavorisés sont en général moins bien “armé.e.s” pour affronter les concours : ils/elles ne semblent pas maîtriser aussi bien les codes (vestimentaires, culturels, linguistiques) pour inspirer confiance.
Même quand ils / elles se sentent “armé.e.s”, ils / elles font face à des difficultés supplémentaires. Les personnes qui ont conscience de l’existence de biais à leur encontre assument un stress supplémentaire, « celui de ne pas confirmer le stéréotype, et de ne pas être victime de discrimination ». On appelle cela la “menace du stéréotype” : dans une situation où un préjugé s’applique (et où il risque de se manifester), la personne potentiellement visée par ce préjugé se sent jugée et éprouve des sentiments d’anxiété ou d’insécurité.
Les filles réussissent fort bien à l’école : elles sont socialisées pour se conformer aux attentes scolaires. Mais la conformité et les qualités qui font la “bonne élève” peuvent être pénalisantes aux concours des grandes écoles. À l’oral en particulier, on privilégie davantage l’assurance, l’audace, et le sens de la compétition. Tout se passe comme si les qualités scolaires pouvaient tout d’un coup devenir un handicap. Dans la socialisation des filles, les qualités qui font les meilleurs “compétiteurs / compétitrices” restent moins valorisées que chez les garçons qui apprennent davantage à “gagner” dans les sports et jeux qu’ils pratiquent. Hélas, la “socialisation différenciée” résiste décennie après décennie : la coopération et le partage pour les filles ; la compétition et la conquête pour les garçons.
- Lire aussi : Parité : « On ne progresse qu’en mesurant »
En tant qu’enseignante, j’avais conscience de tout cela, et je tâchais de préparer mes étudiantes aux concours en les encourageant à s’affirmer davantage. Mais comment lutter contre des décennies de socialisation ? Trop souvent, il se produisait chez les étudiantes les mêmes phénomènes : la perte de moyens aux épreuves écrites, l’insuffisance de confiance en soi au moment des épreuves orales. Au point que j’en suis venue à questionner le système des concours dans sa globalité : comment peut-on laisser une épreuve si ponctuelle passée à un si jeune âge déterminer à ce point la vie puis la carrière d’un individu ?
La France ne collecte pas de données sur le sujet de la représentation des minorités ethniques, mais il est fort probable qu’on aurait observé d’autres phénomènes remarquables lors des concours 2020. L’absence d’oraux aurait-elle pu révéler aussi le racisme systématique des épreuves orales aux concours des grandes écoles ? Impossible de le dire car il n’est pas autorisé de collecter des données pour démontrer les biais racistes.
Les biais des jurys ont des conséquences sur la sélection des candidat.e.s
L’écart entre les femmes et les hommes ne s’explique pas seulement par un écart de confiance en soi et la socialisation différenciée des filles et des garçons. Bien que les jurys des concours soient en moyenne plus mixtes qu’ils ne l’étaient il y a vingt ans, bien que les questions sexistes soient moins tolérées (par exemple, la question « comment comptez-vous concilier vie privée et vie professionnelle ? » posée aux seules candidates), les jurys continuent de perpétuer de nombreux biais de genre.
Les biais existent aussi à l’écrit, mais ils sont omniprésents et inévitables à l’oral, car l’évaluation porte sur les personnes, leur manière d’être, et leurs qualités de “présentation”, au moins autant que sur leurs compétences.L’effet de halo, par exemple, conduit le jury à se fier à des critères qui n’ont rien à voir avec les qualités intellectuelles ou professionnelles du/de la candidat.e. Le biais de Dunning-Kruger les amène à être (indûment) impressionné.e.s par ceux/celles qui semblent avoir fortement confiance en eux/elles (un peu plus les hommes que les femmes, donc).
Pour ce qui est des biais de genre, toutes les études montrent que les femmes en sont autant victimes que les hommes. En d’autres termes, même quand les jurys sont mixtes (ce qui reste une bonne chose), on n’est nullement à l’abri de ces biais. En classe, les enseignant.e.s (hommes et femmes) ont tendance à accorder plus de temps aux garçons qu’aux filles et la prise de parole masculine a tendance à être plus valorisée. On a tendance à montrer un certain mépris pour les qualités de conformité de la “bonne élève” tandis qu’on valorise la spontanéité des étudiant.e.s dont le travail est moins régulier.
- Lire aussi : Comment féminiser ses offres d’emploi ?
En tant que professeure, j’ai moi-même perpétué ces biais et je me suis souvent surprise à être “coupable” de les entretenir. J’étais si reconnaissante qu’un.e étudiant.e “rebelle” exprime de l’intérêt pour un sujet en classe que j’avais tendance à valoriser davantage sa prise de parole que celle d’un.e étudiant.e assidu.e dont je prenais le travail pour acquis. J’accordais davantage de temps aux étudiant.e.s habituellement dissipé.e.s pour “canaliser” leur énergie. Quand les garçons étaient minoritaires dans la classe, je pratiquais une forme de “discrimination positive” en leur donnant plus de poids et d’attention.
En tant que professeure, j’ai moi-même perpétué ces biais et je me suis souvent surprise à être “coupable” de les entretenir.
Et c’est là que réside précisément l’un des grands non-dits sur la sélection orale aux concours et dans le système scolaire ! Les filles sont devenues meilleures élèves que les garçons depuis quelques années. Elles réussissent mieux au baccalauréat. Dans de nombreuses filières elles sont plus nombreuses. Et dans de nombreux concours (à l’exception notable des concours aux grandes écoles scientifiques), elles représentent plus de la moitié des candidat.e.s. Les épreuves orales représentent donc une opportunité — consciente et inconsciente— pour les jurys de faire une sorte de discrimination positive en faveur des hommes. C’est d’autant plus paradoxal qu’on imagine la discrimination positive aller en sens inverse…
L’année 2020 aura donc été une expérience de laboratoire pour révéler ces choses que les chercheurs/chercheuses en sciences humaines savent depuis longtemps, mais que les décideurs / décideuses refusent de voir au nom d’une soi-disant “méritocratie”. C’est donc aussi l’occasion de remettre en question un système inégalitaire qui n’a en fait rien de méritocratique.
Enfin, ces concours se passent à un jeune âge (20 ans), ce qui en amplifie le caractère inégalitaire. Comme je l’ai écrit dans cet ebook sur la fin du règne des diplômes :
« Au-delà de la question sociologique de l’inégalité d’accès aux sphères du pouvoir, le système français des grandes écoles présente une spécificité qui se distingue des fabriques des élites dans d’autres pays : la sélection avec le concours se fait particulièrement tôt, après deux ans de classe préparatoire, et détermine durablement les chances d’accès au pouvoir économique et politique et au sommet de la hiérarchie des organisations. Le résultat d’un seul concours passé à l’âge de 20 ans a une influence disproportionnée sur le statut social, les opportunités professionnelles et l’ensemble de la carrière d’un individu. »
Extrait de l’Ebook : Recrutement : la fin du règne des diplômes ?
Si cette année 2020 peut nous inviter à revoir et diversifier les modalités de sélection des candidat.e.s (aux concours comme dans le recrutement en entreprise) pour permettre une meilleure représentation de celles / ceux qui font systématiquement l’objet de discrimination (les femmes, les minorités ethniques, les classes sociales défavorisées, etc.), alors nous aurons fait un bond en avant.

Viac inšpirácie: Laetitia Vitaud
Future of work author and speaker

JO : 5 leçons de grands champions français applicables au monde de l'entreprise
Entre diversité, leadership et innovation, découvrez comment manager « plus vite, plus haut, plus fort » d'après les meilleurs sportifs français.
18. 4. 2024

Santé des femmes au travail : différencier n’est pas discriminer !
« Si le monde du travail a été pensé par et pour des hommes, la prise en compte de certaines différences biologiques est indispensable. »
08. 4. 2024

Pourquoi les femmes seniors disparaissent des entreprises (et pourquoi l'éviter)
Et si le futur du travail résidait dans les travailleuses de 50 ans et plus ? Tribune de notre experte Laetitia Vitaud
21. 3. 2024

Faut-il compter sur l’entreprise là où la politique échoue ?
« On prête aux entreprises, et à travers elles à leurs dirigeants, le pouvoir de relever les grands défis de notre temps »
17. 3. 2024

Managers : pourquoi la moitié de votre équipe ne se sent pas respectée au travail ?
Un salarié sur deux ne se sentirait pas respecté au travail. Pour quelles raisons et comme y remédier ?
11. 3. 2024
Vnútri džungle: HR newsletter
Štúdie, udalosti, odborné analýzy, riešenia... Každé dva týždne vo vašej poštovej schránke.
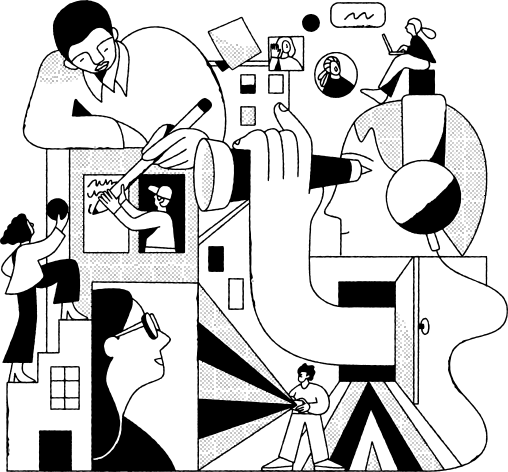
Ste hrdí na vašu firemnú kultúru?
Poskytnite jej viditeľnosť, ktorú si zaslúži.
Zistite viac o tom, ako propagovať firemnú kultúru.