Marie Dasylva : « Je mène des guerres que je n'ai pas su mener pour moi »
Oct 18, 2021

Coache stratégiste spécialiste de l’accompagment des personnes minorisées

Editorial Manager - Modern Work @ Welcome to the Jungle
TANGENTE - Dans la vie pro, il y a celles et ceux qui décident de prendre la tangente. De sortir des sentiers battus et de se battre pour construire leur propre métier et destiné. Pour recueillir les confidences de ces femmes et hommes, à travers leurs doutes, leurs obstacles mais aussi leurs joies, nous avons créé le Live Instagram TANGENTE. (à suivre ici : @welcometothejunglefr )
Pour ce premier épisode, notre experte du Lab Marie Dasylva, coache de survie au taff, se livre sur la pression familiale des enfants d’immigrés, le harcèlement qui l’a mené au burn-out, et comment, dans un effet miroir, elle se soigne désormais à travers ses consultations de coache à destination des personnes racisées.
Marie, j’ai une première question, et elle est vraiment très intime. Si demain soir je te croise en soirée et que je te demande : “Marie, qu’est-ce que tu fais dans la vie ?”, tu me réponds quoi ?
Marie Dasylva : En fait, ça va faire un peu comme dans Matrix. Il y aura la pilule bleue et la pilule rouge ! Soit j’ai envie de dire ce que je fais et de répondre aux questions qui vont suivre, soit je vais être extrêmement succincte. Donc d’un côté je vais dire : “Je suis coache et je travaille sur la question de la discrimination des personnes racisées”, et voir ce qui arrive… (Rires), soit je vais juste dire : “Je suis coache.”
Donc tu vas forcément me répondre par rapport à ton métier… mais tu ne fais pas que ça dans la vie Marie, si ?
En fait, c’est bien le drame : on se défini par le travail ! Mais c’est vrai, je ne fais pas que ça. En fait, j’ai plein de “fonctions”. Si je peux me définir en dehors de mon métier, je suis maman, je suis aussi sœur… Et puis aussi, on rêve d’être plein d’autres choses…
Avant de monter ton cabinet de coaching à destination des personnes racisées en entreprise, Nkaliworks, tu as travaillé dix ans dans la mode, en tant que vendeuse puis directrice de magasin. Ton travail à cette époque-là, est-ce qu’il était déjà si important pour toi ? Est-ce que c’était déjà ton identité profonde ?
Disons que si je reviens un peu en arrière, il y avait un rapport de nécessité absolue à ce moment-là : le besoin d’argent. Donc je me suis lancée dans le monde du travail et la vente, mais est-ce que ce travail que je faisais à l’époque me définissait vraiment ? On y passe tellement de temps qu’à un moment donné, oui, quelque part, ça vous définit… Et quand on sent qu’on n’est pas aligné avec cette définition, c’est là que se crée d’ailleurs le sentiment de manque de sens. Donc, en fait, est-ce que ça me définissait ? J’ai envie de dire oui et non. Mais il y a un moment donné, quand on se retrouve Directrice de magasin, on a envie que ça nous définisse parce que socialement, ça devient quelque chose “d’important”. Par exemple, je me rappellerai toute ma vie le jour où j’ai reçu mes premières cartes de visite, mes premières notes de frais (rires), parce que quelque part, j’accédais à quelque chose que je ne pensais pas avoir un jour.
Comment as-tu fait ce choix de travailler dans la vente ? Quand tu me dis “par nécessité”, ça veut dire quoi ? Qu’en gros tu as passé ton bac et tu t’es dit : tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais faire de la vente ?…
Exactement. En fait, vraiment, je suis entrée par hasard dans ce milieu, et comme je me débrouillais plutôt bien ça m’a permis de gravir peu à peu les échelons…
Tu m’as confié quelque chose d’intéressant sur cette notion d’identité : tu m’as dit qu’à cette époque-là, ton travail ne pouvait pas être aussi important pour toi parce que ton contexte familial faisait que de toute façon, tu devais bosser pour ramener rapidement de l’argent à la maison… Tu peux nous en parler ?
En fait, je pense que c’est vraiment une question de milieu, et même une question de société. Dans notre société donnée : “qui” n’a pas le droit à l’erreur ? À qui ne pardonne-t-on pas les erreurs ?… Cette pression-là, en fait, elle n’est pas entièrement familiale, elle va être sociétale. Cette pression de “réussir et vite” a toujours été là, depuis l’école, et donc ensuite elle est venue se poser sur cette question du travail. Etant femme, noire, dans un milieu donné, mes parents qui n’ont pas eu la même trajectoire que moi, qui ont un parcours d’immigration, attendaient de moi cette espèce de “retour sur investissement”. Il y avait cette pression de la réussite.
Si je me souviens bien, c’est en CM1 ou CM2 que tu as pris conscience de cette pression sur tes épaules…
Oui, en fait avec mon père on a toujours eu ces conversations ! Il me parlait de ce qu’il avait envie que je fasse plus tard, où il me voyait, etc. Donc, je me rappelle que sa vision n’était pas très précise, il ne savait pas ce que j’allais faire, mais il savait de quoi j’allais avoir l’air.
C’est-à-dire ?
Il me disait : “Un jour, je te verrai marcher dans la rue avec un attaché-case !” (Rires) Mais bon après, c’était les années 90 ! Donc l’attaché-case ça voulait vraiment dire quelque chose de précis dans l’esprit de mon papa, de là où il venait, c’est-à-dire la Guinée-Bissau. Ça faisait “homme politique”, ce sont des gens forcément importants qui en ont, donc quelque part il a transposé cet imaginaire-là sur moi oui.
Et toi petite, est-ce que tu te “rêvais” avec un attaché-case ou est-ce que tu avais des rêves de métier ?
(Rires) Carrément j’avais des rêves ! En fait moi j’aime les drames, je voulais écrire des drames… Je me voyais scénariste, je me voyais vraiment en rapport avec les métiers de l’imaginaire, je voulais inventer des mondes… Je voulais créer des mondes et que des gens rentrent dans ces mondes.
D’ailleurs, les seules choses que tu aimais à l’école, c’était la littérature et la philo, parce que ça t’amenait justement dans d’autres univers…
Exactement. Déjà, l’école, j’ai détesté cette institution de toute mon âme. Donc, il y avait deux matières qui m’intéressaient. La littérature, parce que j’avais accès à plein de choses et que c’était autour de l’imaginaire, je découvrais des réalités qui étaient alternatives aux miennes. Et puis la philo, parce que j’aimais bien le raisonnement. J’aimais le côté questionnant de la réalité, de l’humain. Et puis finalement, je me rends compte que ça rejoint un peu ce que je peux faire aujourd’hui. Parce que je me dis “coache de survie”, mais il y a nécessairement toute une partie de ce travail qui dépend de la manière dont on voit le monde aussi.
“Coache de survie”, on n’a même pas encore expliqué ce que c’était… Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c’est finalement que de “survivre au travail” pour des personnes qui sont racisées et qui vivent au quotidien de la discrimination?
En fait, une entreprise, c’est une structure qui est à l’image de la société et on ne peut pas y échapper. Si on parle de société, on parle forcément d’homophobie, on parle forcément de sexisme, de racisme, de validisme, et l’entreprise est une photographie de ce qui se passe dans la société… Or on discrimine dans la société, donc aucune raison que ces discriminations ne se retrouvent pas au travail ! Et donc, je me suis intéressé à ce que c’était d’être minoritaire dans un espace donné, ce que ça pouvait provoquer comme challenge, ce que ça pouvait provoquer comme “mal” quelque part. Et je me suis dit : “Est-ce qu’il y a des moyens d’adresser ce qu’on vit en tant que minorité au travail ?”
Tu en es arrivée là pour une bonne raison, ou plutôt une mauvaise… Pendant tes plus de dix ans dans la vente, notamment dans le luxe, tu as toi-même vécu des choses très compliquées, qui ont mené à ton licenciement et à deux ans de burn-out. Toi qui as tant de recul désormais sur cette période, tu arrives à parler de ce moment si dur ?…
En fait, le burn out c’est une trace de ce que j’ai pu vivre. Le burn-out est venu valider un vécu que je ne m’expliquais pas. Car ce qu’on n’explique pas, ce qu’on ne dit pas à un moment donné, se transforme et s’exprime… Donc le burn out, c’est vraiment ça. Aujourd’hui, avec le recul que j’ai, je me rends compte que je ressentais tellement cette pression de devoir plaire, dans un monde du travail, un secteur, où j’éclatais toutes les normes. Et il y avait ce truc aussi de : on m’a donné ma chance, donc je vais être digne de ça. Ce qui fait qu’on travaille à contresens de soi. Par exemple, je me rappelle qu’en dix ans, je n’ai jamais dit “non”. C’était : “Marie, tu restes quatre heures de plus ?” “Il n’y a pas de soucis !” ou encore : “Écoute, finalement, tu ne peux pas prendre deux jours de repos cette semaine, tu les récupères après.” - sans jamais les récupérer… - “OK, il n’y a pas de soucis”. Donc il y avait toujours ce truc où je sentais que je devais plaire. Je ne voulais pas être antagoniste à ce milieu…
Il y a notamment cet épisode où l’on te reproche ta coupe afro…
En fait, le code du luxe obéit à certaines normes. Et quand on parle de “norme” il y a surtout ce rapport de relativité : “qui” est la norme ? “qui” doit se référer à qui/quoi ?… Donc du coup moi je me ramène un jour comme ça, avec une petite afro toute mignonne, je me sentais vraiment très fraîche (Rires)… Et quand j’arrive sur mon lieu de travail je me dis on va me complimenter toute la journée et en fait, non… Ma directrice arrive et me dit que ce n’est absolument pas professionnel…
De quoi, d’avoir les cheveux que tu as ?…
Voilà ! C’est comme si je te disais : “tes yeux bleus sont-ils adaptés au fait de présenter Tangente ?” Tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, on ne s’en rend pas compte mais déjà, le fait que je me présente hors des codes qui avaient été fixés, on m’envoyait déjà un message : “Ce que tu es ne peut pas être considéré de facto comme professionnel”. Et en fait, c’est toute cette notion de professionnalisme que j’attaque aujourd’hui.
« Avec ce genre réflexion, on envoie un message très clair à la personne qui intègre ce milieu. On lui dit : “en fait, on n’a pas pensé à toi. Tu n’existes pas dans notre monde, tu es un accident industriel, et on va te traiter comme tel.” Donc déjà, il y a toute cette réflexion autour de l’inclusion et de l’exclusion. » - Marie Dasylva, coache de survie au taff
Ta relation à ton travail était toxique à ce moment-là, non ?
Oui, c’est vraiment ça. En fait, j’avais une relation toxique à mon travail, dans le sens où je n’étais pas alignée. Ça prenait énormément de place dans ma vie alors que concrètement, ça n’avait aucun sens. Donc oui, c’est vraiment une relation qui me faisait violence.
Mais tu continuais…
En fait, c’est la violence d’être minoritaire parce que quand tu es minoritaire, tu dois te conformer à certaines choses qui vont souvent à l’encontre de toi. Je prends un exemple tout simple : il y a des marques de luxe où on doit avoir toutes la même tenue, le même rouge à lèvres… Sauf qu’il y a une seule teinte de rouge à lèvres, et on imagine que toutes les carnations vont pouvoir la porter, que ça va aller à tout le monde, mais en fait non. Je ne porte pas le même maquillage que toi, par exemple, je ne peux pas. Or avec ce genre réflexion, on envoie un message très clair à la personne qui intègre ce milieu. On lui dit : “en fait, on n’a pas pensé à toi. Tu n’existes pas dans notre monde, tu es un accident industriel, et on va te traiter comme tel.” Donc déjà, il y a toute cette réflexion autour de l’inclusion et de l’exclusion. Et je dirais même que l’inclusivité telle qu’on la conçoit aujourd’hui, on n’y est pas encore en fait. Parce que quand on parle de l’inclusivité, on ne parle pas du rapport de force qui réside dans l’inclusivité. Parce que : “Qui” inclut qui ?
On sent bien la différence entre cette ancienne relation toxique et aujourd’hui ton travail de coache de survie, qui t’ait bénéfique et qui est vraiment identitaire pour toi… Une de mes questions c’est : quelle relation est-ce que tu entretiens avec celles et ceux que tu nommes tes “pépites” (et non pas tes client·e·s) ?
On entretient une relation qui est forcément assez forte, parce qu’on traite de sujets hypers intimes. Si on devait définir mon métier de manière psychologique ou psychanalytique, il y aurait la question du transfert, c’est-à-dire que chaque personne que j’accompagne a vécu quelque chose que j’ai vécu. Donc, ça veut dire qu’à chaque fois que j’accompagne quelqu’un, je me rejoue dans ces personnes-là, je me rejoue dans ce qu’elles vivent. Ce qui fait que forcément, il y a tout un travail émotionnel à faire pour justement avoir la distance et le recul nécessaire pour continuer à conseiller et protéger.
« L’ascenseur émotionnel, c’est tous les jours. A chaque fois que je me lève le matin j’ai des échéances : il y en a un qui passe un entretien d’embauche, une qui passe un entretien annuel où elle sait que ce sera conflictuel, une qui doit confronter son harceleur… »
Est-ce que ce n’est pas trop dur parfois, de rejouer inlassablement les mêmes scènes, pour accompagner des personnes qui ont vécu des trucs que toi tu as réussi à soigner après un burn-out ?
L’idée, c’est de rester stoïque. Parfois je me dis : “hum, est-ce que je vais survivre à cette journée ?”… Et l’idée en fait, c’est aussi de trouver des ressources. Parce que quand on accompagne une personne, cette personne met toute sa confiance en nous. Donc il faut qu’on soit digne de cette confiance. C’est pour cela que j’essaie de ne pas avoir trop de pouvoir sur cette personne, parce que mon but c’est de l’amener vers l’autonomie. Et le pouvoir que je vais avoir dans cette relation, c’est plutôt mon ennemi, et je dois chercher à chaque fois à le casser quand je sens qu’il devient trop grand. Selon les cas et la gravité je vais donc dire : “en fait, vous subissez un harcèlement, il vous faut une thérapie, parce que vous êtes en train de vivre quelque chose de traumatique.” Ou, quand ce sera une question juridique, je vais faire appel à ma juriste ou à mon avocat. L’idée, vraiment, c’est à chaque fois de diffracter ce pouvoir et de remettre de l’équilibre dans la relation.
Tu passes par des moments durs, mais aussi par des moments d’adrénaline et de joie, d’empathie pour tes “pépites” qui, finalement, peuvent aujourd’hui faire des choses que toi tu n’as pas su faire à l’époque…
Exactement. Je mène des guerres que je n’ai pas su mener quand elles me concernaient moi. Et c’est là où je vois la puissance du recul. L’ascenseur émotionnel, c’est tous les jours. À chaque fois que je me lève le matin j’ai des échéances : il y en a un qui passe un entretien d’embauche, une qui passe un entretien annuel où elle sait que ce sera conflictuel, une qui doit confronter son harceleur… Quand je me lève le matin, j’attends toujours le dénouement de quelque chose.
Nous chez Welcome on te surnomme la “punchlineuse”, et on voit bien que tu essayes de démonter un peu toutes les choses qui ne vont pas dans le monde du travail. Cette force-là, tu l’a toujours eue ou est-ce que c’est venu après ton burn out et ta reconstruction ?
C’est forcément venu dans un processus de reconstruction. Je pense aussi qu’expliquer, c’est advenir. C’est-à-dire que j’ai eu un luxe que beaucoup de personnes n’ont pas : j’ai eu du temps. Après ma dernière expérience qui a été assez traumatique en termes de harcèlement, et mon licenciement, j’avais juste besoin de temps. Et j’ai pu le prendre parce que j’ai un écosystème familial qui me le permettait…
C’est vrai que tu as pu arrêter de travailler pendant deux ans car tu vis avec tes frères et sœurs, qui étaient là pour toi, ce qui t’as permis de te poser les bonnes questions…
Exactement. Aujourd’hui le problème c’est que les gens enchaînent d’une expérience traumatisante “A” à une expérience “B” qui le sera peut-être parce que ce qui s’est passé précédemment n’a pas été réglé… Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que t’as pas lavé tes casseroles et qu’elles te suivent dans la nouvelle cuisine.
Considérant ton expérience du burn out, est-ce que tu penses qu’aujourd’hui, les gens - et même toi par exemple - travaillent trop?
De manière générale, oui, il y a un truc complètement absurde : on a accepté qu’on allait vivre seulement deux jours par semaine ! On a accepté qu’on allait voir plus ses collègues que ses enfants, et que c’était normal. Il y a eu ce tour de force qui a été de nous faire reconsidérer nos priorités. Pourtant, si je fais un micro-trottoir et que j’interroge des gens dans la rue en leur demandant c’est quoi les trois choses les plus importantes pour eux, bien évidemment l’ordre sera : la santé, la famille, le travail… Mais en vérité, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu’aujourd’hui, on meurt à cause du travail, on déprime à cause du travail, on tombe malade à cause du travail… Ça veut bien dire qu’on a réussi à nous imposer le travail comme priorité absolue.
Tu considères qu’on travaille trop, et en même temps tu es complètement passionnée par ce que tu fais et tu viens encore en parler devant nous ce soir… Ce n’est pas ambivalent ?
Si, c’est une ambivalence de fou ! Mais le truc c’est que je ne fais pas partie de la majorité des travailleurs. Mon travail de coache, je l’ai créé et j’ai créé les conditions pour qu’il soit possible, parce que je me suis rendu compte que je n’étais absolument pas soluble dans un environnement lambda. Je travaille avec les personnes avec qui j’ai envie de travailler, je collabore avec les personnes avec qui j’ai envie de collaborer… Donc en fait, j’ai une certaine liberté qui fait que je ne suis pas dans les mêmes conditions que d’autres. Je suis dans une condition extrêmement minoritaire.
Si tu pouvais choisir, tu bosserais combien de jours par semaine ?
L’idée, ce serait peut-être de bien diviser mon temps : avoir trois jours où je bosse, et quatre jours pour créer et pour explorer d’autres possibles…
Explorer d’autres possibles : tu m’as dit notamment que, en plus de tout ce que tu fais avec ton agence, tu voulais te reformer en psychologie par exemple ?
Oui. Il y a un continuum. Non seulement ça va me passionner, mais en plus ça va me servir professionnellement. J’ai l’impression qu’il y a un enrichissement qui va être total.
Est-ce que ça ne va pas aussi soigner un petit complexe par rapport à ton absence d’études ?
Si, parce qu’on ressent forcément le syndrome de l’autodidacte. Mon boulot, il est né de toute une réflexion que je me suis faite, mais je me dis que quand même il me manque “un petit truc”, un diplôme, un tampon… Et je sens que ça va me faire “durer” aussi parce que j’assume aussi ça. J’assume aussi le fait qu’être autodidacte, ça vient avec un certain lot d’anxiété et de syndrome de l’imposteur.
L’idée de continuer à se former et à autant donner, j’ai l’impression que c’est un truc vraiment important pour toi et que tu n’es pas prête de t’arrêter ou de travailler seulement trois jours par semaine… Mais tant mieux si tu t’y épanouis !… - Je vous propose maintenant de lire les questions qu’on a reçu pendant le Live. On a d’abord Nicolas, qui nous demande si tu trouves que les micros-agressions en entreprise diminuent ou au contraire, ne cessent d’augmenter…
Moi, j’ai envie de dire, cher Nicolas, que les micros agressions ont toujours été là. Je pense qu’à partir du moment où le travail a commencé à exister, les micros agressions ont commencé à exister…
Mais est-ce que la crise Covid n’a pas encore aggravé les choses ? On parle souvent des conséquences sur les populations LGBTQ+ ou asiatiques par exemple… ?
Je ne dirais pas que les micro agressions ont augmenté mais qu’elles sont plus visibles, parce qu’on en parle davantage. Et il y a aussi, comme on l’a dit tout à l’heure, le fait que l’entreprise, c’est une “micro société”, donc bien évidemment elle va réagir à ce qui se passe en dehors… Ce qui se passe aussi, c’est qu’on voit une vraie libéralisation de la parole réactionnaire, et c’est normal qu’on retrouve cette parole-là dans l’entreprise.
Pour la question suivante, on a Alba qui nous demande ce que tu proposes durant ton accompagnement…
C’est extrêmement varié mais le but c’est d’affronter toutes les questions qui peuvent se poser quand on est minoritaire dans un espace donné. L’idée aussi c’est de traiter ces questions de manière intersexuée, dans le sens où, par exemple, je suis femme et je suis noire : je ne suis pas “femme” le lundi, “noire” le jeudi, je suis les deux tout le temps… C’est ça, l’intersectionnalité, c’est la manière dont se conjuguent différentes identités et dont se conjuguent les différentes luttes que vont imposer ces identités. Et pour revenir à un truc plus terre à terre, on a ce qu’on appelle avec les pépites des “séances de stratégie”. On fait des plans de bataille qui vont durer deux semaines, on va tester des choses et le fait qu’on teste des choses ça va influer sur l’environnement de la personne. Et ensuite, on va pouvoir avancer, on avance vraiment petit à petit…
Je me souviens que tu me disais que tu fonctionnais avec des saynètes, un peu théâtrales, où par exemple tu dis : “tiens, je joue ton boss, et voilà comment est-ce que tu vas aller demander une augmentation”…
En fait, l’accompagnement va de “je veux être augmenté” à “je subis un harcèlement sexuel”, donc c’est vraiment très large. Et l’idée, c’est de travailler avec le cahier des charges de la personne. Par exemple, dans le cas d’un problème de harcèlement, si la personne me dit : “Je ne veux absolument pas aller voir les RH”, je vais devoir imaginer une solution qui rentre dans le cahier des charges de cette personne. L’accompagnement varie donc selon les personnes et selon les problématiques qu’elle pose sur la table.
La troisième question : tu parles de “guérilla” pour définir le travail que tu fais avec tes pépites, mais globalement, contre qui on se bat ? Des gens ou un système ?
On se bat contre un système ET des gens. Moi, je choisis de prendre le problème de manière individuelle parce que je travaille avec les individus qui subissent des choses qui découlent du système. Donc, évidemment que le système doit être combattu. Évidemment que ce que je fais n’a de sens que si on arrive à se mobiliser collectivement contre ce qui nous arrive. Donc, le système raciste doit être bien évidemment combattu, le système sexiste aussi…
Et c’est vrai que même si tu aides de manière individuelle tes pépites, il faut rappeler que tu es très active sur Twitter, avec une communauté de près de 29 000 followers… et que c’est aussi ta manière de traiter le problème de manière un peu plus collective, non ?
C’est le même principe que l’ambulancier en fait ! Je suis là pour traiter les urgences dans la vie des gens, des urgences qui découlent directement du système. Donc je pense qu’il y a une question sous-jacente ici c’est celle de la révolution. Elle ne sera que collective.
« Je pense qu’il faut être extrêmement lucide, ce qui est assez dur quand on se retrouve dans une situation de harcèlement… Ce que vit la personne, c’est d’une violence sans nom, et le paradoxe c’est que cette violence n’est comprise que par celui qui la perpétue et par celui qui la reçoit. Donc en fait, c’est une espèce de huis clos… » - Marie Dasylva
Quelqu’un nous demande aussi : quelles ont été tes plus belles victoires ?
Il y en a tellement… (Rires) Non mais c’est vrai !… Mais je pense forcément à un de mes premiers cas, une femme qui se faisait harceler par sa supérieure hiérarchique. On avait construit tout un plan, on avait des scénarios, je lui avais fait répéter des textes, lui avait montré des extraits de séries en disant : “C’est cette énergie qu’on veut quand tu lui parles !”, etc. Et arrive le moment de cette confrontation, puisque ça devait se régler entre ces deux femmes, un peu comme dans un western, et là, enfin, elle a réussi à dire à son harceleuse ce qu’elle devait lui dire depuis des années. Et après, c’est qui reçoit cet appel : “Marie, c’est terminé.” Alors là, c’était fini, j’étais Jack Bauer ! Il pouvait pleuvoir, je pouvais passer entre les gouttes ! Je me sentais tellement bien… Et en fait oui, ça a été une de mes plus belles victoires, aussi parce que cette personne me rappelait ma mère… Donc en fait, plein de choses se sont jouées émotionnellement : par rapport au fait que je commençais, avec toute la pression que ça implique, et le fait qu’on ait réussi, à force de scénario, de théâtre, de répétition, à abattre notre ennemi…
On a une dernière question : quels sont tes conseils pour réagir face au racisme ordinaire en entreprise ?
Alors déjà moi je n’aime pas parler de racisme ordinaire. Ce n’est pas “ordinaire” ce qui est vécu. Ensuite, comment réagir ? Je pense qu’il faut être extrêmement lucide, ce qui est assez dur quand on se retrouve dans une situation de harcèlement… Ce que vit la personne, c’est d’une violence sans nom, et le paradoxe c’est que cette violence n’est comprise que par celui qui la perpétue et par celui qui la reçoit. Donc en fait, c’est une espèce de huis clos…
Tu as l’impression que ce n’est jamais perçu par les autres autour ?
Non. Parce que, par exemple, imaginons que je me fasse harceler sous couvert “d’humour” - ce qu’on va appeler le “racisme récréatif” - je serais la seule à percevoir la charge raciste dans le propos. Et je pense que si on devait être très minutieux, très terre à terre, je pense que déjà, l’idée c’est d’être lucide. L’idée, c’est aussi d’en parler à son entourage. Et c’est aussi de prioriser sa santé mentale. Est-ce qu’on ne va pas prendre un arrêt-maladie par exemple ? En sachant que l’arrêt-maladie va servir plusieurs fonctions : il va sauver la personne sur le moment, mais va aussi lui servir à prendre du recul. Et enfin il aura une troisième fonction, c’est que quand tu vas arriver devant les prudhommes pour porter plainte contre ton entreprise, les prudhommes vont dire que si tu n’as pas pris d’arrêt, c’est que ça allait bien… L’arrêt-maladie, c’est une preuve, une alarme. Et aussi, bien évidemment, il faut passer par l’écrit. Il faut écrire, il faut envoyer des mails, il faut tracer ce qui s’est passé parce que : non seulement on ne doute plus de soi, donc ça veut dire qu’on ne peut plus nous faire flancher sur ce qui est arrivé, mais aussi dans un objectif de guérilla. Parce qu’à ce moment-là, cette guérilla devient juridique. Il faut des preuves. Et il faut se dire une chose, c’est qu’une entreprise où l’on subit un harcèlement, c’est une entreprise qu’on va quitter, fatalement. Soit c’est l’entreprise qui te fait partir, soit c’est toi qui pars. Et l’enjeu, c’est de savoir comment tu vas partir, et partir au mieux, avant d’avoir éclaté ta santé mentale. Le conseil le plus important, ça va être de toujours prioriser sa santé mentale. Toutes les décisions que tu vas prendre en fonction de ta santé mentale seront les bonnes, même si ce sont les plus dures, parce que ce n’est pas ce qu’on nous a enseigné…
> Le Jeudi 18 novembre prochain, retrouvez-nous à 18h pour le prochain épisode de TANGENTE.
Suivez Welcome to the Jungle sur Facebook, LinkedIn et Instagram ou abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir, chaque jour, nos derniers articles !
Photos Thomas Decamps pour WTTJ
More inspiration: DEI

Le cheveu comme motif de discrimination au travail ? Une loi veut y remédier
Une loi contre la discrimination capillaire pour protéger l'expression individuelle est en débat. Certains s'inquiètent de son effet discordial.
Apr 18, 2024

« Le sédentarisme tue » : quelle(s) responsabilité(s) pour les entreprises ?
95 % des Français sont exposés à des problèmes de santé liés à la sédentarité. Mais est-ce vraiment aux entreprises de s'engager sur le sujet ?
Apr 11, 2024

Dans les campagnes, « les jeunes renoncent très tôt aux métiers désirables »
Les jeunes ruraux font face à des obstacles professionnels. Repenser les politiques est crucial pour éviter leur fuite des territoires ruraux.
Apr 02, 2024

Élise Fabing : « Le travail est le domaine où les femmes ont le plus à gagner »
Dans "Ça commence avec la boule au ventre", l'avocate révèle les difficultés rencontrées par les femmes via ses dossiers les plus sensibles.
Mar 28, 2024

Covid long : une bombe à retardement pour les travailleurs et les entreprises
Le Covid long persiste, menaçant travailleurs et entreprises malgré la fin des protocoles. Des solutions sont nécessaires pour limiter les dommages.
Mar 22, 2024
The newsletter that does the job
Want to keep up with the latest articles? Twice a week you can receive stories, jobs, and tips in your inbox.
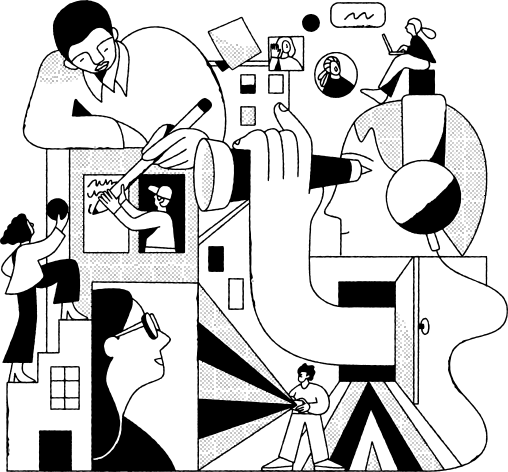
Looking for your next job opportunity?
Over 200,000 people have found a job with Welcome to the Jungle.
Explore jobs